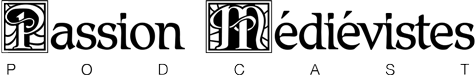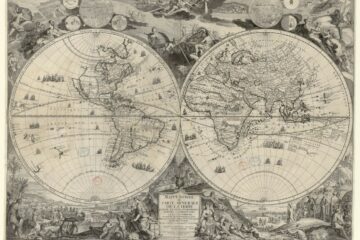Épisode 23 – Guillaume et la guillotine pendant la Révolution (Passion Modernistes)
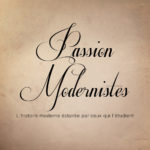
Quelle est la (vraie) histoire de la guillotine ?

Dans ce nouvel épisode de Passion Modernistes, l’invité Guillaume Debat vous parle de sa thèse qui porte sur « La machine à décapiter. Usages et représentations de la guillotine dans la France révolutionnaire (1789-1799) ». Il prépare actuellement cette thèse à l’université de Toulouse Jean Jaurès, sous la direction de Valérie Sottocasa.
La guillotine n’a quasiment pas été étudiée comme objet d’histoire dans sa globalité, la dernière grosse étude datant de 1987, par l’historien de l’art Daniel Aras. Dans sa thèse, Guillaume Debat veut étudier les réceptions de la guillotine pendant la Révolution et après. Il veut comprendre comment cet objet, vu positivement à sa création, comme une avancée technologique et humaniste, jusqu’à son image de symbole de mort et de Terreur. Il interroge aussi les rapports de force, dans un contexte révolutionnaire assez complexe.
Une période révolutionnaire

Pour sa thèse, Guillaume Debat a travaillé sur la période révolutionnaire, à partir de 1789 jusqu’à 1804. Le début de cette période est marqué par les discours et discussions sur la peine capitale mettent au centre de leur propos le caractère humain et l’absence de douleur comme deux conditions sine qua non de la nouvelle mise–à–mort légale. La nécessité de rompre avec les pratiques d’Ancien Régime est clairement partagée par l’ensemble des législateurs.
En 1791, à la fin de ces premiers débats, la décapitation semble être la mise à mort la plus rapide et la moins douloureuse pour condamner un criminel, et est adoptée dans le code pénal. Cette décision s’inscrit également dans une démarche de réaliser une avancée humaniste et égalitaire pour rendre la mise à mort plus efficace.
La création de la guillotine
Néanmoins, en 1792, avec l’arrestation de Nicolas Jacques Pelletier se pose la question de comment réaliser la mise à mort. Est-ce que le geste doit être manuel ou mécanique ? Les bourreaux soulignent que la mise à mort à la main est épuisante et peut ainsi entraîner des ratés.
Intervient alors Antoine Louis, chirurgien militaire, qui propose de réaliser les plans d’une machine qui permet de mécaniser la mise à mort, la guillotine. Le premier dispositif est construit rapidement afin d’exécuter au plus vite le condamné. Pour autant, la guillotine connaîtra tout de même des ratés, démontrant qu’elle n’est pas si fiable. Au fur et à mesure des années, plusieurs modifications sont ainsi apportées à l’appareil.
Les émotions liés à la guillotine

Si l’histoire des émotions s’est intéressée à la Révolution française, elle ne s’est pas véritablement attardée sur la guillotine. Pourtant, les émotions exprimées autour d’elle révèlent sa place dans les mentalités. Ces réactions variées et changeantes aident à comprendre comment elle est devenue un symbole. Au centre de ces représentations opposées, le sang joue un rôle central, tantôt à célébrer la République ou à discréditer durablement la guillotine et la Révolution.
A Paris, lors de la première exécution, la foule aurait été déçue. Mais avec le contexte de la Terreur, notamment en 1794, la guillotine change progressivement d’image. En effet, le sang accumulé des nombreux exécutés entraîne une nausée dans la capitale. Le sang a une odeur nauséabonde, les chiens viennent s’abreuver dans les marres de sang…
Ce sang nourrit des émotions contradictoires parmi les acteurs de la Révolution. Les autorités publiques ont peur, alors que les sans-culottes font de la guillotine un symbole de l’insurrection populaire.
En revanche, en province, la guillotine est dès le début perçue de manière négative. Les bourgeois provinciaux veulent limiter la vision du sang versé pour ne pas menacer l’ordre public dont elle est responsable. La guillotine est limitée dans de nombreuses villes ou démontée entre deux exécutions et n’est là que pour être une crainte, une peur latente.
Cela renvoie à un choix politique, sur fond d’une vision négative des classes populaires: se prémunir des possibles et redoutés débordements de la foule, particulièrement de celle révolutionnaire.
Pour en savoir plus sur le sujet de l’épisode, on vous conseille de lire :
- BIARD (Michel) et LINTON (Marisa), Terreur ! La Révolution française face à ses démons, Malakoff, Armand Colin, 2020
- MARTIN (Jean-Clément), Violence et Révolution, Essai sur la naissance d’un mythe national, Paris, Éditions du Seuil, 2006
- VOVELLE (Michel), La Révolution française, Paris, Armand Colin, 1992
- ARASSE (Daniel), La guillotine et l’imaginaire de la Terreur, Paris, Flammarion, 1987.
- CAROL (Anne), Physiologie de la Veuve : une histoire médicale de la guillotine, Seyssel, Champ Vallon, 2012.
- DEBAT (Guillaume), « La guillotine dans le Maine-et-Loire : un instrument de la justice d’exception (1792-1795) », Annales de Bretagne et des Pays de l’Ouest, à paraître été 2021.
- DEBAT (Guillaume), « La guillotine révolutionnaire : de l’incarnation de l’humanisme pénal à une machine effroyable ? (1789-1794) », Annales historiques de la Révolution française, n°402, décembre 2020, pp. 33-57.
- DEBAT (Guillaume), « Les contradictions de la guillotine révolutionnaire : autour d’une exécution ratée à Toulouse en janvier 1794 », La Révolution française – Cahiers de l’Institut d’histoire de la Révolution française, n°18, 2020 (10.4000/lrf.3988).
- TAÏEB (Emmanuel), La guillotine au secret. Les exécutions publiques en France, 1870-1939, Paris, Belin, 2011.
Dans cet épisode vous avez pu entendre les extraits des œuvres suivantes :
- Extrait du film « Un roi et son peuple » (2018)
- Extrait du film « Danton » (1983)
- Les Inconnus – La Révolution
Si cet épisode vous a intéressé vous pouvez aussi écouter :
- Épisode 22 – Edith et Madame Roland, une femme des Lumières
- Épisode 21 – Félix et la police à Caen pendant la Révolution
- Épisode 18 – Olivier et la marine au XVIIIème siècle
- Épisode 17 – Sabrina et les voyages d’Antoine Galland
- Hors-série 1 – La Méditerranée au XVIIème siècle
- Épisode 16 – Benjamin et Mme Eloffe, marchande de mode
Le générique du podcast a été réalisé par Julien Baldacchino et par Clément Nouguier (du podcast Au Sommaire Ce Soir).
Et merci à Lisa Rasamy-Manantsoa d’avoir écrit l’article qui accompagne l’épisode !