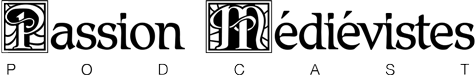Au cœur de Notre-Dame de Paris
Écoutez des passionnés vous parler de la cathédrale Notre-Dame de Paris sous tous les angles !

En général dans le podcast Passion Médiévistes, chaque épisode est l’occasion de vous faire découvrir ou redécouvrir le Moyen Âge. Cette période historique souffre encore de beaucoup d’idées reçues et de clichés donc il était nécessaire d’y consacrer un podcast.
Dans cette série d’épisodes je vous propose d’en apprendre plus sur un monument du Moyen Âge que vous connaissez toutes et tous : la cathédrale Notre-Dame-de-Paris. Après la vague d’émotions qui a suivi l’incendie du 15 avril 2019 et qui a considérablement changé l’histoire de ce monument, j’avais envie de vous faire entendre des personnes qui y ont consacré une partie de leur vie. Certain.e.s l’étudient, d’autres y ont travaillé pendant plusieurs années, ou d’autres encore œuvrent pour sa future restauration.
Mais dans cette série d’épisodes, l’incendie en lui-même ou la restauration ne seront pas les sujets centraux. Je souhaite vous offrir plusieurs points de vue sur ce monument et ainsi mieux comprendre son histoire médiévale mais pas que. Ces épisodes vous feront prendre conscience de son importance dans notre imaginaire collectif, mais entendre aussi des témoignages de vies et d’humanité, pour que vous puissiez regarder ce monument emblématique de Paris avec un œil nouveau.
Épisode 1 : Faire une thèse sur Notre-Dame de Paris

Depuis 2014 Olivier de Châlus prépare une thèse sur le chantier de la construction de la cathédrale de Notre-Dame-de-Paris. Il est guide bénévole à la cathédrale depuis 2008 et était le responsable de l’équipe des guides entre 2014 et 2019. Il est par ailleurs le porte-parole de l’Association des scientifiques au service de la restauration de Notre-Dame de Paris.
Dans ce premier épisode, Olivier de Chalus vous raconte son parcours jusqu’à la thèse, les principaux axes qu’il y développe ainsi que les méthodes particulières qu’il emploie. Avec son regard d’ingénieur, son étude se fonde principalement à partir des observations qu’il a pu faire sur le bâti, les murs de la cathédrale et un modèle théorique qu’il a développé pour retracer l’histoire de la construction du monument.
Olivier de Châlus : C’est un lieu que j’adore parce que c’est… C’est chez moi en fait, c’est ma maison.
[Générique de début]
Au cœur de Notre-Dame. Une série de podcasts par Passion Médiévistes.
Fanny Cohen Moreau : Bonjour à toutes et à tous ! Bienvenue dans cette série spéciale d’épisodes du podcast Passion Médiévistes. Je m’appelle Fanny Cohen Moreau et en général, dans ce podcast, je vous fais découvrir ou redécouvrir le Moyen Âge, cette période historique sur laquelle nous avons tant d’idées reçues et de clichés. Dans cette série d’épisodes, je vous propose d’en apprendre plus sur un monument du Moyen Âge que vous connaissez toutes et tous : la cathédrale Notre-Dame de Paris. Après la vague d’émotion qui a suivi l’incendie du 15 avril 2019 et qui a considérablement changé l’histoire de ce monument, j’avais envie de vous faire entendre des personnes qui ont consacré une partie de leur vie à Notre-Dame de Paris, soit en l’étudiant, soit en travaillant entre ses murs, soit en œuvrant pour sa future restauration. Mais dans cette série d’épisodes, l’incendie en lui-même ou la restauration ne seront pas les sujets centraux. Je souhaite vous offrir plusieurs points de vue sur ce monument et ainsi mieux comprendre son histoire médiévale, mais pas que : son importance dans notre imaginaire collectif, mais aussi des témoignages de vie et d’humanité pour que vous puissiez regarder Notre-Dame de Paris avec un œil nouveau. Et je voulais juste vous dire que depuis l’enregistrement de certaines de ces interviews, beaucoup d’annonces ont été faites au fil des mois, donc certaines réflexions seront peut-être un petit peu dépassées, mais je pense qu’elles sont quand même intéressantes à écouter.
Et justement, le premier des invités de ce podcast sera en fait notre fil rouge : Olivier de Châlus sera notre guide au fur et à mesure des différentes thématiques que nous allons aborder dans ces épisodes. Depuis 2014, Olivier de Châlus prépare une thèse sur le chantier de la construction de la cathédrale Notre-Dame de Paris. Il est guide bénévole à la cathédrale depuis 2008 et était le responsable de l’équipe des guides entre 2014 et 2019. Il est par ailleurs le porte-parole de l’Association des scientifiques au service de la restauration de Notre-Dame de Paris. Dans ce premier épisode, je vous propose de découvrir comment Olivier s’est lancé dans une thèse sur Notre-Dame de Paris alors qu’il n’avait pourtant jamais fait d’études d’histoire.
Olivier de Châlus : Notre-Dame de Paris, d’abord, c’est un lieu que je fréquente depuis des années. Ça fait onze ans que je suis guide à la cathédrale et donc j’ai voulu aller plus loin, quelque part en relation avec un objet que je connaissais. Cette église, je l’ai regardée, je l’ai étudiée, j’ai essayé de la comprendre. Et puis, au bout d’un moment, je me suis vraiment plongé dans l’histoire de sa construction. Et là, je me suis trouvé face à des énigmes et je me suis dit, ben, il faut aller plus loin. Et en réfléchissant un peu, ben, en fait, pour aller plus loin, il faut rentrer en doctorat, il faut se nourrir de ce que sait faire le monde universitaire, qui a des méthodes, qui a des outils, qui sait donner des conseils. Et donc voilà, ça a commencé comme ça. J’ai écrit à Philippe Bernardi, qui est mon directeur de thèse, avec qui je m’entends merveilleusement bien. Il avait écrit un bouquin que j’adorais. J’ai dit : « Je cherche un directeur de recherche, peut-être que vous pourriez m’aider à en trouver un ». Et puis, on s’est vus, on s’est assis sur un banc au jardin du Luxembourg, on a discuté et ça a commencé comme ça.
Je suis ingénieur et, c’est une des merveilles du système scolaire français, enfin du système universitaire français, c’est que pour s’inscrire en doctorat, il faut un bac +5. Ça, c’est bon, j’avais mon diplôme d’ingénieur. Il faut un directeur de thèse et un sujet de thèse. À partir du moment où on sait convaincre quelqu’un qui est habilité, qu’on a les compétences pour porter un sujet, et ben c’est parti.
En observant le plan de Notre-Dame de Paris tel qu’il est dessiné, tel qu’on le voit dans les livres, en fait, je me suis rendu compte que le transept, qui est la partie qui fait, la partie du plan qui fait le bras de la croix de l’église, a probablement été rajouté a posteriori. Alors, ça peut sembler une idée particulièrement saugrenue de prime abord, mais en réalité, on connaît d’une part des cas où des églises ont eu leur transept qui a été rajouté, la cathédrale de Sens est le meilleur exemple le plus connu, mais la cathédrale de Senlis également, et on peut citer également plein d’églises de cette époque qui n’en ont pas et qui n’en ont jamais eu. Donc le fait qu’il n’y ait pas de transept à Notre-Dame de Paris, c’était pas forcément une idée complètement folle et donc elle méritait d’être creusée et donc, avec cette question-là, viennent plein d’autres questions, d’abord à quoi sert un transept ! Et là, pour le coup, ben on rentre dans l’histoire de la liturgie, comment s’organisent les processions, comment s’organisent les cérémonies… Ça, c’est pas mon domaine. Par contre, moi, les questions auxquelles je pouvais apporter des réponses ou des tentatives de réponses, c’était quand est-ce que ce transept a été rajouté dans le plan de Notre-Dame de Paris, et qu’est-ce que ça a eu comme conséquences sur l’ensemble de la chronologie générale du chantier. Et donc j’ai commencé à chercher des indices dans la cathédrale pour essayer de comprendre ça. Ça, c’est un premier point. Et puis, ce point-là est venu un peu en collusion avec des observations que j’avais faites sur les voûtes, et je me suis rendu compte qu’a priori les voûtes étaient également plus tardives que ce qu’on avait supposé au départ. Et donc finalement, en faisant un petit peu le mélange de tout ça, je me suis dit, bah, il y a une nouvelle chronologie à écrire sur la cathédrale. Alors comment est-ce qu’on fait ? Alors, moi, je suis pas historien d’art et j’ai pas les compétences pour porter une réponse comme la construirait un historien d’art à ces questions. Mais ce qui m’intéresse, moi, c’est d’essayer de comprendre comment est-ce que l’homme du Moyen Âge va penser son chantier. Et contrairement à l’idée communément admise que le chantier est dirigé par un architecte qui est un artiste et qui a sa vision propre de comment est-ce qu’il veut construire son église, ben moi je suis parti de l’idée inverse qui était que finalement, pour construire un objet, si on a les mêmes niveaux de connaissances techniques que ceux d’à côté et qu’on a les mêmes accès aux ressources, eh ben finalement, si on veut construire la même chose, on va s’y prendre de la même manière. Donc je suis parti du principe que tout était à peu près homogène et ça me permet de créer des comparaisons entre les différents édifices. Alors, il faut faire la distinction entre ce qui est de l’ordre de l’art au sens du design, quelle forme on va donner à un chapiteau, tout ce qui va être lié à la décoration, à l’ornementation de l’édifice ; et puis l’aspect purement technique, quel diamètre on donne à une colonne, quelle hauteur on va donner aux arcs-boutants qui sont à l’extérieur de l’église et qui tiennent la voûte. Eh ben, ça, ce sont des questions qui sont des questions sans réponse. Et aujourd’hui, quand on ouvre des livres, on va nous expliquer que finalement chaque maître d’œuvre médiéval a sa vision de la question et va employer ses propres techniques. Moi, je suis parti du principe inverse. J’ai essayé de comparer les édifices et ça donne plein, plein de résultats.
[Intermède musical]
Fanny Cohen Moreau : Donc votre point de vue d’ingénieur est vraiment très important dans votre thèse ?
Olivier de Châlus : Alors, oui et non. D’abord, ma thèse est une thèse d’histoire et le jour où je vais soutenir ma thèse, je la soutiendrai pour être reconnu comme étant historien, pas pour être ingénieur. Ça pose plein de questions finalement. Qu’est-ce qui fait qu’on est historien ? Est-ce que c’est de travailler avec des méthodes d’historiens ou est-ce que c’est de travailler sur un objet historique, un objet au sens une question historique ? Donc il y a ça. Ensuite, l’ingénieur en BTP, qui est mon cas par ailleurs, va réfléchir, va faire des calculs pour essayer de savoir quelle dimension faut donner à un mur, mais en s’appuyant sur une batterie d’équations, sur une batterie de principes physiques qui sont complètement étrangers à l’homme du Moyen Âge et qui sont complètement anachroniques. Ça ne veut pas dire que l’homme au Moyen Âge ne fait pas de calculs. Il a des méthodes graphiques pour déterminer une largeur de nef, la dimension d’un pilier. Mais il ne va pas faire des calculs au sens où on l’entend de façon contemporaine. Et si on commence à solliciter la physique pour expliquer que finalement cette église a été déformée avec le temps et que du coup elle a été mal construite, bah non. En fait, la question, c’est est-ce qu’elle a été bien construite au sens où elle respecte les principes constructifs de l’époque. Est-ce que le pilier est dimensionné comme on dimensionne un pilier au XIIIᵉ siècle? Ou est-ce que la personne qui a construit ce pilier-là s’écarte des règles en usage à cette époque ? Et à ce moment-là, bah, le pilier peut être défaillant. Mais la question, elle est pas de juger les règles en disant, bah en fait, ils construisaient des piliers qui avaient cette dimension-là, et finalement, cette dimension-là ne résiste pas à l’ensemble de la charge de la voûte ou je ne sais quoi. C’est pas du tout ça la question. La question, c’est vraiment comment est-ce que l’homme qui est les pieds dans la boue avance sur son chantier. Moi, c’est ça que je veux faire, c’est être à côté de celui qui a les pieds dans la boue et qui se pose des questions et qui essaie de trouver des solutions pour régler ses problèmes.
Alors par chance, je suis doctorant en histoire, mais j’ai pas fait de cursus, d’études d’histoire et donc je parle pas deux mots de latin, et j’ai bien des chances de travailler sur une période et sur un objet où il n’y a pas de sources ou pas vraiment de sources. Les quelques sources qu’il y a, ont, sont bien connues et ont été très exploitées dans la littérature contemporaine. Donc je les ai en fait. Alors, après on pourrait rentrer dans une interprétation d’un mot ou d’un autre, ou d’une formulation. C’est pas, c’est pas exactement la question que je me pose. Moi, j’essaye de raccrocher à ces quelques sources écrites tout un train d’autres observations qui, elles, sont issues du bâti. Et donc la question c’est comment est-ce que cette pierre est construite et taillée, comment est-ce qu’elle est assemblée avec les autres pierres qui sont au-dessus, en-dessous ou à côté ; quels sont les liens en fait entre les différents objets… L’église est pas un objet monobloc, elle est faite d’un certain nombre de sous-ensembles, on peut dire d’ouvrages, et ces ouvrages, ils interagissent les uns avec les autres. Comment est-ce qu’on trace un plan au sol en fonction de la voûte qu’on va vouloir poser par-dessus ? Là, on a une logique d’interaction entre la façon dont on va donc dessiner au sol, par exemple l’implantation des fondations, et la façon dont on imagine l’église à terme. Et quand on pousse cette logique, qu’on va plus loin, on se rend compte que, à partir du moment où il faut peut-être 40, 50, 60 ans avant qu’on mette en œuvre les voûtes, il apparaît tout à fait logique que les fondations finalement soient pas adaptées au type de voûte qu’on a mis en œuvre in fine, parce que les techniques de voûtement ont évolué pendant ces 60 années-là. Et donc, ça, ça veut dire que, si on considère une grande église dont le chantier va s’étaler sur une période de temps assez importante, bah finalement, dans cette église, tout est anachronique, tous les éléments sont anachroniques les uns par rapport aux autres et il faut démêler tout ça.
[Intermède musical]
On n’a pas de documents écrits qui racontent le chantier. Mais comme on n’a pas de documents écrits qui racontent des chantiers contemporains. Quand un chantier se passe aujourd’hui, qu’est-ce qu’on fait ? A la fin, on collecte l’ensemble des documents, des plans, des notes de calculs, tous les éléments en fait qui correspondent à l’objet tel qu’on l’a construit finalement. Mais le processus intellectuel qui a fini par aboutir à l’objet qu’on a construit, celui-là, il est pas archivé. Et c’est là justement qu’est toute l’histoire de l’historien. Quand on veut essayer de comprendre comment un homme réfléchit, il faut comprendre quelles sont ses difficultés, qu’est ce qui change, qu’est ce qui bouge. On a tendance à dire, quand on enseigne notamment aux ingénieurs la conduite de projet, on leur dit voilà un projet, c’est un objectif commun qu’on va tous réaliser dans le même sens. Bah non, pas du tout en fait. Un projet, c’est un objectif commun qui semble être une direction, mais qui de toute façon ne sera pas l’objet qu’on finira par construire à terme. On veut construire un bâtiment qui fera treize niveaux. Et puis en fait, on se rend compte que finalement treize niveaux, on pourra pas parce qu’on n’aura pas l’argent, qu’il faudra s’arrêter à onze. Et puis du coup, pour que ce soit quand même rentable économiquement, on va rajouter des commerces au rez-de-chaussée. Mais du coup, comme c’est des commerces, il faut un espace d’échange et de raccordement aux transports publics parce que, en fait, pour que ça fonctionne bien, voilà, il faut considérer ce genre de choses. Alors, c’est des exemples très théoriques, mais l’idée est là aussi pour une église. Comment est-ce qu’une série de conciles qu’on va connaître au XIIᵉ et au XIIIᵉ siècles vont impacter de façon ponctuelle et de façon brutale la façon dont on considère l’organisation des cérémonies religieuses ? Et comment est-ce que ça, rétroactivement, ça impacte le bâti ? Et sur des chantiers qui sont tous en cours, eh ben, certains sont trop avancés pour intégrer les évolutions et certains peuvent le faire et donc vont faire l’objet d’adaptations.
Fanny Cohen Moreau : Donc, à part le bâti, quelles sont les archives sur lesquelles vous travaillez ?
Olivier de Châlus : Je ne travaille quasiment exclusivement que sur le bâti. Je n’ai pas les compétences ni en latin, ni en vieux français, ni en paléographie, qui est la capacité qu’on a ou la science qu’on développe pour savoir lire un texte avec une écriture du XIVᵉ siècle qui n’a rien à voir avec une écriture de l’époque contemporaine. Donc j’ai pas ces compétences-là qui me permettent d’aller chercher les sources. Mais en fait, toutes les églises comme Notre-Dame de Paris intéressent les gens depuis longtemps et les sources, quand elles ont été trouvées, elles sont publiées, elles sont accessibles. C’est pas là que je vais chercher le maximum d’informations. À des époques plus récentes, à partir du XIVᵉ siècle, on a vraiment des comptes de chantier qui sont très courants. Et là on arrive à savoir que couper du bois à telle période et couper des pierres ou des tuiles, ou que sais-je encore, à une autre période, et on arrive à reconstituer déjà une chronologie comme ça, en fonction des matériaux qui sont achetés et qui sont du coup mis en œuvre. Moi, j’ai pas ces sources-là. Alors probablement, si on épluche toutes les archives qu’on a en France, on trouvera des éléments complémentaires. La question, je pense, c’est pas de se dire qu’il faut éplucher toutes les sources dont on pourrait disposer, mais c’est de disposer de suffisamment de sources pour pouvoir avancer, travailler, formuler des hypothèses. De toute façon, je pense que quand on fait une thèse, que ce soit en histoire ou dans d’autres domaines, l’objectif c’est pas de produire quelque chose qui soit valable de façon absolue et qui soit vrai de façon absolue. On passe notre temps à construire des modèles. L’opposition entre le roman et le gothique est un modèle qui a ses cas d’application et ses limites d’application. L’important, c’est pas de faire quelque chose qui est largement vrai, mais on sait pas dans quelle proportion. C’est peut-être plutôt de faire quelque chose qui est partiellement faux, mais de savoir où sont les limites.
[Intermède musical]
Fanny Cohen Moreau : Quelle méthode est-ce que vous employez dans votre thèse ?
Olivier de Châlus : L’idée est d’essayer de faire des familles, d’essayer de comprendre que cette voûte qui est anachronique à ce plan, bah, finalement, elle correspond à un plan qui lui est le plus adapté. Finalement, avec un plan donné, on a un type de voûte donné, qui est particulièrement adapté, on a un type de colonne, de pilier qui va être hyper adapté, et puis des arcs-boutants aussi, dont la hauteur va être définie en fonction d’eux. Donc tout ça forme un tout, un tout cohérent. Moi, ce qui m’intéresse, c’est de réussir à analyser tout ça, à avoir les différentes générations techniques qui existent sur ces différents objets, différentes générations de plans, de voûtes, de systèmes de collecte des eaux de pluie, que sais-je encore, et de réussir à les dater. Pour ça, j’utilise des graphiques qui sont déclinés de la façon notamment dont on gère le temps sur un grand projet d’infrastructure, comme un projet de métro par exemple, qui me permet de faire des synthèses chronologiques qui sont beaucoup plus complexes que simplement prendre un plan et le colorier. Parce que c’est la façon dont on représente le temps habituellement dans un chantier d’église ou dans un chantier de bâti ancien, on prend une zone, on la colorie en rouge, en bleu, en vert, etc. En fait, c’est pas parce que les colonnes sont rouges que la voûte elle-même va être rouge, qu’elle est construite dans la même temporalité. Il se peut très bien qu’il y ait un écart de temps important entre l’un et l’autre, et le dessin d’un plan colorié ne permet pas de rendre compte de toutes ces subtilités-là. Donc j’ai mis en place un nouvel outil, qui est un outil un petit peu plus compliqué à comprendre et à appréhender, mais qui est plus efficace, qui permet de plus facilement rentrer dans certaines nuances et donc de manipuler plus facilement le temps. Sur cet outil-là, je rentre où j’applique la chronologie de Notre-Dame de Paris avec les hypothèses que je formule, etc. Et ça me permet de dater justement que tel type de voûte est employé entre telle date et telle date, que tel type de pilier est employé entre telle date et telle date. Et une fois que j’ai fait ça, en fait, je vais regarder les autres voûtes qui sont pareilles, à la collégiale de Mantes, à la cathédrale de Chartres, etc, etc. Et donc finalement, je décline un nouvel outil de datation qui est pas basé sur l’étude visuelle de l’ornementation, mais qui est vraiment un outil basé sur l’histoire des techniques. Et ensuite j’établis, je vais pouvoir établir d’autres modèles chronologiques dans d’autres édifices, puis après, ben, mettre en regard des modèles qui ont été établis par l’histoire de l’art jusqu’à présent et voir dans quelle mesure est-ce que ma théorie fonctionne ou ma théorie ne fonctionne pas.
[Intermède musical]
Fanny Cohen Moreau : On a tous malheureusement en tête les images de l’incendie du 15 et 16 avril de Notre-Dame. On ne peut pas ne pas en parler évidemment. Ça a été un bouleversement, bien sûr, pour votre thèse et j’imagine, pour votre vie. Concrètement, qu’est-ce que l’incendie a changé pour votre thèse ?
Olivier de Châlus : L’incendie de Notre-Dame de Paris, il a changé beaucoup, beaucoup de choses. D’abord, il a détruit une partie de mes sources. Ça, c’est factuel. La charpente, je l’ai étudiée. J’avais déjà analysé un certain nombre d’éléments. Il y avait des éléments complémentaires que je voulais aller soit photographier pour étayer un propos qui était déjà écrit, soit reprendre des mesures pour aller plus loin dans certaines considérations. Bon bah voilà, la source d’information, elle est plus là, ça c’est une chose. Dans cette même logique, aujourd’hui, j’ai plus accès à mon sujet d’étude. Alors, bien sûr, quand on fait de l’histoire du bâti aujourd’hui, on dispose de bases de données photographiques absolument gigantesques qui nous permettent d’aller beaucoup plus loin que ce qui était possible de faire il y a 50 ou 100 ans. Donc, j’ai encore tous ces éléments-là qui me permettent de continuer à travailler, mais je peux plus aller sur le terrain pour regarder des choses que, moi, j’ai envie de regarder. Parce qu’évidemment, quand on fait une thèse, on ouvre des sujets, on ouvre des boîtes, on ouvre des couvercles que personne n’a forcément ouverts avant soi. Et du coup, on veut aller prendre une photo ou faire une mesure dont personne n’avait eu l’idée avant. Et donc forcément, cette photo-là, on va pas très facilement la trouver sur internet. Donc j’ai un problème d’accès à mon objet d’étude, soit parce qu’il a brûlé, soit parce que j’arrive plus à y aller, parce que ce n’est plus le temps. Bon ok, ça c’est une chose.
Ensuite, bah il y a beaucoup, beaucoup de gens qui ont envie d’étudier Notre-Dame de Paris. Et là où j’étais un petit peu tranquille, je faisais mon boulot dans mon coin, au rythme qui était le mien, aujourd’hui, beaucoup de gens s’intéressent au sujet, soit parce qu’ils ont envie de lancer des projets d’études sur la question, très bien, soit parce qu’ils ont besoin des résultats. Et là, comment est-ce que je fais, moi, pour continuer à faire ma thèse sereinement, tout en donnant, en fournissant les éléments qui sont issus de ma thèse aux gens qui en ont besoin pour travailler et pour restaurer l’édifice ? Il y a ces questions-là. En fait, il y a une sorte de conflit entre le rythme universitaire d’une thèse normale et puis les besoins d’un chantier avec une forte pression politique, avec une forte pression médiatique et donc faut réussir à allier un peu les deux.
Ensuite, sur ma manière de travailler, ça change aussi beaucoup de choses parce que ce que je vais essayer le plus possible, ça va être de vendre la méthode que j’ai développée, de la valoriser à l’écrit, de la mettre en valeur, plus que finalement tout un tas de résultats, où, ben, je vais être obligé beaucoup plus d’utiliser le conditionnel parce qu’il y a des choses que, aujourd’hui, je ne peux pas vérifier, qu’on pourra vérifier à l’avenir dès lors qu’on pourra retourner dans l’église pour aller faire des mesures. Mais voilà.
Et puis enfin, j’ai été obligé d’arrêter mes recherches au 14 avril parce que je peux pas commencer à intégrer dans ma thèse l’ensemble des découvertes qui sont faites post-incendie. Et il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. Soit parce qu’on a des archives qui sont dans des fonds privés, des chercheurs américains, sud-américains, japonais, etc., qui ont travaillé sur un bout de l’édifice et qui du coup nous remontent des publications qui sont restées ou relativement confidentielles ou dont, en tout cas, moi j’avais pas eu connaissance, et il y en a beaucoup. Ou alors on se rend compte en analysant les voûtes, qui ont été percées par l’incendie du fait de la chute de certains éléments de charpenterie, que l’épaisseur de la voûte est pas la même dans toutes les parties de l’édifice ; et on se rend compte que plus on est proche de la façade, plus la voûte est épaisse, plus on est proche du chœur, c’est à dire à l’opposé de la façade, les voûtes sont plus fines. Or, la logique de la chronologie générale du chantier qui avait été proposée jusqu’alors était que les voûtes du chœur venaient avant celles de la nef. Donc la voûte venait progressivement de l’est vers la façade. C’est l’inverse de ce qu’on observe, puisque les voûtes sont beaucoup plus massives côté façade, et probablement parce que, en fait, les techniques sont un peu moins développées, ou les techniques de coffrage – donc ces grosses structures en bois qu’on met en œuvre sous les voûtes et sur lesquelles on va poser les pierres avant, ben, la mise en place définitive des voûtes – toutes ces techniques-là évoluent dans un certain rythme qui voudrait logiquement que plus les voûtes sont fines, plus elles sont récentes. Bon bah voilà, ça c’est des éléments qu’on sort du chantier, des observations du chantier, et moi je peux pas intégrer ça dans ma thèse parce que, ne serait-ce qu’aller en faire l’inventaire, ça supposerait d’être tous les jours à la cathédrale, d’être tous les jours en réunion, à suivre, à noter dans un coin. Et puis à un moment, faut fermer le rideau et dire ma thèse s’arrête à ce moment-là, je vous fournis une série d’hypothèses et surtout une méthode qui est une méthode qui est employable, qui est déclinable sur d’autres édifices, etc., et qui portera des fruits. Et ensuite, dès lors qu’on va pouvoir commencer à re-rentrer dans la cathédrale, on ira vérifier certaines hypothèses.
[Intermède musical]
Le plus dur à Notre-Dame de Paris, c’est l’étiquette Notre-Dame de Paris. C’est amusant, quand on écrit quelque chose, quand on écrit une phrase, on se rend compte que, ben, on veut pas faire de répétitions trop courantes, et donc, pour évoquer Notre-Dame de Paris, on peut parler de Notre-Dame de Paris, de la cathédrale, de l’église épiscopale, etc. Mais dans ça, il y a certains mots qui sont des noms communs, cathédrale, église épiscopale, mais Notre-Dame de Paris, c’est un nom propre en fait, il y a une étiquette, il y a un logo, il y a une marque autour de ça. Et, en fait, les deux mots sont pas synonymes. Enfin, dès lors que le terme Notre-Dame de Paris apparaît quelque part, il change la vision que les gens ont de l’édifice et la compréhension que les gens vont avoir du propos qu’on va porter. Tout le monde a été, quand je dis tout le monde, c’est à l’échelle planétaire, tout le monde a été touché par l’incendie de Notre-Dame de Paris. Ce qui veut dire que Notre-Dame de Paris correspond à une certaine réalité pour la population mondiale dans son ensemble. Ok. Et si on fait un test, qu’on prend, ben, des gens qui sont pas, prenons des gens qui sont pas européens, prenons des gens qui vivent un peu éloignés du monde occidental, et on leur met sur la table des photos d’un certain nombre de cathédrales. Et on leur dit laquelle est Notre-Dame de Paris ? Bah ils sauront pas nécessairement répondre en fait. Donc, il y a quelque chose qui résonne de ce qui est Notre-Dame de Paris dans la mentalité des gens, mais qui est pas forcément lié à l’objet. Le corollaire de ça, c’est que, finalement, cet incendie, il a des répercussions que n’aurait pas eu un incendie qui aurait pu y avoir à la cathédrale de Bourges par exemple. Et en fait ça, de façon complètement indépendante de l’impact de la perte patrimoniale où on pourrait comparer ou pas comparer, mais les deux incendies auraient pas été perçus de la même manière, et les pouvoirs politiques auraient pas répondu de la même manière, et l’implication internationale, médiatique, etc. ne se serait pas fait de la même manière, les mêmes débats n’auraient pas eu lieu à l’Assemblée nationale ou au Sénat. Donc voilà, Notre-Dame de Paris, c’est une bulle. Il y a quelque chose d’un petit peu spéculatif autour de Notre-Dame de Paris. Moi, c’est un lieu que j’adore parce que c’est, c’est chez moi en fait, c’est ma maison. Quand je discute avec des amis et qui me demandent t’es où, je leur dis que je suis à la maison, ceux qui me connaissent bien sauront reconnaître dans le ton de la voix quelle est l’adresse à laquelle je me trouve réellement, si je suis chez moi, dans mon appartement, ou si je suis chez moi, dans ma cathédrale.
Et en fait, finalement, quand on commence à travailler sur Notre-Dame de Paris, tout le monde dit : « Ah oui, mais Notre-Dame de Paris, c’est le monument des monuments, c’est compliqué de travailler là-dessus etc. ». D’ailleurs, mon directeur de thèse au départ m’avait dit « mais non mais oh, c’est pas très, très, très, très stratégique de s’intéresser à Notre-Dame de Paris, mieux vaut commencer par travailler sur des sujets qui sont plus neutres pour pouvoir faire un petit peu son trou, faire sa place et tester ses idées de façon moins passionnelle ». C’est sûr. Le problème, c’est que c’était l’église qui était à côté de chez moi et que j’allais pas étudier la cathédrale de Bourges. Elle est loin de chez moi. Elle m’intéresse tout autant, mais elle est loin de chez moi. Et puis, bah quand on dit aux gens qu’on travaille sur Notre-Dame de Paris, tout de suite ça intéresse, ça interpelle. Et si j’avais, moi, un conseil à donner à des, à des jeunes doctorants ou des gens qui se posent la question de s’engager en doctorat, je leur dirais « réfléchissez bien, trouvez pas un sujet qui vous isole en fait ».
Moi, Notre-Dame de Paris, elle m’a ouvert des portes. Je me suis retrouvé à travailler sur un film d’animation sur Notre-Dame de Paris. Ça fait trois ans ou quatre ans, donc bien avant l’incendie. J’ai pu participer à des embryons de projets de recherche sur la pyramide de Khéops parce que j’ai été mis en contact via des amis avec des équipes de Dassault Systèmes qui ont travaillé sur cette question, et en fait, ça se passe, c’est simple, deux personnes discutent : « Ah ben tiens, tu travailles sur la pyramide de Khéops ? J’ai un ami qui travaille sur Notre-Dame de Paris », et tout de suite le contact se fait. En fait, la mise en contact est facile pour ça. Alors que, bah, on aurait dit que si j’avais travaillé sur la cathédrale de Meaux, ça n’aurait rien donné du tout. Donc il y a quelque chose de tout à fait chimérique dans Notre-Dame de Paris.
Finalement, je suis arrivé à la Sorbonne, j’étais ingénieur. Lorsqu’il a fallu que je m’inscrive en thèse, j’ai dû fournir un certain nombre de papiers, et parmi les papiers, il y a mon relevé de notes du bac. Tiens, ce document date d’il y a quinze ans. Où est-ce que je vais retrouver ça ? Par chance, je l’ai retrouvé et du coup j’ai fourni un papier qui disait ben oui, oui, je m’inscris en doctorat d’histoire, et oui, oui, j’ai eu sept en histoire, et j’ai eu sept en philo, et j’ai eu six en français. Évidemment, il faut s’y faire en fait, faut se mettre dans cette nouvelle peau, faut l’accepter. Et par rapport à ça, j’ai aussi eu la chance de travailler dans un laboratoire où les doctorants sont très soudés les uns les autres, et il y a des activités qui sont organisées pour discuter autour de nos recherches, etc. Et je crois que j’ai commencé à me sortir, me sentir véritablement historien le jour où les autres doctorants du LAMOP [NDLR : Laboratoire de médiévistique occidentale de Paris] m’ont demandé en fait de leur faire part de mes, de mes recherches et là, pour une première fois, j’ai vu des historiens qui sont des historiens calibrés, normalisés, tamponnés, certifiés, etc., qui se sont intéressés à mon sujet, qui ont réagi sur mon sujet, et qui ont compris mon sujet, qui ont voulu en savoir plus, et qui m’ont admis, pas par la personne que j’étais, mais par le travail que j’étais en train de leur exposer. Et puis après, il y a eu un petit cheminement qui a dû se faire parce qu’il y a quelque chose de l’ordre de la conversion où finalement je me suis rendu compte que là, j’avais des racines que j’avais pas sollicitées jusqu’alors. Et puis aujourd’hui, je me sens plus historien qu’ingénieur, même si j’ai quinze ans de boulot dans les pattes. En tout cas, j’ai fait plus d’histoire, d’études d’histoire, d’années d’études d’histoire que d’années d’études en ingénierie.
[Intermède musical]
Fanny Cohen Moreau : Dans le prochain épisode de cette série de podcasts, Olivier de Châlus vous parlera encore de sa thèse et vous racontera ce qu’il sait de la construction de Notre-Dame de Paris au Moyen Âge et sur comment il travaille pour comprendre ses évolutions.
Merci à Clément Nouguier pour le générique de cette série. Merci à Din pour l’illustration et merci aux personnes qui soutiennent Passion Médiévistes sur Tipeee, qui ont permis le financement de cette série.
[Générique de fin]
Olivier de Châlus : Avant la cathédrale, on n’est pas, entre guillemets, dans la pampa.
Merci à Luc pour la transcription et à Maud pour la relecture !
Épisode 2 : La construction de la cathédrale Notre-Dame de Paris

Dans ce deuxième épisode, Olivier de Châlus vous raconte la genèse de la construction de Notre-Dame de Paris. Il explique comment a été fait le choix de son emplacement, et comment il a fallut enlever et délocaliser ce qui était déjà présent sur le site, comme des églises ou des sites laïcs.
Pour construire la cathédrale, on utilise des coffrages pour les arcs et autres arcs boutants, mais aussi des grues et des brancards pour transformer les matériaux. Pour connaître cette histoire et visualiser comment était organisé un chantier, il est possible de s’appuyer par exemple sur les représentations iconographiques des enluminures ou les vitraux. Mais on ne peut pas totalement s’y fier, car ce serait oublier les contraintes techniques et matérielles auxquels étaient soumis les maîtres verriers et enlumineurs.
Le chœur est une des premières étapes de construction, puis la nef, la façade, et enfin le transept. Mais Olivier de Châlus cherche à comprendre les aspects liés à la logistique de chantier permettant d’écrire une histoire plus complexe de cette construction.
Dans l’épisode, Olivier de Châlus raconte qu’il aime particulièrement à travers sa thèse travailler sur l’homme, essayer de se mettre à la place de quelqu’un du Moyen Âge pour comprendre sa pensée et donc son ouvrage. Il est difficile de savoir qui sont les personnes qui ont travaillé sur la cathédrale, mais Olivier de Chalus raconte l’anecdote du voleur anglais et de l’incendie de 1218 de Notre-Dame de Paris, qui peut donner des indices sur les étapes d’avancement du chantier.
Olivier de Châlus : Mon travail, c’est de rentrer dans la tête de quelqu’un qui est mort il y a 800 ans et d’essayer de comprendre comment il pensait.
[Générique de début]
Au cœur de Notre-Dame. Une série de podcasts par Passion Médiévistes.
Fanny Cohen Moreau : Bonjour à toutes et à tous ! Bienvenue dans ce deuxième épisode de la série spéciale sur la cathédrale Notre-Dame de Paris du podcast Passion Médiévistes. Après nous avoir parlé de pourquoi il a voulu faire une thèse sur le monument dans l’épisode 1 et de ce qu’il souhaite démontrer, je vous invite d’ailleurs à l’écouter si ce n’est pas encore fait, aujourd’hui, Olivier de Châlus va nous parler de ce qu’on sait ou de ce qu’on peut deviner sur l’histoire de la construction de la cathédrale. Pour commencer, Olivier de Châlus raconte comment est né le projet d’une construction d’une cathédrale sur l’île de la Cité à Paris.
Olivier de Châlus : Alors, le projet d’une cathédrale sur l’île de la Cité, il y en a eu plusieurs, certainement, puisque on suppose que la première cathédrale sur le site de Notre-Dame date du, peut-être de, de la fin de l’Antiquité. Il y en a probablement eu plusieurs successivement. La cathédrale actuelle est bâtie à partir du début des années 1160. On sait qu’elle a été construite à l’instigation de l’évêque Maurice de Sully. Il est élu évêque en 1160. Et on sait de sources écrites qu’en 1163 les travaux ont démarré. Ça nous donne une fourchette assez courte de démarrage des travaux, ce qui est vraiment une référence intéressante.
Alors, contrairement à ce que l’époque moderne a pu nous dire, ce n’est pas nécessairement le pape Alexandre III qui a posé la première pierre de Notre-Dame de Paris, qui est une légende qui aurait figé du coup le démarrage des travaux en 1163, période à laquelle il était à Paris. Mais bon, on n’est pas très loin finalement de cette très courte fourchette chronologique, donc 1160-1163.
Alors, pourquoi Maurice de Sully lance le chantier d’une nouvelle cathédrale ? Là, on n’a pas d’éléments historiques qui nous permettent, quand je dis historiques, d’éléments écrits qui nous permettent de répondre à cette question, on est obligé de formuler des suppositions. Alors, les suppositions, elles peuvent être assez nombreuses. La première, qui est souvent évoquée, c’est une idée de mise en valeur de l’évêché. La cathédrale est le vaisseau amiral, si je puis dire, d’un évêché. C’est le, c’est le symbole, c’est l’emblème, c’est le point central. Et donc c’est la marque, c’est la maison commune et c’est le symbole du pouvoir de l’évêque. Donc, certains historiens, certains historiens d’art évoquent volontiers l’idée que la cathédrale puisse être construite dans une dynamique de compétition avec les évêchés qui sont attenants, voire qui sont plus loin. Donc, il y a une logique de rayonnement. Cette question-là, on peut la retourner différemment parce qu’en fait on a, on n’a pas de traces écrites qui nous permettent d’affirmer qu’il y a véritablement compétition entre les évêchés. Par contre, ce qu’on sait, c’est qu’il y a des problèmes juridiques au sein même de l’évêché de Paris dans cette période-là, et c’est probablement le cas dans d’autres évêchés. Et donc l’évêque a probablement besoin d’affirmer son pouvoir. On est à la suite de la réforme grégorienne et de la querelle des Investitures, donc, peut-être que l’évêque a le plus besoin maintenant, qu’il n’avait ce besoin par le passé, d’affirmer par lui-même son pouvoir et le fait de construire une grande église, très notable, très remarquable, c’est aussi une manière peut-être pour lui de dire, ben, en fait, c’est moi le chef, vous pouvez pas faire sans moi. Donc ça, c’est un élément : la question du pouvoir, la lutte de pouvoir ou de l’affirmation du pouvoir.
Ensuite, il y a une autre question qui est une question liée à l’usage de la cathédrale. Et en fait, on ne sait pas vraiment comment s’organise une cérémonie au milieu du XIIᵉ siècle et quelles sont les spécificités d’une liturgie cathédrale, si ce n’est qu’il y a évidemment un chapitre et que ce chapitre se réunit pour les offices quotidiennement, plusieurs fois par jour, selon les périodes liturgiques. Mais qu’est-ce qui se passe autour ? Est-ce qu’on a beaucoup de messes privées ou pas dans la cathédrale à ce moment-là ? Quelles sont l’ensemble des reliques qui sont des raisons de pèlerinage et donc de venue de foules à Paris et qui pourraient aussi expliquer la taille de la cathédrale ? Enfin, il y a beaucoup de questions.
[Intermède musical]
Avant la cathédrale, on n’est pas entre guillemets dans la pampa. On est à Paris, sur l’île de la Cité, qui est quand même une zone urbaine qui est défendue par la rivière, et les ponts qui donnent accès à l’île de la Cité sont fortifiés d’un côté par le Petit Châtelet et de l’autre côté par le Grand Châtelet. Enfin, on est dans une zone qui est fermée, qui est protégée et qui est donc très, très dense d’un point de vue urbain. Et l’est de l’île de la Cité, et le quartier épiscopal au sens large, au sein duquel on va trouver évidemment le palais de l’évêque, on va trouver ce qu’on appelle le cloître, alors c’est pas le cloître d’une abbaye où il y a une petite fontaine au milieu et puis une cour carrée où on déambule, le cloître, c’est la zone urbaine où vivent les chanoines. Les chanoines sont les prêtres qui sont attachés au service liturgique de la cathédrale et qui assistent l’évêque dans le gouvernement de son diocèse. Et donc ils vivent dans ce cloître qui fait grosso modo, il couvre la surface qui part de la façade de la cathédrale et qui va jusqu’à la Seine au nord et jusqu’à la Seine à l’est. C’est une grosse surface, alors un petit peu plus petite à l’époque qu’aujourd’hui, parce que la Seine a été canalisée. Mais voilà, il y a une grande aire qui correspond au cloître. Ensuite, on va trouver un baptistère, une église où on baptise les gens. On va trouver évidemment un Hôtel-Dieu où on accueille les pauvres, les malades, les pèlerins, et puis on va trouver des églises.
Alors là, on est confronté à un problème qui est que des églises, il y en a un certain nombre. On ne sait pas à quoi elles servent exactement. On sait notamment de traces, enfin de sources écrites du début du XIIᵉ siècle, qu’il y avait deux églises, une qui était dédiée à sainte Marie, une autre qui était dédiée à saint Étienne. Et des fouilles archéologiques nous ont permis de proposer certaines hypothèses sur leur positionnement. Est-ce que c’était une cathédrale double, donc deux églises qui se distribuaient l’activité liturgique de la cathédrale ? Est-ce qu’il y en avait une qui était totalement en ruine et donc le culte était dans une seule ? Ça, on ne sait pas. Mais finalement, on a quand même un ensemble de petits bâtiments qui répondent à toutes les fonctions de l’Eglise. Cet ensemble de bâtiments, on appelle ça un groupe épiscopal. Et Maurice de Sully va libérer des terrains, détruire un certain nombre de bâtiments pour construire une église qui, en termes de dimensions, est absolument sans comparaison possible avec ce qui a pu précéder.
On considère habituellement que la fin du XIIᵉ siècle et tout le XIIIᵉ siècle est l’époque des grandes cathédrales, qu’on appelait les cathédrales gothiques, et que là on a un élan qui est sans proportion avec ce qu’il y avait avant. Oui et non. La plus grande église du monde, jusqu’à la construction de Saint-Pierre de Rome, c’est Cluny III, l’abbatiale de Cluny, et elle, elle est construite quasiment 100 ans avant Notre-Dame de Paris. Elle fait les mêmes dimensions en largeur, en hauteur, mais elle fait 187 mètres de long pour 130 pour Notre-Dame, donc elle est 50% plus, plus longue que Notre-Dame de Paris. Après, ça, c’est la considération purement technique et mesurée. Mais il faut pas avoir Cluny III comme étant un objet complètement isolé. Si on prend la prieurale de la Charité-sur-Loire par exemple, dont le chantier est tout début XIIᵉ, elle fait 130 mètres de long, donc elle fait la même taille que Notre-Dame de Paris.
En fait, si les cathédrales sont très grandes à la fin du XIIᵉ et au XIIIᵉ, c’est parce que les cathédrales précédentes sont petites, mais pas nécessairement les églises. En fait, il y a beaucoup d’églises monastiques qui sont absolument gigantesques et qui sont antérieures à l’élan de toutes ces cathédrales. Et puis, il faut bien avoir en tête que derrière un chantier de cathédrale, il y a pas une personne en fait. On a tendance à simplifier les choses en disant, derrière un chantier, il y a un évêque. Alors déjà, il y a pas un évêque, il y a en réalité une fabrique. Une fabrique, c’est l’association de l’évêque et du chapitre, parce que les deux, je dirais les deux entités administratives que sont l’évêque, au sens personne morale, et le chapitre, ces deux personnes-là ont un intérêt dans la construction de la cathédrale, intérêt au sens administratif, au sens économique, au sens du pouvoir juridique, etc. Donc ces deux entités s’associent, créent une entité particulière qu’on appelle une fabrique, qui va être dotée de moyens humains, juridiques, financiers pour pouvoir mener à bien le projet. Et cette fabrique, elle va être évidemment en interaction avec d’autres formes de pouvoir ou de formes de financement. Donc on a des églises monastiques, on a des églises cathédrales et il faut les mettre en résonance aussi, ou en comparaison, avec les objets de même nature. Alors, en termes de cathédrale, Notre-Dame de Paris est un objet complètement exceptionnel. Elle va être plus grande que les autres, pas forcément extrêmement plus longue que les autres, parce que la cathédrale de Chartres, par exemple, précédente, celle du milieu du XIIᵉ, avait des dimensions comparables à Notre-Dame de Paris. Mais par contre, c’est la seule église à cette époque qui a une nef et deux bas-côtés de chaque côté, sur une longueur aussi importante, avec des tribunes qui conduisent à une hauteur sous voûte aussi importante, etc. Donc la cathédrale de Paris est une cathédrale extraordinaire.
Et là encore, la question se pose de pourquoi à Paris. On peut très bien évoquer le fait que Paris est une ville de premier ordre d’un point de vue démographique, d’un point de vue économique. C’est vrai. Mais l’évêché de Paris est suffragant de l’archevêché de Sens, c’est-à-dire que le chef de l’évêque de Paris, c’est l’archevêque de Sens. D’un point de vue de la hiérarchie ecclésiastique. Et pourtant, la cathédrale de Paris est beaucoup plus importante que la cathédrale de Sens. Mais il y a des jeux de résonance entre l’archevêque de Sens, qui est archevêque de Sens va par moment avoir une évolution de carrière, notamment Guillaume aux Blanches Mains, qui est archevêque de Sens à cette époque, devient ensuite archevêque de Reims. Quand on est évêque de Paris, au XIIᵉ, au XIIIᵉ, au début du XIVᵉ, et j’ai pas fait l’exercice après, mais on meurt évêque de Paris. Ça veut dire qu’on est à l’apogée d’une carrière, même si d’un point de vue de la hiérarchie ecclésiastique, on n’est pas au plus haut de ce qu’on pourrait imaginer, et en fait, on est quand même à l’apogée de quelque chose. Ce quelque chose, il faudrait réussir à l’analyser plus en finesse, à le définir plus en finesse. Donc, la cathédrale de Paris est pas la cathédrale du premier évêque venu. Et donc ça, ça peut compter aussi dans la justification de pourquoi est-ce que cette église va être aussi exceptionnelle.
[Intermède musical]
Donc, le chantier commence en 1160 ou 1163, très peu de temps après l’élection de Maurice de Sully. Donc, il y a certainement un élan, une volonté très ferme de démarrer quelque chose. La première chose qu’il faut pour construire une église comme Notre-Dame de Paris, évidemment, c’est la place. Il faut de la place, il faut démolir des bâtiments. Il faut avoir en tête qu’on construit pas Notre-Dame de Paris dans un champ. Et ça, ça veut dire que, et bah, il y a des contraintes urbaines en termes d’approvisionnement, en termes d’espace urbain, mais aussi en termes de foncier, de maîtrise foncière. Au Moyen Âge, on vient pas dire : « Bon, là je vais construire une cathédrale. Tous les gens qui êtes là, qui avez vos maisons, vos boutiques, etc., vous dégagez. » C’est pas comme ça que ça se passe. On a des transactions foncières qui peuvent être parfois longues, soit entre l’évêque et son chapitre, ou, ça pourrait arriver, c’est pas le cas à Paris, mais entre l’évêque et le roi de France. Mais c’est parfois aussi le cas entre l’évêque et des particuliers qui possèdent une maison. Donc il faut faire la place. Ça, c’est la première chose, il faut démolir évidemment les bâtiments qui se trouvent sur le terrain futur de la cathédrale.
Et puis ensuite, il faut réaliser une opération qui est très délicate, qui est souvent complètement oubliée dans l’historiographie, c’est la réalisation des fondations. C’est oublié pour plusieurs raisons et la première étant évidemment qu’on ne les voit pas. Mais ça a une importance particulière parce qu’ensuite, quand on va dater l’édifice, ou quand on va construire le modèle chronologique qui nous permet d’avoir des références, ben il faut bien imaginer que quand on pose la première pierre de Notre-Dame de Paris, on n’enlève pas des ronces et on pose la première pierre d’une colonne. Ce que je veux dire par là, c’est que la colonne, elle date pas de 1160 à 1163, pas nécessairement en fait. Avant, il faut creuser un trou. Et ce trou, il est extrêmement ouvrageux. En faisant des analyses qui sont basées sur quelques textes de l’époque moderne, sur des données géologiques qu’on a du secteur, etc., on arrive à estimer la profondeur des fondations de Notre-Dame de Paris à neuf mètres de profondeur. Neuf mètres, c’est beaucoup, c’est une maison de deux étages. Et en fait, comme il va falloir creuser à chaque fois avec des trous qui ont des, qui ont des talus pour maintenir les terres, ça fait excaver en fait une très, très grande surface. Imaginez qu’on creuse, à la pelle et à la pioche et sans brouette, la surface d’un terrain de foot sur une profondeur d’une maison d’un rez-de-chaussée plus deux étages. En fait, c’est un travail qui est monstrueux.
Quand on creuse à neuf mètres de profondeur, il y a les problèmes qui viennent avec. Le premier problème, c’est que quand on creuse, on creuse pas pour faire un trou, on creuse pour faire un trou et après le reboucher. Ce qui veut dire que toute la terre qu’on va sortir de ce trou-là, il va falloir la stocker quelque part pour pouvoir ensuite la remettre en place. On va finalement créer des gros piliers maçonnés pour réaliser les fondations et ensuite on va combler les trous. Et donc ça veut dire que, dans la mécanique générale de l’organisation du chantier, il va falloir qu’on ait des espaces qui sont dégagés pour stocker les terres le temps qu’on réalise les fondations, pour rebasculer ensuite les terres pour reprendre le chantier des fondations à l’endroit où étaient stockées les terres avant. Donc en fait, il y a un jeu de trictrac qui est un petit peu compliqué.
Ça, c’est quand on regarde les choses en plan. Quand on regarde les choses verticalement, l’objectif de réaliser des fondations, c’est d’aller poser la cathédrale sur un sol qui est dur, c’est de trouver un terrain qui va pouvoir résister à la charge importante que représente la cathédrale. Et ce terrain, il a neuf mètres de profondeur et ce sont les, un terrain géologique qu’on appelle les alluvions anciennes de la Seine. Alors, ce terrain porte bien son nom. On est dans des terrains alluvionnaires anciens, mais on est au niveau de l’eau et la Seine est à, euh, 40 mètres. Donc en fait, quand on creuse, rapidement on est dans l’eau. Alors aujourd’hui, la Seine, elle est régulée. Mais au Moyen Âge, évidemment, l’été, la Seine était beaucoup plus creuse et elle était vraiment affleurante au niveau des alluvions anciennes de la Seine ; et au printemps, à l’automne, elle était d’un débit plus important, donc il fallait creuser dans l’eau, si on le pouvait, et à l’hiver, c’était encore pas possible. Et ça, ça doit être aussi mis en parallèle avec le fait que la Seine est probablement le premier vecteur d’approvisionnement du chantier. Donc, les pierres pour réaliser les fondations, on peut les emmener au printemps et à l’automne, mais on peut les mettre en œuvre dans les trous peut-être seulement l’été. Il y a un jeu d’organisation de travaux qui est saisonnier et qui doit être extrêmement compliqué.
La Seine est en même temps la chance de Paris parce que, et la chance de Notre Dame de Paris, parce qu’elle va pouvoir permettre les approvisionnements, mais elle en est évidemment aussi le danger. Et on connaît également des périodes de crues à cette époque, à la fin des années 1190 par exemple, où la Seine va emporter des ponts. Donc la dimension logistique qui est assurée par les ponts, elle est aussi coupée pour permettre la gestion du chantier. Enfin, ça, c’est le cas de Notre-Dame de Paris, mais on pourrait citer évidemment beaucoup d’autres églises dont les chantiers, ou d’autres constructions dont les chantiers se déroulent à proximité des rivières. Et là, on n’est pas du tout spécifiquement dans une contrainte parisienne.
Le déroulé du chantier de la cathédrale, il va être calibré par d’abord des étapes qui sont des étapes liturgiques. On va reconstruire Notre-Dame de Paris, ça a des incidences sur le palais épiscopal, ça a des incidences sur l’Hôtel-Dieu, ça a des incidences sur le cloître, sur certaines églises qu’il y avait là auparavant, qui vont être démolies, déplacées, reconstruites, etc. Mais l’hôpital, on peut pas le raser et attendre d’en reconstruire un autre. Il faut toujours qu’il y ait un hôpital en fonctionnement, avec un nombre de lits qui soient là, disponibles pour accueillir des malades et des pèlerins qui de toute façon viennent. La cathédrale, c’est la même chose. On peut pas se permettre une interruption de l’activité liturgique. Et j’aurais tendance à dire surtout pas, parce que justement, la cathédrale est le symbole du pouvoir de l’évêque. Si pendant des dizaines et des dizaines d’années, il y a plus de culte à la cathédrale, ça marche pas.
Donc, une première manière de considérer le déroulement du chantier, c’est de se dire qu’on va avoir des terrains qu’on va dégager, on va pouvoir commencer à construire la cathédrale, en l’occurrence par le chœur, ce qui est souvent le cas, dans l’idée de disposer d’un espace liturgique dans lequel on va pouvoir transférer le culte cathédrale qui aura été soit délocalisé, soit cantonné dans un édifice antérieur ou dans une partie d’édifice antérieure. Ça veut dire que, dans un premier temps, on a probablement l’église, alors soit Saint-Étienne, soit Sainte-Marie, en tout cas, l’église qui était sous le parvis actuel, partiellement sous le parvis, dont on voit les marques de l’emplacement qui sont représentées par des petits pavés qui dessinent des motifs sur le, sur le parvis actuel, le culte était probablement là jusqu’en 1182, date à laquelle le culte a été transféré dans le chœur de Notre-Dame de Paris. Et là, le chœur de Notre-Dame de Paris devient opérationnel. Et l’ancienne église va pouvoir être à ce moment-là démolie. Donc, on termine de dégager des terrains qui vont pouvoir permettre de construire la partie occidentale de la nef de Notre-Dame de Paris et la façade. Et donc ça met en lumière le fait qu’il y a une co-activité entre l’activité liturgique et le chantier.
Ensuite, comment on construit très concrètement. Et là, si on commence à s’approcher du geste, on utilise évidemment des coffrages, des cintres, qui sont des structures en bois sur lesquelles on va construire les arcs ou les arcs-boutants, ou tout un tas d’objets, d’arcades. On va utiliser des grues, on va utiliser des moyens de, pour transporter des pierres. Alors pas encore la brouette, a priori, la brouette apparaît un petit peu plus tardivement, mais des traîneaux, des brancards pour transporter des matériaux. Et le problème c’est que là, on est très, très orphelin, parce que, on sait pas en fait, on sait pas comment étaient les grues, on sait pas comment étaient les coffrages. Or le coffrage, lui, il donne la forme de la voûte. La voûte n’est que l’empreinte d’un coffrage. Donc pourquoi est-ce qu’une voûte a une forme donnée ? Bah, elle a une forme donnée parce qu’en fait on construisait un coffrage de cette manière-là et il est très probable que, en fait, ce qui est déterminant, c’est pas nécessairement la forme qu’on veut donner à la voûte, mais c’est le coffrage qu’on peut fabriquer. Donc, il nous manque tout un tas d’éléments pour pouvoir véritablement analyser et modéliser la façon dont le chantier va se, va se dérouler.
Les grues, bien évidemment, sont très très importantes. On déplace pas une grue comme ça, ça se déplace pas comme une brouette. Et donc une fois qu’une grue est à un endroit, elle va déterminer la capacité à construire une partie de l’église et puis ensuite il va falloir peut-être la démonter et l’emmener à un autre endroit. On a des représentations dans des manuscrits, on a des représentations dans des vitraux, mais c’est des, ce sont des illustrations qui sont difficiles à interpréter. D’abord, il y a un cadre, qui est le cadre de l’enlumineur ou le cadre du maître verrier, qui a ou pas de la place pour représenter toute une idée et qui va être obligé peut-être de la transformer pour la faire entre guillemets rentrer dans la case. Ensuite, il y a les contraintes purement matérielles qui font que probablement, ben, on peut pas représenter une grue de la même manière dans un vitrail que dans une enluminure. Mais ce qui veut aussi dire qu’on la représente pas exactement dans l’enluminure comme elle est en réalité.
[Intermède musical]
Et alors, les grandes étapes. Maintenant, si on se positionne un peu à l’échelle macro de réalisation de la cathédrale, c’est d’abord la construction du chœur et le fait de rendre le chœur opérationnel, on est en 1182, donc ça prend 22 ans à peu près. Ensuite viendra la nef, ensuite viendra la façade, puis vient ensuite la réalisation du transept. Mais si on veut rentrer un tout petit peu plus dans le détail, est-ce que la voûte, elle est construite dans le même temps que les colonnes, ou est-ce que la voûte du chœur, elle est construite plus tardivement que le chœur et elle est construite en même temps que la nef, il y a tout un tas de logistique de chantier, des aspects liés à la logistique de chantier qu’on a du mal à éclairer aujourd’hui. En fait, la seule source d’information qu’on ait, c’est le bâti. Il faut regarder le bâti, regarder le bâti, il faut vraiment fréquenter ses sources en allant sur le terrain, en regardant et en se laissant convaincre plus par ce qu’on voit que par ce qu’on lit en fait.
Le nombre d’ouvriers qu’il y a sur un chantier de cathédrale est compliqué à évaluer. Certains vont parler de quelques dizaines de personnes, d’autres vont parler de milliers de personnes. Je pense qu’on n’a pas beaucoup beaucoup d’ouvriers sur le chantier, mais il faut aussi avoir en tête que, au-delà du chantier, il y a des sites industriels qui vont produire, une carrière produit des pierres. Et les pierres, elles sont pré-taillées, pré-dégrossies en carrière, ça évite de transporter une masse dont on n’a pas besoin. Le coût d’une pierre sur le chantier, ça peut être jusqu’à 20 % de matériau et 80 % de transport. Donc si on dégrossit, si on taille la pierre directement en carrière, on va transporter que ce dont on a besoin, on fait des économies qui sont substantielles. Et puis après ça évite d’avoir à gérer plein de petits baraquements de chantier au milieu du chantier et de générer des déchets qu’il faut ensuite évacuer. Donc il y a beaucoup d’avantages à faire produire des matériaux ou à préparer des matériaux à l’extérieur du chantier. C’est vrai pour la pierre, c’est vrai évidemment pour tout un tas de pièces de métal, c’est vrai pour les vitraux, c’est vrai pour plein de choses. Donc, il y a le site de production avec peut-être quelques dizaines de personnes, puis il y a d’autres personnes qui gravitent autour. Et ça, ça peut évidemment varier en fonction des saisons, en fonction des phases de travaux, en fonction de tout un tas de contraintes. Si on a qu’une seule grue pour lever les pierres, évidemment, c’est plus compliqué que si on travaille de plain-pied et que là on peut faire travailler beaucoup de gens en parallèle. À partir du XIVᵉ siècle, on a des comptes de travaux qu’on peut exploiter et à ce moment-là, on sait d’abord qu’on paie tel matériau avant tel autre et donc qu’on va les utiliser probablement avant tel autre. Donc, ça nous permet de savoir relativement quand est-ce qu’on va poser la charpente par rapport aux pierres de maçonnerie ou à l’achat des vitraux, ou ce genre de choses, et de récupérer des indices chronologiques ou des comparaisons chronologiques. Et puis évidemment, dans ces comptes de travaux, par moment, on a des effectifs qu’on peut estimer parce qu’on sait combien de personnes sont payées, par moment. Mais bon, là, je parle du XIVᵉ siècle et la période qui nous intéresse, c’est le milieu du XIIᵉ, la fin du XIIᵉ. Donc en fait on est 150 ans avant et je sais pas dans quelle mesure les deux époques sont tout à fait comparables. Ce sont des sujets qu’il faudra étudier par la suite.
Le plan initial, on le connaît pas bien, mais on peut se rendre compte, quand on regarde attentivement la cathédrale, que certains objets ont été rajoutés, modifiés, bricolés, bricolés entre guillemets évidemment. On le voit à petite échelle. Après, si on commence à réfléchir à plus grande échelle, il y a vraiment des questions intéressantes qui se posent. Par exemple, on sait que les façades du transept, donc qui est la partie du plan de l’église qui forme le bras de la croix, datent du milieu du XIIIᵉ siècle, alors qu’on suppose depuis le XIXᵉ siècle que le transept, lui, a été construit juste après le chœur, donc dans les années 1170-1180. Pourquoi est-ce qu’on modifie les façades initiales ? Pourquoi est-ce qu’on aurait modifié les façades initiales ? On sait pas bien. Mais si on commence à se pencher un peu plus sur l’analyse du transept, on a beaucoup d’éléments qui nous laissent à penser que ce bras de la croix, il a été rajouté a posteriori dans une cathédrale qui n’était pas prévue pour avoir cet espace. Et on peut comparer ça avec l’absence de transept qu’il y a à la cathédrale de Bourges, mais dans de très grosses églises comme on peut avoir aussi à Mantes. Et il a été rajouté, notamment à la cathédrale de Sens et à la cathédrale de Senlis. Donc là, on a quelque chose qui vient dans un contexte historique qu’on connaît par ailleurs, et le pourquoi on rajoute un transept doit être posé considérant la fonction de cet espace. Et là on retombe dans un problème qui est récurrent, qui est à quoi sert un transept d’un point de vue liturgique. Est-ce que c’est un objet qui a une fonction liturgique, ou pas ? Et en fait, même en creusant un petit peu plus loin, on tombe dans des problèmes de sémantique. Parce que le transept de Notre-Dame de Paris, comme beaucoup d’autres, a une grosse porte au nord, une grosse porte au sud. Mais le transept de la cathédrale de Noyon n’a pas de porte en fait. Donc l’espace qui a été construit à Notre-Dame de Paris sert probablement à organiser des processions, ce qui est pas le cas à Noyon. Alors, est-ce que le terme de transept, il peut être communément utilisé pour les deux espaces ou est-ce que les deux espaces qui ont la même forme mais des fonctions différentes doivent être appelées vraiment différemment ? Donc voilà.
Mais ce qu’il faut comprendre, c’est que cette église, elle est pas construite par une personne qui a une vision à l’origine en disant : « Voilà, Notre-Dame de Paris, je la veux comme ça et c’est ça qu’on va faire et c’est tout. » Et après, on va la construire en apportant quelques modifications cosmétiques, de l’ordre de l’esthétique, de la, ce qu’on appelle la modénature, c’est-à-dire tout ce qui est lié au décor. Ou est-ce qu’il faut considérer que cette église, elle part avec une idée au départ et puis que cette idée, elle va être modifiée, modifiée, modifiée tout au cours du temps du chantier ? Si on regarde un chantier contemporain, c’est comme ça que ça se passe. On archive pas les données intermédiaires qui permettent de savoir quelles ont été les étapes successives qui conduisent à construire finalement ça. Mais un projet de construction, c’est, je pense, ça consiste à avoir une idée au départ et construire quelque chose à la fin qui n’a peut-être pas grand chose à voir.
[Intermède musical]
Quand j’ai débuté ma thèse, mon directeur de thèse m’a dit : « Vous pouvez bien étudier ce que vous voulez, mais si vous oubliez l’homme, vous n’avez rien compris. ». Et quand on a des noms de personnes du Moyen Âge, en général, on sait pas forcément… Soit, soit on a des ecclésiastiques ou des grands noms de la bourgeoisie qui nous permettent d’avoir des repères et on sait à peu près qui sont ces gens et ils interagissent très ponctuellement avec la réalisation d’un chantier, ou on sait qu’ils sont impliqués dans ce chantier-là, et on n’a pas de détails de ce qu’ils font au quotidien. Donc la question, elle est de connaître, comprendre et aller toucher l’homme. Moi, mon travail c’est pas de décrire une cathédrale, c’est pas de la remettre dans un ordre chronologique donné, même si ça en prend la forme. Mon travail, c’est de rentrer dans la tête de quelqu’un qui est mort il y a 800 ans et d’essayer de comprendre comment il pensait.
Alors, parmi les gens dont on entend parler, en général, on a quelques noms, mais on sait pas vraiment quelles étaient leurs attributions sur le chantier, qu’est-ce qu’ils faisaient, quand est-ce qu’ils vivaient précisément. Et puis souvent, les noms sont d’ailleurs supposés. Et puis de temps en temps, on a des personnages qui sortent du lot et qui sont des personnages qui normalement ne devraient même pas être dans les traces écrites liées à la cathédrale. Je pense à un événement qui s’est passé en 1218. Alors pour comprendre cet événement de 1218 et pourquoi il m’intéresse, il faut d’abord savoir qu’en 1182, le chœur de la cathédrale est consacré, et on se dit, 1182, si le chœur est consacré, c’est qu’il est terminé ; l’historiographie de Notre-Dame porte cette idée ancrée au plus profond d’elle-même. Et en 1218, qu’est-ce qui se passe ? Eh bien, le 14 août, il y a un voleur, anglais, qui monte dans la charpente et avec des cordes et des crochets, il va attraper des chandeliers qui sont allumés sur le maître-autel. Il va tirer, et en tirant sur les chandeliers, il va mettre le feu à des tentures. Et donc, ça a créé peut-être le premier incendie de l’histoire de Notre-Dame de Paris, qui a été consigné dans des sources écrites. Alors, cette question-là a été interprétée par beaucoup de gens pour justifier qu’on ait eu besoin de remplacer la charpente ou je ne sais quoi. Mais ce qui m’intéresse, moi, dans cette histoire de cet Anglais, c’est comment il a pu attraper des chandeliers allumés avec des cordes et des crochets depuis la charpente si les voûtes étaient posées en 1182, c’est-à-dire 36 ans avant. Et donc, analysant ça, j’en arrive à la conclusion que, et c’est en fait le point de départ de ma thèse, c’est la question que je pose dans l’introduction, c’est : est-ce que cette histoire est complètement fausse ou est-ce qu’en fait, en 1182, les voûtes du chœur ne sont pas posées ? Et ça ouvre ensuite à tout un tas de questions qui est la cohabitation entre les travaux et l’usage liturgique des lieux.
Et en fait, il y a une dimension évidemment très, le terme est peut-être pas très bien choisi, mais très politique dans le fait de consacrer un chœur. Le fait de consacrer un chœur, c’est dire : « Oui, d’accord, c’est bon, j’ai coupé le bandeau rouge avec mes ciseaux, ça fonctionne, ça marche, tout va bien. » En fait, tout n’est pas terminé, mais en tout cas, l’espace commence à être utilisé et le chantier peut être considéré comme étant déjà très avancé et en partie un succès. Donc moi, j’ai beaucoup d’affection pour ce voleur anglais parce qu’en fait c’est, de tout ce que j’ai pu observer du bâti, c’est une des rares petites sources écrites qui me permettent de corroborer mes observations. Et puis finalement, bon, les Anglais restent des Anglais pour les Français, mais de temps en temps, il y en a un qui sort du lot et qu’on peut remercier pour ce qu’il a pu faire dans sa vie. Pour moi, ce sera celui-là.
[Intermède musical]
Fanny Cohen Moreau : Quand est-ce que la cathédrale est achevée, en tout cas au Moyen Âge ?
Olivier de Châlus : Haha… Quand est-ce que la cathédrale est achevée, en tout cas au Moyen Âge ? C’est une très bonne question, parce que la consécration de la cathédrale qui, je dirais, donne son, son inauguration liturgique pleine et entière, c’est 1864. Il y a quelque chose qui s’étale vraiment et donc la notion de quand est-ce qu’elle se termine au Moyen Âge, la formulation est judicieuse. Alors, qu’est-ce que c’est qu’une cathédrale en fait ? C’est peut-être là qu’est la question ? Parce que quand est-ce qu’on a fini de construire une cathédrale ? C’est quoi l’objectif d’une cathédrale ? Ça sert à quoi une cathédrale en fait ? Il y a toujours eu des travaux sur ce site depuis les origines, alors avec des phases de travaux qui sont plus ou moins importantes selon les époques. Il y a évidemment la restauration qui s’engage actuellement, il y a eu la restauration du XIXᵉ siècle, mais on pourrait en évoquer d’autres. Elle est d’abord terminée dans un premier temps en 1182, à partir du moment où elle est opérationnelle. Je dirais qu’elle est ensuite terminée en 1200, plutôt, peut-être en 1230, quand la façade est quasiment terminée d’être achevée. La façade est fonctionnelle et on a des cloches qui peuvent sonner, etc., et participer à l’activité liturgique. Elle est également terminée et surtout, peut-être, au début du XIVᵉ siècle, lorsque les façades du transept sont terminées, lorsque les chapelles latérales sont installées. Et c’est là qu’en tout cas la construction du bâti lui-même est achevée. Mais on peut pas faire une distinction entre le bâti et ce qui se passe à l’intérieur et ce à quoi ça sert. Et finalement, les sujets qui conditionnent, qui définissent ce qu’est une cathédrale au XIIᵉ siècle sont peut-être pas les mêmes que ceux qui définissent une cathédrale au début du XIVᵉ siècle. Donc là, la question est encore d’autant plus complexe.
[Intermède musical]
Fanny Cohen Moreau : Maintenant, vous en savez plus sur l’histoire de la cathédrale quasiment jusqu’à nos jours. Dans le prochain épisode de cette série spéciale, nous allons entrer dans Notre-Dame de Paris avec des personnes qui ont travaillé entre ses murs.
Merci à Clément Nouguier pour le générique de cette série. Merci à Din pour l’illustration et merci aux personnes qui soutiennent Passion Médiévistes sur Tipeee, qui ont permis le financement de cette série.
[Générique de fin]
Laurent Prades : Pour l’ensemble de mes collègues et moi-même bien évidemment, on ne venait pas travailler là comme on irait travailler dans un lieu un peu plus neutre, où, à la fin de la journée, on ferme son bureau à clé et on rentre chez soi. Oui, il est évident qu’il y avait une autre dimension.
Merci à Luc pour la transcription et à Maud pour la relecture !
Épisode 3 : Vivre dans Notre-Dame de Paris

Que ressent-on lorsqu’on travaille au quotidien au sein d’un monument comme la cathédrale Notre-Dame de Paris ? Dans ce troisième épisode, je vous propose de rentrer virtuellement dans la cathédrale aux côtés de ceux qui y ont évolué pendant des années. D’abord, le doctorant Olivier de Châlus (que vous avez pu entendre dans les épisodes précédents) vous raconte son expérience de guide, comment il pensait ses visites pour faire découvrir le monument au grand public.
Dans la deuxième partie de l’épisode, Laurent Prades revient sur ses vingt années passées comme régisseur de Notre-Dame. Depuis son arrivé au début des années 2000, il a vu le monument évoluer, se moderniser, et accueillir de plus en plus de public. Sa mission était la gestion de l’événementiel et la supervision de la régie audiovisuelle. En 2009 son travail évolue, et il devient en plus chargé de l’inventaire des objets d’art et reliques de la cathédrale. A ce sujet, il revient dans l’épisode sur comment les œuvres ont été préservées la nuit de l’incendie et les choix qui ont du être faits.
Laurent Prades : Quand moi je suis arrivé, il y avait dix, douze concerts par an et ces dernières années, il y avait un concert par semaine.
[Générique de début]
Au cœur de Notre-Dame. Une série de podcasts par Passion Médiévistes.
Fanny Cohen Moreau : Bonjour à toutes et à tous ! Bienvenue dans ce troisième épisode de la série spéciale sur la cathédrale Notre-Dame de Paris du podcast Passion Médiévistes. Je m’appelle Fanny Cohen Moreau et après avoir parlé de l’histoire de Notre-Dame de Paris, je vous propose qu’on entre, virtuellement en tout cas, entre ses murs.
[Intermède sonore]
D’abord, commençons par parler avec le doctorant Olivier de Châlus, que vous avez pu entendre dans les deux précédents épisodes. Il se trouve qu’il a été guide bénévole à la cathédrale pendant une dizaine d’années et, parmi toutes les expériences qu’il a vécues, il voulait vous raconter une visite particulière avec une petite fille.
Olivier de Châlus : Un matin de, je pense novembre 2018, quelque chose comme ça, j’arrive au bureau, là où je travaille, je retrouve mes collègues et il y a Ibrahim qui est là et qui me dit : « Olivier, c’est marrant, ma fille Élina a un exposé à faire sur Notre-Dame de Paris. » Je dis à Ibrahim : « Bah, il faut qu’elle m’écrive pour qu’on aille faire une visite ensemble à Notre-Dame ! »
Et puis on s’est retrouvés en janvier, donc c’était trois mois avant l’incendie, sur le parvis. Et donc, il y avait Élina qui était là avec son frère, sa sœur, ses parents et puis trois ou quatre petites filles de huit ans qui étaient là avec leur mère. Et donc je commence ma visite : « Donc voilà, je m’appelle Olivier, je travaille à la cathédrale, etc. Moi, je voudrais déjà savoir ce que vous savez de la cathédrale et ce que vous avez envie de savoir ? »
C’est essentiel. On peut pas donner une visite guidée sans poser la question aux gens, d’abord de savoir d’où ils viennent et pourquoi ils sont là. Quand on forme des guides, je me souviens d’une anecdote qu’on avait eu quand on était en week-end de formation à la cathédrale de Reims où on suit une visite d’un guide local qui nous emmène dans la charpente, qui nous dit : « Bah voilà, cette charpente, elle a brûlé comme beaucoup de cathédrales et elle a été reconstruite en béton. Ce qui est assez exceptionnel parce que, par exemple, à Saint-Denis, à Chartres ou à Paris, elles ont été reconstruites en métal. » Et là, évidemment, il avait pas posé la question de savoir face à qui il se trouvait. Ben, manque de bol, il était face à un troupeau de guides de Notre-Dame de Paris qui savaient évidemment très bien que leur charpente était en bois.
Et donc c’est vraiment une règle, je pense. Et puis, c’est une bonne manière de sentir un peu son public et de l’accueillir et de lui laisser de l’espace pour qu’il puisse un peu s’exprimer. Parce que, on donne pas une visite pour soi, on donne une visite pour partager. Ce qui fait une bonne visite, c’est, les gens répondent oui à trois questions en sortant : d’abord, est-ce que vous avez passé un bon moment ? Deuxièmement, est-ce que vous avez appris des choses ? Et troisièmement, est-ce que vous avez envie d’en savoir plus ? Si la réponse est oui à ces trois questions, alors le job est fait.
« Et donc, qu’est-ce que vous savez de Notre-Dame de Paris ? » « Eh bien, Notre-Dame de Paris a été construite par l’évêque Maurice de Sully. Le chantier a commencé en 1163 par le chœur. Bla bla bla bla bla bla bla. » Au bout d’un certain temps, je les ai coupées parce que j’étais obligé. C’était ma visite quand même. [Rires] Et donc voilà, je me suis retrouvé face à quatre, cinq petites filles qui étaient en fait, qui s’étaient piquées au jeu de l’exposé et qui avaient creusé et qui avaient eu envie de découvrir et qui avaient attendu cette visite depuis longtemps, qui avaient tanné leurs parents. Et c’était, c’était génial ! Enfin, moi, j’en ai un souvenir vraiment extraordinaire, parce que c’est l’âge à partir duquel les enfants arrivent à se reconstituer un petit peu une chronologie, avoir des repères en termes de dimensions et à pouvoir suivre un fil de visite. Et puis, en fait, la visite a duré deux heures et demie. Les petites filles ont pas arrêté de me poser des questions. Au bout d’un moment, il y en a une qui m’arrête, qui me dit : « Attendez, attendez, attendez, on fait une pause parce que je veux prendre des notes. » [Rires] Elle avait huit ans. Après, je sais pas du tout quels seront les fruits de cette visite pour ces petites filles. Est-ce que certaines continueront à s’intéresser au sujet ou pas ? On verra. En tout cas, j’ai récupéré un petit bout de charbon sur le parvis que j’ai donné à Ibrahim pour qu’il puisse le donner à Élina. Donc, ben, je sais pas quel souvenir elle garde de cette visite, mais enfin, j’espère que ça lui a fait plaisir.
Donc voilà, après évidemment, j’ai rencontré là-bas, dans tous les domaines, des gens qui avaient un vrai goût pour faire les choses bien. C’est pas une question de faire les choses à fond et d’être maximaliste, c’est pas une question de caracoler et de se dire, nous, on est Notre-Dame de Paris, on est les meilleurs, etc. C’est vrai que quelque part on se disait, ben oui, Notre-Dame de Paris, nous, on est pas vulnérables, on est les plus solides, et en fait, évidemment, l’expérience ou l’histoire nous a montré que c’était pas du tout le cas. Mais, disons qu’on était conscients que ce lieu-là était particulier et qu’il fallait vivre cette particularité, non pas avec fierté et avec égocentrisme, mais plutôt avec beaucoup d’humilité en se disant on est là, bah, c’est nous. Et puis voilà.
Moi, c’était la cathédrale de ma ville. Il se trouve que je suis parisien, donc c’est celle à laquelle je me suis intéressé. J’aurais été, j’aurais été habitant de Bourges, je me serais intéressé au moins tout autant à la cathédrale de Bourges qui est merveilleuse. Il y a quelque chose qui se passe, qui dépasse l’homme et du coup qui parle assez bien de la vocation première de Dieu.
Fanny Cohen Moreau : Dans son quotidien de guide, Olivier de Châlus a souvent collaboré avec quelqu’un qui a travaillé pendant 20 ans dans Notre-Dame de Paris et que j’ai pu rencontrer début janvier 2021.
[Bruits de clenches de portes]
Laurent Prades : Je m’appelle Laurent Prades, j’ai 45 ans et je travaille à Notre-Dame depuis une petite vingtaine d’années.
Fanny Cohen Moreau : Laurent Prades, vous êtes diplômé en biochimie et en biotechnologies, donc a priori rien à voir avec l’histoire. Et pourtant, vous êtes engagé en 2000 comme régisseur de Notre-Dame de Paris. Comment et pourquoi est-ce que vous avez commencé à travailler dans la cathédrale Notre-Dame ?
Laurent Prades : Alors, j’ai même une spécialité en mycologie, donc, il y a quand même des moisissures dans Notre-Dame, donc on peut peut-être faire un petit parallèle ! Non, non, mais c’est vrai que mes premiers amours étaient vraiment plus sur les sciences. J’ai donc terminé mes études à Paris, j’ai commencé à travailler dans des, dans des laboratoires de recherche. Et c’est vrai que j’ai fait mon service militaire, c’est quelque chose qui, qui existait encore à mon époque si je puis dire, et qui m’a ouvert de nouveaux horizons ; et, en particulier, plus travailler dans, assez paradoxalement, mais c’est bien lié à mon service militaire, à travailler plus dans des milieux culturels. Donc, c’est vrai que la question s’est posée à l’issue de ce service militaire, quoi faire.
En parallèle de ça, je connaissais la cathédrale bien évidemment, mais je connaissais le fonctionnement de la cathédrale, je connaissais le recteur et je connaissais mon prédécesseur à ce poste. Alors, même si le poste a énormément évolué. Et donc mon prédécesseur, en fait, a souhaité prendre une année sabbatique. Donc ça correspondait à peu près au moment où moi je m’interrogeais à repartir dans un laboratoire de recherche ou me lancer dans autre chose. Donc j’ai proposé mes services, donc je suis rentré à la base à peu près pour un an. Mais si ce n’est que mon prédécesseur n’étant jamais revenu, et bien j’y suis depuis.
Au tout début, c’était vraiment ce qui s’appelait s’occuper de la régie. Donc, la régie, c’était vraiment tous les aspects événementiels, donc en dehors des offices ordinaires, c’était, avec mes collègues, donc en particulier le directeur des services et le recteur bien sûr, c’était aller un peu inventer, concevoir et gérer, donc en amont et au moment sur le terrain, tous les événements qui jalonnaient la vie de la cathédrale, donc en particulier tout ce qui est grandes célébrations. Il y avait aussi tout un gros travail sur la saison de concerts de la Maîtrise, puisque donc nous assurions tous les, tous les moyens mis en œuvre en fait. C’est un peu comparable finalement à une régie de théâtre, même si, bien évidemment, une liturgie n’est absolument pas une pièce de théâtre jouée, mais c’est un peu comparable. C’est-à-dire, c’était aller gérer tous les moyens techniques en termes d’éclairage, de lumière, de son…
Ce travail a considérablement évolué, puisque c’est vrai que la cathédrale, au début des années 2000, a connu une considérable augmentation de ses activités sous l’impulsion de son recteur, on peut le dire, monseigneur Jacquin. Donc le service s’est développé, le service s’est étoffé. Donc j’ai eu plusieurs collaborateurs qui travaillaient sur le terrain avec moi. Et c’est vrai qu’on a développé énormément d’activités à l’intérieur de la cathédrale. On a développé, je pense en particulier à des nocturnes, l’idée était d’ouvrir le plus tard possible la cathédrale pendant l’été, puisque la cathédrale habituellement fermait à 19h. Mais on a bien vu que les soirées d’été, jusqu’à 23h, et des milliers de gens qui se pressent sur le parvis, donc on a développé au début des années 2000 des sons et lumières. On a développé beaucoup plus d’activités liées aussi à des temps liturgiques. Je pense à tout ce qu’on a pu mettre en œuvre au temps de Noël : l’énorme sapin sur le parvis était mis par la cathédrale, des crèches monumentales, voilà.
Pareil, la saison de concerts de la Maîtrise s’est considérablement étoffée. Quand, moi, je suis arrivé, il y avait dix, douze concerts par an et, ces dernières années, il y avait un concert par semaine. Les volumes ont considérablement évolué. Et les moyens techniques aussi, puisqu’on a renouvelé la quasi-totalité des moyens techniques de la cathédrale en termes d’éclairage, de sonorisation… On a installé une régie audiovisuelle pour capter en direct des offices tous les jours. Il y avait à la fois tout ce pool technique à gérer, il y avait à gérer tout le pool des intervenants extérieurs, typiquement quand des grandes chaînes de télévision venaient filmer à la cathédrale et autres.
Et alors, c’est vrai qu’à la fin des années 2000, pour moi, s’est ouvert une nouvelle voie, si je puis dire, qui était la question des collections et des objets d’art et de la gestion des objets d’art en lien avec les services de l’État ; puisque, comme vous le savez, à Notre-Dame de Paris, comme dans les autres cathédrales de France, tout ce qui est le bâtiment est propriété de l’État, les collections présentes en 1905, au moment de la loi de séparation des Églises et de l’État, sont propriétées de l’État. Mais il est bien évident que les collections ont continué à évoluer par la suite. Et donc il y a à la fois des objets propriétés du diocèse de Paris et de l’État, voilà. Et donc je me suis mis à gérer ces collections parce qu’il y avait quand même une forme de vide, en tout cas dans la gestion des collections propriétées du diocèse, et qu’il fallait absolument réparer. Et donc, dans le cadre de nos travaux avec les services de l’État, on a vu beaucoup plus grand et beaucoup plus large, et on a mis en place tout un système de gestion de l’intégralité des collections de la cathédrale. Alors, j’avais, comment dire, quelques attraits bien évidemment pour les choses de l’art, mais je me suis formé, je me suis perfectionné au gré de formations proposées par le ministère de la Culture, au gré des cours dispensés par le, par l’école du Louvre.
Et du coup, j’avais un peu ces deux volets, à la fois donc gestion d’un côté ou supervision de pas mal de moyens techniques, mise en œuvre sur le terrain de la cathédrale, et en parallèle de ça, tout le volet un peu plus patrimonial et médiation et développement autour de ce patrimoine.
[Intermède musical]
Fanny Cohen Moreau : Ce patrimoine au fil des années, est-ce qu’il était fixe ou est-ce qu’il y avait des entrées, des sorties, des prêts ?
Laurent Prades : Alors il était pas fixe, et ça sur plusieurs niveaux. Vous évoquez les prêts, c’est à longueur d’année qu’on prêtait des objets pour des expositions. Il est vrai que les collections de la cathédrale contiennent un certain nombre d’objets phares. On peut penser immédiatement aux grandes pièces d’orfèvrerie dessinées par Viollet-le-Duc. On peut penser aussi à une partie de nos tableaux, aux grands Mays en particulier.
Mais c’était aussi, alors, une collection aussi vivante, puisqu’elle continuait à s’enrichir. On voit au fil des siècles que ces collections se sont principalement enrichies par des dons. Il y avait aussi encore des commandes de l’Église, qu’il s’agisse d’objets usuels pour le culte ou d’objets que l’on peut qualifier, comment dire, d’un peu plus grande envergure. Je pense à des commandes contemporaines : on sait que le cardinal Lustiger était extrêmement intéressé pour aller confronter la spiritualité de l’Église catholique à l’art contemporain. Donc, Notre-Dame de Paris commandait encore des œuvres à des artistes contemporains.
Et en termes de mobilité aussi, j’ajouterais une autre dimension qui était quand même toute particulière à Notre-Dame, parce qu’il faut voir que l’ensemble des objets, même s’ils sont propriétés de l’État, sont affectés au culte. Et c’est vrai que Notre-Dame de Paris avait quand même une particularité, c’est que toutes les collections du trésor, par exemple, avaient gardé vraiment leur, leur, leur vocation première, et, par exemple, les neuf dixième des objets qui étaient exposés dans le trésor aux visiteurs servaient toujours au fil de l’année pour les liturgies.
On peut dire que Notre-Dame de Paris fait sûrement partie de ces rares édifices qui ont gardé leur vocation première. C’est un lieu de culte et ça, c’est indéniable. Même s’il y a 12 millions de visiteurs du monde entier qui s’y pressent, la fonction première de Notre-Dame de Paris, c’est un lieu de culte. Ce n’est absolument pas un musée. On voit très bien que la frontière culte-culture, elle est extrêmement mixée et elle l’est depuis des siècles et des siècles. Si on prend la collection des grands Mays au XVIIe siècle, certes, ils ont été peints et réalisés pour qu’il y ait un réel message, que ce soient les miracles du Christ ou les Actes des Apôtres ; mais on voit très bien aussi que, sociologiquement, ça devient une galerie de peintures faites par les grands peintres du moment, ou les jeunes grands peintres du moment, et ça devient très vite une référence par les copies qui sont propagées en France et ailleurs. Mais ça n’empêche que le message premier, c’est le, c’est l’aspect cultuel.
Pour l’ensemble de mes collègues et moi-même bien évidemment, on ne venait pas travailler là comme on irait travailler dans un lieu un peu plus neutre où, à la fin de la journée, on ferme son bureau à clé et on rentre chez soi. Oui, il est évident qu’il y avait une autre dimension.
Fanny Cohen Moreau : Est-ce que vous étiez habitué au gigantisme du lieu ?
Laurent Prades : Heu, non, je pense qu’on pouvait pas s’y habituer. On le gérait, mais on ne pouvait pas s’y habituer. Le gigantisme, il débordait dans tous les coins. C’est-à-dire, c’est à la fois, c’est le gigantisme architectural, c’est le gigantisme artistique, c’est le gigantisme en termes de fréquentation, avec des journées moyennes à 30 000 visiteurs par jour, c’est le gigantisme en termes d’offices, 2 700 par an. Enfin, voilà.
Mais on gérait ce gigantisme, mais je pense qu’on le, qu’on le redécouvrait souvent tous les jours. Moi, j’étais toujours très, très impressionné, par exemple, dans les pics de fréquentation, que ce soit par exemple au moment des fêtes de fin d’année, c’est toujours extrêmement impressionnant de voir le nombre de personnes qui se pressaient non seulement dans la cathédrale pour la visiter en journée, mais le nombre de personnes qui se pressaient aussi pour les offices, voilà.
J’étais aussi toujours très impressionné par les grands rassemblements diocésains, que ce soient les ordinations ou la messe chrismale qui rassemble tous les prêtres de Paris. Il y a aussi une forme de gigantisme, et qui vous, et qui vous saisit parce que, autant une messe avec quelques dizaines de fidèles dans le chœur fait vibrer elle aussi la cathédrale, mais autant une célébration avec 3 000 personnes à l’intérieur, plus quelques milliers d’autres sur le, sur le parvis comme on pouvait le faire pour les ordinations des nouveaux prêtres font aussi vibrer le gigantisme de la cathédrale dans une autre mesure.
[Intermède musical]
Laurent Prades : Il faut pas perdre de vue que la cathédrale, comme je vous le disais, accueillait 12 millions de visiteurs par an. Et on était une bonne soixantaine pour gérer ça. Ce qui peut paraître totalement surréaliste quand on voit, potentiellement sur d’autres sites, les milliers de salariés pour des sites qui n’arrivent même pas à 7, 8 ou 10 millions de visiteurs.
Alors, il faut mettre tout ça en regard puisque, de manière très, très, très triviale, on pourrait dire que nous n’avions qu’une salle, là où des musées peuvent avoir des milliers de mètres carrés où les visiteurs déambulent. Mais la plus grande difficulté, je pense qu’elle était là : c’était aller gérer ces milliers de visiteurs, gérer leurs, leurs intentions diverses, mais tout en arrivant à leur faire passer quand même le message de Notre-Dame.
Alors, le message de Notre-Dame, quel est-il ? On pourrait dire que, que chacun peut y trouver ce qu’il veut. L’un de nos recteurs précédents disait : « Ils entrent touristes, ils ressortent pèlerins. » C’est peut-être, c’est assez caricaturé, mais ça frise quand même une certaine réalité. L’un des enjeux était quand même que les gens comprennent le message de Notre-Dame, le message spirituel. Après qu’il passe par l’immensité de l’élévation ou par la beauté d’un office qui s’y déploie, ou je dirais même presque par l’intimité d’un office qui s’y déploie. Chacun trouve son média.
Fanny Cohen Moreau : Par rapport à l’histoire de Notre-Dame, est-ce que ça peut pas aussi donner le vertige de travailler dans un lieu qui est si chargé de siècles et de siècles d’histoire ?
Laurent Prades : Alors, quand on y travaille, c’est un emploi. Donc je dirais presque qu’on a une fiche de poste et je dirais presque qu’on a des comptes à rendre, mais on a des comptes à rendre sur le, sur l’instant T. On peut s’arrêter là. Mais c’est vrai que, dès qu’on commence à creuser, et c’était passionnant parce que l’immense majorité des employés creusaient bien évidemment cette dimension avec plus ou moins de profondeur, mais c’est vrai que, alors je sais pas si c’est une immensité ou un vertige, mais je dirais presque que, plus qu’à avoir peur de ça, que ça remet un peu les choses en place. C’est-à-dire qu’on voit que l’on se retrouve finalement dans une immense continuité qui a, qui a démarré, comme vous le savez, il y a de nombreux siècles et que, bah finalement, qu’on est qu’une toute petite chose qui ne fait que passer dans un tout petit laps de temps, et finalement on est là à un instant T pour que les choses se passent au mieux. Mais, il faut pas s’imaginer que c’est notre passage qui va tout, qui va tout révolutionner. J’imagine, enfin en toute modestie, que mes très lointains prédécesseurs qui ont subi des heures absolument difficiles et atroces finalement, de même que, nous, on les a vécues par l’incendie, on peut penser aux intendants de la cathédrale au moment de la Révolution française, ou du, ou des émeutes de 1830, ou du sacre de l’archevêché en 1831, ou au moment de la Commune quand une partie du maître-autel est incendiée. Enfin, voilà, c’est qu’il y a eu les heurts de l’histoire, mais on voit quand même comment, quelques décennies après, voire à plus forte raison quelques siècles après, comment demeure et se perpétue une vie intense de la cathédrale.
[Intermède sonore]
Laurent Prades : Ce que je préférais faire, c’était être sur le terrain de la cathédrale. Il se trouve que, de par mes fonctions, je passais de longues heures dans mon bureau à gérer beaucoup de choses. Comme vous pouvez vous en douter, on ne gère pas que des choses glorieuses. Il y a aussi, il y a aussi un quotidien très souvent problématique dans un tel lieu, mais qui rejoint peut-être le peu d’effectif que nous étions pour aller gérer ça. Et du coup, les moments les plus intéressants, c’était vraiment de se retrouver sur le terrain, mais, mais sur le terrain habité, je dirais. Il y a le terrain de la déambulation des visiteurs et du message qu’on peut leur faire passer. Et c’est vrai que là, dans mes attributions, il y avait un peu cette partie médiation des visiteurs. Je pourrais prendre un simple exemple : il y a quelques années, on avait revu entièrement une grande partie de la signalétique dans la cathédrale et en particulier tous les cartels qui présentaient un peu tout ce qui était exposé dans la cathédrale, parce qu’il y avait de nombreuses choses qui étaient exposées, mais sans qu’on puisse savoir ce que c’était. Alors, l’idée était bien évidemment de pas aller faire des énormes panneaux qui expliquaient tout, mais, a minima, donner le titre d’une œuvre, d’en donner l’auteur et recentrer un peu toutes ces œuvres présentées. On a vu comment, du jour au lendemain où on a mis tout, tout, tous ces petits panneaux de cartels au gré des chapelles de la cathédrale, comment les gens les lisaient. Donc rien que ça, je peux vous avouer que c’était une certaine gratification.
Et j’en reviendrai aussi à ce que je vous disais un peu tout à l’heure, ce qu’on préférait faire, c’est quand la cathédrale vibrait de son activité première, c’est-à-dire tout le déroulement des liturgies. Et c’est vrai que c’était extrêmement gratifiant de voir ces milliers de fidèles qui venaient un peu se nourrir, qu’ils soient, comment dire, diocésains, c’est-à-dire du diocèse de Paris, et qui viennent dans l’église-mère pour recevoir un peu l’enseignement de l’église-mère, mais finalement aussi tous ces visiteurs du monde entier, et on le voyait très, très nettement. C’est vrai que là, dans ce qu’on appelle les messalisants, c’est des gens qui vont à la messe le dimanche matin, l’immense majorité, quasiment les trois quarts, étaient des gens qui n’étaient pas français. Donc c’est-à-dire, c’est des visiteurs qui étaient là sur Paris, mais qui dans leur programme, si je puis dire, avaient vraiment prévu de venir assister à un office à Notre-Dame de Paris.
Fanny Cohen Moreau : Et est-ce qu’il y a un lieu en particulier dans la cathédrale auquel vous étiez attaché ? Peut-être vraiment un détail.
Laurent Prades : Au-delà des lieux, il y a peut-être des objets qui étaient plus, plus émouvants. Alors, on peut bien sûr évoquer la Couronne d’épines, qui était dans le trésor de la Sainte-Chapelle et qui est aujourd’hui conservée à Notre-Dame de Paris. On peut évoquer les grandes pièces d’orfèvrerie qui sont assez, je dirais presque fantasmatiques, mais il y avait quand même, dans les collections en tout cas, un objet très émouvant, c’est la tunique de saint Louis. Moi en tout cas qui, oui, qui m’émeuvait assez. Alors, attention, soyons clairs, ça ne me tirait pas non plus des larmes, mais il y avait quand même un côté toujours assez sensible et un côté que j’ai ressenti le soir de l’incendie quand il a fallu évacuer cette pièce. C’est-à-dire qu’on se retrouve devant, bah c’est quoi, c’est un morceau de tissu, enfin tissé en lin. C’est une tunique. Donc si vous voulez, c’est un objet d’une banalité je dirais presque assez extrême, mais si ce n’est que de cette tunique médiévale, il n’en reste pas beaucoup en France, donc là déjà, on a déjà un peu plus de préciosité sur l’objet, si ce n’est qu’elle est bien datée du XIIIe siècle, ce qui la rend encore plus précieuse, et si ce n’est qu’elle provient bien du trésor de la Sainte-Chapelle dans laquelle elle a été classifiée un peu parmi les reliques provenant de saint Louis. Voilà. Donc on a typiquement à la fois l’objet dont la valeur marchande, c’est quoi, c’est un peu de lin tissé, mais en parallèle de ça, c’est, ça a une valeur inestimable au sens premier du terme, parce que c’est médiéval, parce que c’est une relique aussi, en tout cas pour les chrétiens, ça peut être considéré comme une relique voilà. Donc je pense que, là, on a vraiment une sorte de nœud et qui le rend d’autant plus émouvant.
[Intermède musical]
Laurent Prades : Il y avait à Notre-Dame de Paris ce qu’on appelle un plan de sauvegarde des œuvres, qui est travaillé avec les pompiers, avec les services du ministère et de la DRAC Île-de-France. Et c’est vrai que c’est quelque chose qui n’existait pas à Notre-Dame de Paris et que le ministère avait demandé de mettre en place. Et donc, avec les services de la DRAC, on s’y est attelé de manière extrêmement sérieuse et précise. On a même fait des essais grandeur nature avec les pompiers du Louvre, pour voir un peu comment ça pouvait se passer si un feu prenait dans une chapelle par rapport aux œuvres qui étaient dans cette chapelle. On a fait des essais sur les œuvres qui nous paraissaient totalement ingérables en cas d’incendie. Je pense que, on a un grand tableau qui est la Visitation de Jouvenet, qui fait quasiment cinq mètres par cinq, donc autant vous dire que c’est totalement impossible de l’évacuer en quelques dizaines de minutes. Mais du coup, bah, voir ce qui est envisageable en cas de sinistre pour quand même aller protéger ces œuvres et en particulier les protéger des eaux de ruissellement que les pompiers pourraient envoyer.
Alors, il est clair qu’on l’a fait très sérieusement, peut-être tout en se disant un peu que ça n’arriverait jamais, ou en tout cas que ça n’arriverait jamais à une telle ampleur que ce que l’on a pu subir. Donc c’est vrai qu’on avait ce plan en tête, ce plan était en cours de validation. Mais le soir du sinistre, j’ai vu que des pompiers l’avaient en main. Donc ça fait partie des, comment dire, des, des quelques étincelles d’espoir qui ont pu passer pendant cette nuit du sinistre. Je me suis dit, bah voilà, au moins un truc qu’on a fait qui aura servi et il est clair qu’avec les conservateurs de la DRAC Île-de-France, comme on connaît, comme on maîtrise ces collections, on savait très bien quels étaient les objets précieux à évacuer en premier.
Après l’idée d’un plan de sauvegarde des œuvres, c’est pas de tout évacuer, parce qu’on sait très bien qu’on ne peut pas tout évacuer, mais en tout cas, mais c’est d’identifier très clairement la dizaine ou les quelques dizaines, nous, on avait de mémoire une quinzaine d’objets majeurs qu’il fallait impérativement évacuer. Donc ce choix se fait en fonction de la, de la valeur des objets, de la valeur patrimoniale des objets. Mais derrière la valeur patrimoniale, il y a la valeur historique, il y a la valeur financière, enfin, il y a tout un tas de critères que je range derrière valeur patrimoniale. Mais ce choix aussi se fait en termes de ce qu’il est possible d’évacuer. Je prendrais typiquement l’exemple de la statue de la Pietà dans le chœur de Notre-Dame, il est évident, et les statues de Louis XIII et de Louis XIV, il est évident qu’elles ont une valeur patrimoniale absolument considérable, mais c’est impossible de les évacuer pendant un incendie. Voilà, c’est que ça prend plusieurs jours d’évacuer des œuvres de cette ampleur.
On a évacué, donc en lien avec les, avec les conservateurs de la DRAC Île-de-France et l’appui des pompiers bien sûr, puisque sont arrivés très vite des pompiers spécialisés dans ce type d’évacuation et avec lesquels on avait travaillé précédemment. Et ça m’a permis d’aller revoir des têtes connues, dans le sinistre, là aussi, c’était une lueur d’espoir. L’idée était donc d’évacuer en priorité les œuvres qu’il fallait évacuer. Mais une fois qu’elles ont été évacuées, on a, on a poursuivi et c’est vrai que les pompiers, pris par leur zèle, ont sorti de la cathédrale tout ce qu’ils ont pu sortir. Donc à la fois des, des, des choses qui le méritaient largement patrimonialement, mais c’est vrai qu’ils se sont saisis aussi d’un peu de tout ce qu’ils ont trouvé. Et je pense en particulier à des assises qui n’avaient pas beaucoup plus de valeur que leur simple fonction d’être des assises, ou les brûloirs par exemple sur lesquels les visiteurs pouvaient déposer un cierge de dévotion. Ce sont des éléments qui n’ont strictement aucune valeur patrimoniale. Mais dans la mesure où on avait évacué déjà de la cathédrale tout ce qui avait pu être sorti, ils ont poursuivi tant qu’ils ont pu.
On a quand même tous été profondément marqués, je dirais presque traumatisés par ce sinistre pour bon nombre. C’est vrai qu’on était une structure avec plus de 60 salariés, aujourd’hui, on est, on est huit, mais sur les huit, on est quatre, cinq effectifs sur le, sur le terrain. Et c’est vrai que ça n’a plus, absolument plus rien à voir avec la structure telle qu’elle était précédemment. C’est vrai que la couche COVID en a largement, lourdement rajoutée, puisqu’on avait espéré quelques redéploiements à l’intention des fidèles, des visiteurs et des touristes aux abords de la cathédrale, et que, à ce jour, rien n’a pu se faire. Donc on travaille quand même sur, sur d’autres sujets et ils sont nombreux. Mais c’est vrai que le fonctionnement précédent de la cathédrale paraît tellement loin. Les intentions que l’on pouvait y mettre paraissent aussi tellement loin. Et je pense qu’elles paraissent aussi d’autant plus loin que, on continue à travailler sur le terrain de la cathédrale, disons dans son état blessé, et on en a une toute autre perception aujourd’hui.
Mon souhait pour Notre-Dame, c’est bien évidemment qu’elle réouvre le plus tôt possible et que Notre-Dame puisse être remise à disposition du monde. Notre-Dame, c’est le patrimoine de l’humanité, ça c’est évident, on l’a largement vu au lendemain de l’incendie. Et c’est quelque chose qu’on avait vu aussi en 2013 quand on a installé les nouvelles cloches dans les tours, on a bien vu que cet intérêt, typiquement pour les cloches de Notre-Dame de Paris, dépassait bien évidemment le diocèse de Paris, dépassait bien évidemment les catholiques de France et intéressait vraiment le monde entier, chrétiens ou pas. On l’a vu, à plus forte raison au lendemain de l’incendie. Je pense que mon souhait premier, c’est à nouveau que Notre-Dame et toutes ses composantes et sa spiritualité puissent à nouveau accueillir le monde.
Fanny Cohen Moreau : Merci beaucoup Laurent Prades.
Laurent Prades : Avec plaisir.
[Intermède musical]
Fanny Cohen Moreau : Dans le prochain épisode, nous resterons encore dans la cathédrale pour parler de sa musique, de son histoire, notamment de la musique médiévale.
Merci beaucoup à Clément Nouguier qui a réalisé le générique de cette série, à Din pour la magnifique illustration, à Jonathan, le mec d’Ozef, qui a fait le montage, et un merci particulier aux personnes qui soutiennent Passion Médiévistes sur Tipeee et qui ont permis le financement de cette série spéciale.
[Générique de fin]
Sylvain Dieudonné : La plupart des gens ne viennent pas pour écouter tel chef ou tel chef. Ils viennent même pas pour écouter la Maîtrise. Ils viennent pour écouter un concert à Notre-Dame.
Merci à Luc pour la transcription et à Maud pour la relecture !
Épisode 4 : La musique médiévale dans Notre-Dame de Paris

Après avoir évoqué la construction de sa cathédrale et comment on y travaillait, nous parlons dans ce quatrième épisode de la musique médiévale au sein de la cathédrale Notre-Dame de Paris. Sylvain Dieudonné a été le chef de chœur à la Maîtrise Notre-Dame de Paris pendant 25 ans et il était en charge du Département de musique médiévale. Une grande partie de ses travaux est consacrée à l’étude de manuscrits, où une place de choix est réservée au répertoire de l’École de Notre-Dame.
Dans cet épisode Sylvain Dieudonné vous retrace l’évolution de la musique au Moyen Âge, l’émergence des différentes formes musicales au sein des édifices religieux, et les spécificités de la musique au sein de la cathédrale.
Dans cet épisode, vous pouvez entendre des extraits des œuvres suivantes :
- Motets en espace
- Concert de Noël 2013 à Notre-Dame de Paris
- Concert de chant grégorien à Notre Dame de Paris.
Sylvain Dieudonné : Toute musique, toute bonne musique, si elle est à sa place, trouve son sens dans Notre-Dame.
[Générique de début]
Au cœur de Notre-Dame. Une série de podcasts par Passion Médiévistes.
Fanny Cohen Moreau : Bonjour à toutes et à tous ! Bienvenue dans ce quatrième épisode de la série spéciale sur la cathédrale Notre-Dame de Paris du podcast Passion Médiévistes. Je m’appelle Fanny Cohen Moreau et après avoir exploré l’intérieur de Notre-Dame de Paris dans le précédent épisode, je vous propose que nous y restions encore un peu, à l’intérieur de cette cathédrale.
Le sujet du jour, c’est la musique dans Notre-Dame. Et pour commencer, je vous propose qu’on retrouve Olivier de Châlus, l’invité fil rouge de cette série que vous avez pu entendre dans les précédents épisodes.
Olivier de Châlus : La musique est quelque chose d’absolument central dans la liturgie dès les tout premiers temps chrétiens. On sait que les premiers chrétiens se réunissaient premièrement pour rompre le pain, évidemment c’est la messe, mais avec une lecture des textes et des enseignements qui vont avec, et pour chanter. Donc le fait de chanter, c’est quelque chose qui est vraiment dans les racines du christianisme. Et à chaque fois que les chrétiens vont se réunir en communauté, et bien, il va y avoir un temps pour chanter. Le fait de chanter, c’est d’une certaine manière une solution pour élever la voix et donc se faire entendre. Et donc, au fur et à mesure que les communautés chrétiennes vont grossir, qu’elles vont se rassembler dans des espaces qui sont de plus en plus grands, évidemment, la musique va accompagner tout ça parce que la musique va être un moyen pour se faire entendre au fond de l’église. Et puis, et puis elle va prendre une part tout à fait centrale dans la mise en valeur liturgique. Au moment où la cathédrale est construite, on connaît pas grand-chose de l’organisation liturgique. Puis, il y a des conciles régulièrement qui modifient tout un tas de choses. Je pense qu’on manque peut-être d’un éclairage très approfondi du fonctionnement liturgique au XIIe et au XIIIe siècles pour comprendre toutes les subtilités et tous les impacts sur la musique. Quoi qu’il en soit, le fait de construire des églises de plus en plus grandes fait que, ben évidemment, le son va résonner différemment et, ça donne des contraintes, mais ça rend aussi possible certains développements musicaux qui n’étaient pas envisagés auparavant.
Fanny Cohen Moreau : Maintenant, je vous propose de rencontrer une nouvelle personne, quelqu’un qui connaît très bien la musique médiévale.
Sylvain Dieudonné : Sylvain Dieudonné, je suis donc musicien, chef de chœur à la cathédrale de Notre-Dame de Paris dans le cadre de la Maîtrise Notre-Dame de Paris depuis 1994, donc cela fait maintenant plus de 25 ans. Donc, j’étais engagé au départ pour enseigner le chant grégorien, et, ensuite, mon activité s’est développée sur l’ensemble de la musique médiévale et particulièrement sur le patrimoine musical de la cathédrale Notre-Dame de Paris et aux différents chœurs de la Maîtrise.
Fanny Cohen Moreau : Avec Sylvain Dieudonné, nous allons parler, dans cet épisode, de la musique dans Notre-Dame de Paris, à travers son histoire, surtout à l’époque médiévale. Nous allons parler de l’évolution des formes musicales. Mais d’abord, repartons à l’époque de la construction de la cathédrale.
Sylvain Dieudonné : Alors, au moment de la construction de la cathédrale, déjà, c’était pas la première cathédrale [rire], il existait des édifices avant et qui remontent très loin. On a des témoignages de la musique à Notre-Dame, même si ça ne s’appelait pas Notre-Dame à l’époque, en tout cas dans Paris, qui remontent au Ve siècle. On parle de la voix des enfants, de la beauté des voix, etc. Donc c’est déjà une tradition qui est très longue. La musique a pris sa place dans la cathédrale de manière tout à fait naturelle puisque la cathédrale a été construite pour le culte et que la musique est inhérente à la pratique du culte. Donc c’est une partie intégrante de la liturgie solennelle. Forcément, la musique ne pouvait qu’être présente, comme dans tout lieu dédié au culte.
On a quelquefois tendance à l’oublier, mais quand on parle de Notre-Dame, on va tout de suite parler de l’École de Notre-Dame, qui est une école de chant polyphonique qui a un rôle absolument primordial dans l’histoire de la musique occidentale, puisque c’est à cette époque-là qu’on va trouver, inventer et appliquer dans la musique le principe du rythme mesuré, ce qui va permettre de calculer les rencontres de notes et de développer des polyphonies à trois, quatre voix, même déjà à l’époque, à la fin du XIIe siècle. Tandis que jusqu’à présent, les polyphonies étaient cantonnées à deux voix et les notes, contre-notes très, très proches du plain-chant. Ce plain-chant, c’est le quotidien des musiciens de la cathédrale, comme de tout lieu dédié au culte.
Les polyphonies, elles, naissent dans un premier temps de ce plain-chant et elles se développent à partir de lui. Les polyphonies de l’Ecole Notre-Dame, ce qu’on appelle le Magnus liber organi, le grand livre des organum, des organa de Notre-Dame, a été composé tout d’abord par Léonin, puis repris, complété et amplifié par Pérotin à sa suite à la fin du XIIe siècle. Ces extraordinaires polyphoniques sont quelquefois des constructions monumentales, si on pense par exemple au grand Viderunt omnes à quatre voix de Pérotin composé vraiment à la fin du XIIe siècle. Ce sont quelque part des extensions du graduel Viderunt omnes en plain-chant qui existe depuis déjà de nombreux siècles à l’époque, pour le graduel du jour de Noël par exemple. Donc c’est une solennisation des jours importants de l’année, magnifiés comme ça par la polyphonie, qui en même temps va emplir cet édifice nouveau, aux dimensions nouvelles, qui naît.
Néanmoins ce répertoire, il est né non pas une fois la cathédrale achevée, mais pendant la construction de la cathédrale. Donc, ce répertoire extraordinaire accompagne le chantier de la cathédrale Notre-Dame de Paris. De telle façon que ces grandes compositions n’ont pas été composées pour la grande nef, qui n’était pas encore construite, mais plutôt pour le chœur ou les chapelles au fur et à mesure de leur construction.
[Extrait sonore – Concert de Noël 2013 à Notre-Dame de Paris]
Sylvain Dieudonné : Ces grands organum ont perduré, ont été pratiqués pendant un certain temps. Il est intéressant de noter que, en fait, ils n’ont été notés sur manuscrits, on a de très, très beaux manuscrits notés dans les ateliers parisiens au XIIIe siècle, 50 ans plus tard. Donc, oui, on a continué à les chanter à cette époque-là.
D’autres formes se sont ajoutées. On a deux formes particulières qui sont vraiment typiques des répertoires de Notre-Dame. Tout d’abord le « conduit », qui, pense-t-on, pouvait accompagner des processions. La liturgie était très, très processionnelle au Moyen Âge. Et les conduits, ce sont des compositions qui, à la base, ne sont pas basées sur un thème liturgique, mais qui peuvent en être un développement d’un point de vue de la thématique littéraire, souvent écrit en vers d’ailleurs, et donc c’est à la fois une composition littéraire et une composition musicale.
Nous avons également le « motet » qui se développe beaucoup, qui, au départ, est un extrait d’organum sur lequel, comme son nom l’indique, on a rajouté des mots, du texte qui s’est adapté comme un, comme un trope, un ajout, un ajout de texte. Au départ, très certainement, ces textes étaient très liés à la liturgie, mais progressivement, au cours du XIIIe siècle, ils vont s’en détacher. Le motet va devenir une forme indépendante et ils vont pouvoir même porter des textes profanes par exemple, ou même superposer des textes sacrés et des textes profanes. Mais bien sûr, là, on n’est plus dans le cadre de la célébration du culte chrétien. [Sourire]
[Extrait sonore – Concert Motets en espace]
Ce sont vraiment les trois formes principales. Il y a également le « rondo », qui est comme une sorte de conduit, mais peut-être un peu plus populaire. Donc on dit que les rondos étaient très mal vus à l’époque par les clercs, mais ils n’étaient pas chantés dans le sanctuaire, mais plutôt dans la sacristie, même s’ils étaient sur des paroles des fois très édifiantes, bon, on ne voyait pas toujours ça d’un très bon œil. [Rire] Ça a bien changé parce qu’aujourd’hui les clercs adorent ça [rire], mais voilà.
Sinon, une autre forme importante mais qui précède l’école Notre-Dame, qui perdure dans la pratique, c’est la « prose ». Donc, on a eu un poète et musicien absolument génial à Paris, qui est Adam de Saint-Victor et qui a révolutionné l’art de la prose qu’on appelle aussi « séquence » dans d’autres pays. La prose, donc c’est une forme poétique, mise en musique également, qui est chantée à la suite de l’Alléluia les jours de fête, et qui développe quelque part l’idée de cet Alléluia. Adam de Saint-Victor a totalement révolutionné la composition des proses par un style qui est vraiment propre à lui, dont on va s’inspirer ensuite, pendant les siècles qui suivent.
Les répertoires purement de polyphoniques étaient du répertoire soliste, donc c’est vraiment les chantres. Il devait avoir de très bons chanteurs, quand on voit [rire] la difficulté que ça représente et l’investissement en énergie aussi que représente de chanter un organum dans son entier. Mais, ce qui est de l’ordre de la pratique quotidienne, c’est un beaucoup plus grand nombre de personnes, c’est l’ensemble des chanoines qui récitent l’office, qui chantent l’office plutôt, et certainement les enfants qui y sont associés aussi.
Le Moyen Âge possède un instrumentarium extrêmement riche qui nous est connu par une iconographie très abondante, mais cet instrumentarium est utilisé hors du sanctuaire. Toutes ces polyphonies étaient chantées a cappella.
À la suite de l’École Notre-Dame et l’ars antiqua donc au XIIIe siècle, la musique a continué à évoluer bien entendu. Le genre du motet dont on a parlé tout à l’heure s’est énormément développé. L’aspect rythmique des compositions s’est beaucoup développé aussi, avec une complexification qui va grandissante de, au XIVe et jusqu’au XVe. Néanmoins, à Notre-Dame, c’est pas le lieu où cela va se passer. On est à l’époque des papes d’Avignon et donc la musique va surtout se centrer autour de ce pôle d’Avignon et donc ce qu’on appelle l’ars nova. Donc, on a très, très peu d’exemples, enfin même, à vrai dire, je n’en connais qu’un qui puisse être associé à Notre-Dame.
Ensuite, on se dirige vers la Renaissance. Là, on a un petit peu plus de documents. Mais en attendant, ce qui est intéressant, c’est qu’on a la, l’organisation de la Maîtrise au XIVe siècle, avec un règlement, etc., et pas mal de témoignages de la vie de la Maîtrise, des enfants de la Maîtrise qui vivent là en vase clos, dans le cloître de Notre-Dame, et qui assurent les offices. Là, on a par exemple un musicien célèbre qui est passé par Notre-Dame, pas très longtemps, Pierre Certon, qui a été pendant quelque deux années à Notre-Dame, qui s’est fait beaucoup remarquer par son indiscipline, qui jouait au ballon au lieu d’aller à l’office, enfin des choses comme ça, absolument inadmissibles bien entendu [rire], ça ne se verrait pas aujourd’hui bien sûr ! Et qui, finalement, ensuite est parti à la Sainte-Chapelle et a fait toute sa carrière à la Sainte-Chapelle. On a aussi Antoine Brumel qui est passé comme maître de musique à Notre-Dame à la toute fin du XVe. Antoine Brumel ne restait jamais très longtemps au même endroit, il est resté deux ans. Mais il nous a laissé quelques compositions, vraiment, qui ont été composées pour Notre-Dame.
La musique du Moyen Âge est toujours aujourd’hui pratiquée dans la cathédrale, au sein de l’activité liturgique bien entendu, mais également au sein d’une saison de concerts qui lui est particulièrement dédiée, à l’intérieur donc d’une saison de concerts plus large qui englobe tout type de musique. En 1991, le cardinal Lustiger a refondé la Maîtrise, en partenariat avec l’État et la ville de Paris, pour créer Musique Sacrée à Notre-Dame de Paris qui a en charge, donc, toute la musique de la cathédrale sous son aspect cultuel et également de, de concerts. Donc, cette refondation de la Maîtrise est un changement important par rapport à la pratique antérieure qui permet d’intégrer le monde culturel, le monde des chanteurs en particulier donc à cette vie musicale de la cathédrale.
[Extrait sonore – Concert de chant grégorien à Notre-Dame de Paris]
Sylvain Dieudonné : Mon rôle au sein de Musique Sacrée à Notre-Dame de Paris était de valoriser et de pratiquer les répertoires chants grégoriens et tous les répertoires de la musique médiévale, en particulier liés à l’histoire et au patrimoine musical de la cathédrale. Cette activité s’est étendue même jusqu’à la Renaissance, on a exploré un petit peu tous les aspects de ce patrimoine. Cette mission est basée sur, déjà, la transmission auprès des étudiants, enfants, adolescents ou adultes de la Maîtrise. Transmission par les cours, les répétitions, mais également une pratique musicale qu’on veut de, de niveau professionnel, enfin en tout cas professionnalisante, puisqu’il s’agit d’étudiants. Et également liée à nos recherches sur les manuscrits, un retour aux sources constant puisqu’on est dans des types de musique… Il ne suffit pas de prendre une partition et de se dire je vais faire les notes, ça ne marche pas comme ça. [Rire] Ce sont des types de musique, que ce soit le chant grégorien et même l’école Notre-Dame d’ailleurs, qui sont ancrés dans une tradition. La tradition qui est forcément rompue depuis, depuis l’époque mais qu’on s’efforce de retrouver. Et le retour aux sources est une chose absolument capitale pour la compréhension et donc la transmission de cette musique. On ne veut pas transmettre quelque chose qu’on ne comprend pas par définition. Il suffit d’avoir entre les mains un manuscrit du XIe siècle, par exemple, pour se dire qu’on va pas chanter de la même manière, parce que c’est une émotion. On est face à un, souvent un ouvrage d’art, il y a des manuscrits qui sont vraiment splendides, à la fois des enluminures mais d’une qualité artistique vraiment supérieure et l’écriture elle-même, enfin tout est manuscrit bien entendu, il n’y a pas d’ordinateur à l’époque, le soin apporté à chaque détail, sachant qu’il n’y a pas de retour possible, si on se trompe, on peut barrer, éventuellement gratter, si on ne l’a pas déjà fait, le manuscrit, mais c’est tout, donc, on, c’est une concentration. Rien que ça, ça nous met en face de quelque chose qui nous dépasse. On est en communion avec nos, nos pères, nos ancêtres qui ont passé des journées entières à copier avec amour et abnégation peut-être [rire] ces, tout, toutes, toutes ces pages. On a l’exemple à l’abbaye de Saint-Gall d’un moine qui s’est enfermé sa vie entière pour copier l’Antiphonaire, le moine Hartker. Donc il est dans sa cellule, il a, il a copié et c’est le plus ancien manuscrit de l’office noté en musique que nous possédions. Donc, ça, ça nous met face quand même à des choses, tout comme les constructeurs de cathédrales nous mettent face à des choses extraordinaires. Un constructeur de cathédrales, un sculpteur était capable de sculpter une représentation, enfin une statue magnifique qui était à la vue de personne. On ne travaille pas pour notre gloire personnelle, mais on est des, quelque part, on est des transmetteurs. On est là pour transmettre aux générations futures, c’est ce qu’on appelle, c’est le principe de la tradition. En musique, c’est pareil, on n’est pas là pour mettre sa marque, mais on est là pour transmettre, aider à redécouvrir, parce que aujourd’hui, il faut redécouvrir, on est à une époque qui pour ça est absolument formidable puisqu’on est une époque vraiment de la redécouverte des musiques anciennes. Mais on redécouvre pas une musique ancienne pour dire tiens, je vais faire comme à l’époque, parce que d’abord, comment on faisait à l’époque ? Tout le monde a sa petite idée, mais tout le monde a son idée différente. On a des choses qui sont tangibles, mais globalement, comment est-ce qu’on chantait, on sait pas. Mais aujourd’hui, on est là pour transmettre à une génération contemporaine de la musique ancienne qui, aujourd’hui, peut apporter quelque chose aux générations modernes.
Fanny Cohen Moreau : Qu’est-ce que vous préférez entendre comme musique dans Notre-Dame ?
Sylvain Dieudonné : Tout ! [Rires] Toute musique, toute bonne musique, si elle est à sa place, trouve son sens dans Notre-Dame. Le tout, c’est savoir ce qu’on fait et pourquoi on le fait et quel est le sens de chanter telle musique à tel moment. C’est ça qui est important. D’une manière générale, les musiques médiévales sonnent très bien. Les polyphonies de l’École Notre-Dame avec les quintes justes, ça, ça résonne, ça prend vraiment une ampleur très grande. Ensuite, les musiques à gros effectifs, musiques du XIXe par exemple, ça, ça passe, ça passe pas mal. Le répertoire baroque à petit effectif, c’est beaucoup plus difficile. Or, il est vrai qu’aujourd’hui, dans Notre-Dame, la difficulté, c’est qu’on est au cœur de la ville, que la ville est très bruyante et donc on a une pollution sonore qui est très grande. Et donc, pour passer un peu par-dessus cette pollution sonore, on est souvent obligés de recourir à une sonorisation, mesurée bien entendu, mais qui est quand même nécessaire pour transmettre justement aux très nombreuses personnes qui venaient aux concerts ou aux liturgies dans Notre-Dame.
Fanny Cohen Moreau : Cette sonorisation a dû changer quelque chose pour la musique de Notre-Dame.
Sylvain Dieudonné : Ça change forcément quelque chose, mais on, c’est une chose sur laquelle on a beaucoup travaillé par l’expérience aussi au cours des ans, on était arrivé à un point quand même tout à fait intéressant. Un jour, un compositeur étranger de passage à Notre-Dame, que j’ai rencontré après, m’a dit : « Mais, c’est pas sonorisé ? » Et je lui dis « Ben si ! » Il m’a dit « Ben, on s’en aperçoit pas. » À partir du moment où on vous dit ça, de la part de quelqu’un qui a une oreille quand même, c’est que quelque part c’est réussi.
Fanny Cohen Moreau : En quoi consistait le travail de Sylvain Dieudonné au quotidien ? Comment est-ce qu’il préparait ses concerts en tant que chef de chœur de la Maîtrise de Notre-Dame de Paris ? Écoutons-le vous raconter tout ça.
Sylvain Dieudonné : Alors, voilà, j’ai un concert à préparer. Ces concerts, du fait de la présence à Notre-Dame, sont souvent, pas forcément, mais souvent liés aussi au temps liturgique dans lequel on se trouve, par exemple un concert au temps de Noël, on va faire un concert de Noël, c’est assez logique. [Rire] Et bien, je vais chercher des idées à partir du répertoire qu’on connaît pour construire un programme qui soit cohérent, un programme cohérent tant au point de vue littéraire, du propos littéraire, que l’esthétique musicale. Pour ça, je prends plusieurs choses en considération. Tout d’abord, toutes les musiques sacrées de l’époque ont vraiment été composées pour le culte. Si je les chante aux concerts, je les retire de leur écrin naturel, donc je leur fais dire autre chose. Mais pour retrouver cette cohérence, qui est celle du culte, il faut voir comment ça se passait dans le culte.
Prenons un exemple : une polyphonie. Un organum à deux voix. Il est chanté. C’est des pièces qui durent assez longtemps, ça peut durer dix minutes, les triplos ou les quadruplos peuvent durer jusqu’à un quart d’heure, vingt minutes. Donc c’est, pfou, c’est des gros morceaux. Donc, il faut tenir compte aussi de ce temps-là. Mais, quelquefois j’ai assisté à des concerts où on enchaînait un organum, un autre organum, un autre organum, un autre organum. Bah, au bout d’un moment, on en a ras le bol des organum ! [Rire] Parce qu’on sature, parce que ces polyphonies, elles arrivent dans un contexte où on sort du plain-chant, de la monodie, et elles prennent tout leur sens de par cette alternance entre la monodie et la polyphonie. Donc, dans le concert, je vais retrouver cet esprit-là, même si c’est pas forcément une restitution d’office, ce qui m’est arrivé de faire aussi, je vais pas enchaîner deux organum, deux organa de suite, ça n’a pas de sens. Voilà, l’organum était chanté après une lecture qui était cantillée sur trois notes, donc on passe de deux, trois notes comme ça à un spectre gigantesque et ça prend une dimension absolument géniale.
De même que la cathédrale aujourd’hui, on la voit de loin, il y a le parvis, enfin aujourd’hui, avant l’incendie, il y a le parvis là. Mais à l’époque, il y avait des maisons sur le parvis. La cathédrale surgissait d’un seul coup comme ça. Donc la vision qu’on en avait était totalement différente de ce qu’on a aujourd’hui. Donc ça, c’est un point, je veux dire, un point esthétique, mais qui est basé aussi sur une réalité historique et scientifique.
Ensuite, je vais farfouiner dans les manuscrits, voir ce qui existe, ce que proposent les manuscrits comme réalisations polyphoniques ou comme tropes, ou comme textes, comme pièces originales. Il y a aussi des pièces de plain-chant qu’on peut trouver dans les répertoires parisiens, mais pas, pas ailleurs. Et donc je collectionne tout ça et je construis mon programme à partir de ça.
À partir de là, tout ça, c’est pas édité, ou quand c’est édité, c’est mal édité, donc ça revient au même. [Sourire] Donc à partir des manuscrits, je transcris les pièces qu’il faut également traduire dans un français pas trop mauvais de préférence, éditer des livrets pour les chanteurs, éditer les livrets pour le public avec les bonnes traductions et éventuellement quelques commentaires, travailler avec les chanteurs, répéter. Répétitions avec les chanteurs étudiants qui sont des répétitions aussi liées à une pédagogie, bien entendu. Et puis, ensuite, on prépare le concert, on chante le concert et après on va prendre un pot. [Rires]
Notre-Dame est un lieu touristique, c’est un secret pour personne. Un des monuments les plus visités de France et donc le public qu’on a là-bas est un public très international. C’est un public qui vient avant tout pour la cathédrale. La plupart des gens ne viennent pas pour écouter tel chef ou tel chef. Ils connaissent même pas, ça, ça n’a aucune importance. Ils viennent même pas pour écouter la Maîtrise. Ils viennent pour écouter un concert à Notre-Dame. Et quelquefois même, ils viennent simplement pour Notre-Dame, parce qu’ils sont pas au courant qu’il y a un concert. Une fois, j’ai, avant un concert, j’ai rencontré une personne comme ça qui allait dans des lieux où elle avait pas à se trouver dans la cathédrale, je lui dis « Bah écoutez non, vous ne pouvez pas aller là. » Elle dit « Mais pourquoi ?! J’ai payé mon entrée pour visiter la cathédrale ! » Je lui dis : « Ben non, vous n’avez pas payé votre entrée pour visiter la cathédrale, vous avez payé l’entrée pour écouter un concert. » « Ah bon ? Il y a un concert ce soir ? » « Et… bah oui. » « Ah bon, ah bah c’est super ! » Et du coup ils se sont, ils se sont assis et, après ça, ils sont venus me remercier, comme quoi ils avaient été charmés d’avoir un concert là. [Rire]
Ça, c’est la vie de Notre-Dame. Les gens viennent, ils viennent à la messe là, parce que c’est Notre-Dame. Ils viennent pas parce que c’est tel ou tel curé, ou même tel ou tel archevêque. Si, en fait, il y a le public parisien qui vient pour suivre l’archevêque, c’est, d’accord, mais la plupart des gens viennent parce que c’est Notre-Dame.
[Extrait sonore – Concert de chant grégorien à Notre-Dame de Paris]
Sylvain Dieudonné : Le soir de l’incendie, j’avais une répétition générale. On était le lundi, lendemain des Rameaux, j’avais un concert qui était le concert de la Semaine Sainte le mardi. Au moment où l’incendie s’est déclaré, normalement, j’aurais dû être dans la cathédrale, mais j’y étais pas parce qu’on a une répétition qui a pris du retard, et donc je suis sorti de ma répétition, j’étais avec mes vielles et je courais dans la rue pour arriver vite à la cathédrale. J’aime bien être en avance pour prendre le temps de me poser et de prendre la dimension du lieu, parce que c’est un lieu qui, même quand on a l’habitude, qui est difficile, il faut prendre le temps de se l’apprivoiser, etc.
En sortant de la Maîtrise qui, qui est au boulevard Saint-Germain, j’ai failli me faire renverser par un camion de pompiers [sourire] et je me suis dit en moi-même : « Ils sont, sont fous, enfin ils cherchent des clients, je sais pas… ». [Rires] Et j’arrive place Maubert et je vois tout le monde avec son portable en train de regarder comme ça. Et puis là je fais la relation avec le camion de pompier, je me dis, bon à tous les coups, il y a un immeuble qui brûle encore.
Et puis je regarde par la rue, et puis je vois la fumée sortir au niveau de la flèche… [silence] Alors là, tout, tout s’écroule… Enfin, en moi, parce que la flèche c’était plus tard. Et je m’avance autant que je peux, donc juste devant, devant le pont. Et donc là, oui, j’ai assisté à [soupir], à la disparition de toute la toiture en trois quarts d’heure. C’était très, très, très rapide, donc j’ai vu la flèche s’écrouler. Et quand j’ai vu que les flammes commençaient à s’approcher des tours, je suis parti parce que je supportais plus. Sachant très bien en moi-même que si les tours étaient prises par l’incendie, c’était, c’était fini, il y avait plus rien. Ce qui était de fait le cas puisque les, les pompiers ont eu justement cette, ce professionnalisme de protéger les tours, sachant que de toute façon, une fois que c’était parti, la charpente, on pouvait plus rien faire. C’était ça, ou alors… En tout cas, c’est pas les canadairs de Trump qui auraient sauvé quelque chose. [Rire]
Ensuite, bah c’est vrai que voyant le, la, la charpente, la forêt, vieille de 800 ans, qu’on voyait sous forme de braises s’écrouler les uns après les autres, à la fois à titre personnel, enfin je voyais vingt-cinq ans de ma vie partir en fumée et 800 ans d’histoire… [Silence] L’impression qu’une page se tournait, que plus rien serait comme avant, qu’il y aurait d’ailleurs plus rien, on ne savait pas trop. Voilà. Et donc oui, c’était un moment traumatisant, oui…
Fanny Cohen Moreau : Merci.
[Générique de fin]
Fanny Cohen Moreau : Merci beaucoup à Sylvain Dieudonné pour son témoignage. Grâce à lui, maintenant, vous en savez beaucoup plus sur la musique au Moyen Âge et sur la musique de Notre-Dame de Paris. Dans le prochain épisode de cette série spéciale, nous allons continuer de parler du son de la cathédrale, mais cette fois sous l’angle de la restauration. Comment restaurer le son de Notre-Dame de Paris ?
Merci beaucoup à Clément Nouguier qui a réalisé le générique de cette série, à Din pour la magnifique illustration, à Jonathan, le mec d’Ozef, pour le montage. Et encore merci aux personnes qui soutiennent Passion Médiévistes sur Tipeee et qui ont permis le financement de cette série spéciale.
Mylène Pardoen : Et dans Notre-Dame, moi le, à chaque fois que j’y suis allée, ce qui était très présent, c’était l’ambiance feutrée de Notre-Dame.
Merci à Luc pour la transcription et à Maud pour la relecture !
.
Épisode 5 : Restaurer l’acoustique de la cathédrale

L’incendie de Notre-Dame de Paris et l’effondrement d’une partie des voûtes a considérablement changé l’acoustique de la cathédrale. Dans cet épisode, je vous propose de rencontrer Mylène Pardoen, archéologue du paysage sonore et musicologue au CNRS (qui notamment réalisé un modèle sonore de Paris au XVIIIème siècle), qui élabore un modèle informatique sonore qui aidera à la restauration. L’objectif est de rendre à la cathédrale retrouve son acoustique exceptionnelle et son ambiance feutrée d’avant l’incendie et de proposer un diagnostique.
Mylène Pardoen raconte comment elle travaille pour établir ce modèle sonore, comment elle a observé avec les oreilles et visuellement pour capter l’acoustique du lieu, et comment réfléchir pour mettre en place un dispositif particulier. Depuis cet entretien elle a pu rentrer plusieurs fois dans la cathédrâle, et pour en savoir plus sur son travail et sur les modèles sonores de Notre-Dame vous pouvez consulter les sites suivants :
- Acoustic Task Force Notre-Dame
- “Brut de rushs”, une web-série vidéo de format court qui montre des rushs du groupe de travail Acoustique (CNRS / Notre-Dame de Paris)
- Ghost Orchestra Project, la recréation en 2016 de l’acoustique de Notre-Dame de Paris grâce à la réalité virtuelle
- Comment reconstruire le son de Notre-Dame ? (article CNRS de novembre 2019)
Mylène Pardoen : Aujourd’hui, c’est une cathédrale qui ne vit plus ni par ses prières ou par son tourisme, mais qui vit par l’extérieur qui rentre.
[Générique de début]
Au cœur de Notre-Dame. Une série de podcasts par Passion Médiévistes.
Fanny Cohen Moreau : Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce cinquième épisode de la série spéciale sur la cathédrale Notre-Dame de Paris du podcast Passion Médiévistes. Je m’appelle Fanny Cohen Moreau et après un épisode pour parler de la musique dans la cathédrale Notre-Dame de Paris, je vous propose qu’on s’intéresse à son son, à son acoustique, à ce que vous pouviez entendre si vous marchiez dans le monument en milieu de journée, au milieu des touristes.
[Intermède sonore]
Mylène Pardoen : Je m’appelle Mylène Pardoen, je suis archéologue du paysage sonore et je travaille à la Maison des Sciences de l’Homme de Lyon-Saint-Étienne. Donc, je fais souvent les trajets pour venir sur Paris, voir Notre-Dame, l’écouter.
Fanny Cohen Moreau : Avec Mylène Pardoen, je discutais début décembre 2019 de comment restaurer le son de Notre-Dame de Paris et elle racontait son rôle au sein de cette importante mission.
Mylène Pardoen : Moi, je suis responsable et co-responsable, co-coordinateur du groupe acoustique qui a été mandaté par le CNRS, on est un noyau de six personnes, deux responsables, moi pour le paysage sonore et un acousticien, Brian Katz, qui est à l’Institut Jean le Rond d’Alembert, le laboratoire le LAM [ndlr : Lutheries – Acoustique – Musique]. À nous deux, on va pouvoir étudier tout ce qui est sonore dans Notre-Dame. Notre mission, c’est, voilà, l’étude, en gros, on qualifie d’acoustique, mais c’est une acoustique au sens le plus large qui soit.
Fanny Cohen Moreau : Avant l’incendie, quelles étaient ou quelles sont les particularités de l’acoustique de Notre-Dame?
Mylène Pardoen : Déjà, c’est une acoustique avec une grande réverbération. Quand on tape dans les mains, ça va, on va entendre le son qui court très longtemps. Et d’ailleurs, pour pallier à ça, et éviter, puisque c’est un lieu mixte, Notre-Dame, c’est un lieu de prière et c’est un lieu touristique, au sol, sur le trajet des touristes, il y avait des tapis pour éviter que le bruit des pas ne vienne perturber la sérénité des lieux. Donc l’acoustique, elle était, elle était celle d’une église ou d’une cathédrale, avec beaucoup de réverbération, là où on peut faire aussi des jeux acoustiques par la suite quand on est compositeur.
Fanny Cohen Moreau : Vous avez beaucoup travaillé sur l’acoustique de Paris, mais vous avez travaillé aussi sur l’acoustique de Notre-Dame dans les siècles précédents ?
Mylène Pardoen : Alors, moi, non. Brian Katz, lui, il a un modèle acoustique de 2013, qui servira de modèle de référence. Moi, j’étais pas très, très loin de Notre-Dame, mais j’ai pu travailler sur le quartier du Grand Châtelet et le pont au Change, et j’avais quand même en prévision de, de venir grappiller sur l’île de la Cité. Bonne opportunité ou mauvaise opportunité, bah, seul l’avenir le dira. Quoi qu’il en soit, bah voilà, le travail que je fais moi sur le XVIIIe siècle autour de l’île de la Cité, on va dire, pour faire simple, et bien je peux le transposer, puisque ce sont des méthodologies, je peux le transposer pour étudier autour de Notre-Dame à des périodes différentes, puisque là aussi on est sur de la méthodologie.
[Extrait sonore : Visite de Paris au XVIIIe siècle (quartier du Grand Châtelet), Projet Bretez]
Fanny Cohen Moreau : Comment est-ce que vous travaillez justement pour reconstituer les sons du XVIIIe siècle ou de d’autres époques ?
Mylène Pardoen : Pas d’enregistrement, donc on est obligé de fouiller toutes les, toutes les sources qu’on a à disposition. Toutes les sources, c’est au sens là aussi le plus large. On a les sources textuelles et les sources iconographiques. Dans les textuelles, on a tout ce qui est littérature, tout ce qui est presse, tout ce qui est quotidien quoi, tout ce qui est documents administratifs, les PV de police. Nous avons également tout ce qui est registres des testaments, les devis des travaux. Tout ça, ça va nous donner un paysage sonore. Du côté du visuel, on a tout ce qui est tableaux, tout ce qui est plans, tout ce qui est gravures, objets du quotidien parce qu’ils sont aussi très décorés. Donc, ça nous amène des images sonores de l’époque.
Après, c’est à nous à y déchiffrer, à faire ce gros effort intellectuel de se dire : est-ce que c’est sonore ou est-ce que ce n’est pas sonore ? Souvent, c’est sonore puisque comme ils n’ont pas les technologies pour enregistrer, ils nous laissent des traces de la sensorialité de l’époque. C’est pas que sonore, c’est sonore, c’est olfactif, c’est, enfin voilà, ça transparaît dans leurs documents. Mais c’est une façon de lire le passé qui fait ressortir toutes ces zones-là qui aujourd’hui, pour nous contemporains, ne viennent pas tout de suite à l’esprit.
[Extrait sonore : Ghost Orchestra Project]
Mylène Pardoen : Alors nous, on a eu l’opportunité avec Brian de rentrer dans Notre-Dame fin juillet. Ce qu’il faut bien comprendre, c’est que, je vais vous sembler peut-être très, très sèche, sans sentiment, mais on n’a que deux heures pour rentrer dans Notre-Dame, donc on n’a pas la place de se dire, de s’émouvoir, de dire « Oh mon Dieu, comment c’est ? » On a des sentiments, certes, mais ce qui compte avant toute chose, c’est prendre des repères, regarder ce qui se passe, qu’est-ce qu’on peut faire, qu’est-ce qui est changé. Donc voilà, on fait plutôt un bilan, un constat assez froid et ensuite on peut passer sur ce qu’on a peut-être hypothétiquement laissé, ressenti à ce moment-là.
Donc quand on est rentré, le grand changement, c’est la lumière. Notre-Dame était noire, était sombre, aujourd’hui, elle est claire. La voûte s’est effondrée à trois endroits, donc la lumière du jour rentre dans Notre-Dame et il n’y a plus de vitraux. Donc là aussi, là où il y avait des vitraux qui étaient sombres, pas forcément parce que le vitrail était sombre par lui-même, mais parce qu’il était entaché d’une pollution visuelle, les sons rentrent, la lumière rentre. Donc aujourd’hui, c’est une cathédrale qui ne vit plus ni, pour l’instant, par ses prières ou par son tourisme, mais qui vit par l’extérieur qui rentre. Puisque les bruits rentrent, la lumière rentre. Donc quelque part, ça fait une grosse modification au niveau de l’établissement par lui-même, du bâti.
Après, moi, ce qui m’a surpris, c’est l’odeur. Parce que quand même, on était au mois de juillet et ça sentait énormément encore le bois brûlé, l’incendie et le plomb fondu. C’est une odeur particulière qui colle au fond des narines. Donc voilà, nous, c’est ce qu’on a vu. Ce qu’on a vu également, le constat qu’on a fait, c’est qu’il y avait encore les bancs de prières et toutes ces installations, avec les petites bougies. Alors les bougies ne brûlaient plus, mais elles étaient encore présentes. Donc c’est comme si la vie, elle s’était figée. Quelque part, on a fait le constat d’avoir, comme si on était à Pompéi. Hop, le temps s’est arrêté. Il y a quand même des gens qui travaillent, mais quelque part, le temps s’est figé à ce moment-là. C’est à la fois intéressant et troublant. Un arrêt du temps, c’est relativement rare de le constater. Et pourtant, la vie, elle continue. C’est le paradoxe de Notre-Dame, de découvrir Notre-Dame sous des aspects sur lesquels on ne les avait pas.
[Intermède sonore]
Fanny Cohen Moreau : Parce qu’avant, on imagine bien le brouhaha qui pouvait y avoir un peu en continu. Et là, est-ce qu’il y a une forme de silence ou c’est juste une sorte, un autre bruit, un autre brouhaha qui a remplacé ?
Mylène Pardoen : Alors non, il y a pas de silence puisque, même nous quand on y est allé, il y avait des travaux. Donc systématiquement, il y a l’aspirateur qui fonctionne, enfin, il y a un gros aspirateur pour nettoyer les voûtes au-dessus. Donc, il y a tout le temps du bruit, mais pas le même bruit.
Fanny Cohen Moreau : Et on entend beaucoup plus le bruit de la ville forcément ?
Mylène Pardoen : Voilà ! Les porosités de l’extérieur, elles sont plus présentes, puisqu’il y a plus rien pratiquement pour les filtrer. C’est pas qu’il n’y en avait pas avant. On n’y avait pas accès parce qu’on était focalisé par d’autres ambiances. En fait, nos oreilles, vous êtes dans le son donc, nos oreilles, elles fonctionnent différemment. Quand on est dans une ambiance, on a notre oreille qui va chercher les sons et notre oreille qui capte l’ambiance.
Et dans Notre-Dame, moi, à chaque fois que j’y suis allée, ce qui, ce qui était très présent, c’était l’ambiance feutrée de Notre-Dame. Et on avait tout mis en œuvre, en tout cas tous ceux qui œuvraient pour la sérénité du lieu, avaient tout mis en œuvre pour que cette ambiance feutrée, elle soit présente malgré le public. Aujourd’hui, bah non, c’est un lieu de travail. C’est plus vraiment un lieu de recueillement, de prière ou de visite, mais c’est un lieu de travail. Donc, il y a le bruit des ouvriers et de toutes les machines qui sont autour.
Fanny Cohen Moreau : Lors de ces quelques heures où vous avez pu être dans Notre-Dame, qu’est-ce que vous avez fait concrètement comme travail, à part, bien sûr, écouter ?
Mylène Pardoen : On a énormément observé, pas seulement avec les oreilles, on a aussi observé visuellement parce que, parce qu’il y a des zones où l’on ne peut, dans lesquelles l’on ne peut pas rentrer. La nef, le transept, la croisée du transept, on ne peut pas rentrer. Or, pour capter normalement l’acoustique du lieu, il faudrait qu’on y rentre, qu’on y pose nos dispositifs. Donc, c’était, le but, c’était de voir quelles étaient les stratégies qu’on pourra développer lorsqu’on pourra rentrer. On n’a que deux heures. Deux heures, c’est l’installation du dispositif. On ressort. On est obligé d’attendre à nouveau deux heures et on pourra travailler deux heures. Brian va émettre des sons via des haut-parleurs et des amplis et puis on va recapter avec des micros ces sons-là.
Fanny Cohen Moreau : L’objectif de ces travaux, est-ce que c’est de reconstituer, d’aider à reconstituer le son de Notre-Dame ou est-ce que cet idéal n’est pas possible, n’est plus possible ?
Mylène Pardoen : Bah, à l’impossible, nul n’est tenu, hein, mais non, nous, déjà on ne fait que des préconisations, on va quand même tendre à ce que Notre-Dame retrouve son acoustique, en sachant que l’acoustique de Notre-Dame, c’est la voûte, c’est pas la charpente. À notre niveau, on va avoir aucune, aucun avis sur ce qu’on va mettre au-dessus de la voûte. On va juste dire, voilà, pour retrouver l’acoustique, c’est ça qu’il faut. Donc, il faut que la voûte, elle retrouve ses caractéristiques acoustiques. Donc, il va y avoir vraiment un état des lieux qui doit être fait au niveau de la voûte, c’est-à-dire les pierres qui ont brûlé, elles n’ont plus la capacité, la même capacité de réflexion du son, donc il faudra voir si on doit les changer ou pas. Au niveau de la voûte, nous, on va avoir un diagnostic sur la voûte, sur le volume acoustique. Donc on a trois axes de, de recherche qui nous sont donnés au niveau du CNRS. Le premier, c’est l’acoustique. Le modèle acoustique de 2013 qui va nous servir de point de référence, mais pas de point de référence pour le début des travaux, puisque c’est la première captation qui servira de top départ. Et à chaque fois qu’il va y avoir des changements, des modifications relativement importantes, on va refaire une captation pour voir où on en est dans l’état par rapport à ce qu’on a, parce que le modèle initial, il n’est pas complet. Voilà, ça c’est la première de nos missions, c’est retrouver l’acoustique pour l’orgue et pour les choristes qui œuvraient à l’intérieur de Notre-Dame et qui aujourd’hui sont un peu orphelins.
[Intermède musical]
La deuxième mission, c’est tous nos relevés acoustiques, on va les associer aux modèles virtuels, visuels, qui sont eux dans un autre groupe, qui est dans le groupe du numérique avec Livio De Luca. Donc on va travailler avec lui pour donner nos données, numériques ou pas, et associer nos modèles pour que le visuel devienne aussi sonore. Donc, il y a un travail qui va se faire dessus, sur la juxtaposition des deux modèles.
Et la troisième, le troisième grand axe, c’est tout ce qui est patrimonialisation matérielle.
Alors ce que j’ai oublié de dire, c’est que pour le deuxième modèle acoustique, là, moi, en tant qu’archéologue du paysage sonore, je vais intervenir puisque, Notre-Dame, c’est l’acoustique de Notre-Dame, ce sont les ambiances sonores de Notre-Dame et ce sont les ambiances sonores extérieures à Notre-Dame.
Donc, à partir du moment où on aura une date qui nous sera donnée, avant par exemple 1250 ou après, eh bien, on va avoir un gros travail de restitution des acoustiques et des ambiances, qui viendront avant 1250, parce que je pense que c’est le moment où on a abattu le jubé. Donc il y a un jubé qui coupe en deux Notre-Dame. Donc, un jubé c’est une paroi qui sépare les laïcs des moines et qui a une très forte incidence sur la propagation des sons. C’est pas forcément un mur en dur, ça peut être quelque chose de poreux, mais quoi qu’il en soit, ça a une incidence entre les deux, soit parce que les rideaux sont tirés, soit parce que, comme à Brou, c’est quand même en dur et c’est pas forcément en bois. On va faire en fonction de ce qu’on nous demande. Si on a du mobilier en plus, des tentures, des tapis, on va pouvoir les ajouter. Donc ça, c’est dans Notre-Dame.
Et à l’extérieur, il faut savoir que le parvis était beaucoup plus petit, l’urbain était beaucoup plus dense et comme il est plus dense, il y a beaucoup plus de bruits dans les rues qui vont entrer dans Notre-Dame.
Et donc la troisième partie, c’est la patrimonialisation immatérielle, c’est-à-dire qu’on a pour mission de capter tous les acteurs qui œuvreront à la reconstitution de, à la restauration et la reconstitution de Notre-Dame.
Moi, je dis, actuellement, on est sur une bascule au niveau de nos recherches, on n’est plus sur du quantitatif mais bien sur du qualitatif, de l’humain, de la sensorialité, où ça devient plus complexe, puisqu’il y a toutes les caractéristiques qui sont liées à nos personnalités et nos perceptions contemporaines sur lesquelles on est obligé de faire un gros travail parce qu’on va chercher des perceptions dans le passé sur lesquelles il y a très peu de discours. Donc il faut réellement faire fi de tous nos, nos référents contemporains et voir comment ça peut sonner dans le passé.
Le but c’est de faire un espèce de grand vaisseau spatial, spatio-temporel qui nous permet par modélisation de remonter le temps ou de se projeter. C’est-à-dire que comme ce sont des modèles virtuels, admettons qu’on veuille adjoindre une nouvelle chapelle à Notre-Dame, pour des raisons x ou y, et bien, on va faire appel à notre modèle acoustique en disant : « bah, quelles sont les caractéristiques de cette nouvelle chapelle et est-ce que ça va avoir une incidence sur l’acoustique de Notre-Dame ? » On peut aller jusque-là. On va vraiment faire un grand voyage dans le temps, à la fois dans le passé pour montrer, pour faire écouter ce qu’ont pu entendre les personnes dans le passé, à la fois en tant qu’acteur, je peux être choriste et voir ce que ça donne, je peux être à l’intérieur et auditeur et voir ce que ça donne, mais aussi dans le futur.
L’acoustique d’un lieu est liée à son bâti. Toutes nos parties à nous, sans les autres, on n’est pas grand-chose. Mais à l’extérieur, là on est dans une pièce, mais à l’extérieur il y a aussi une acoustique de rue. Donc voilà, l’acoustique, elle est présente partout, mais on le voit pas, donc moi je dis toujours Brian, il s’occupe de la bouteille, du flacon, moi je m’occupe du nectar qu’il y a dans le flacon. Tout ça c’est pour le plaisir de nos oreilles.
[Intermède sonore]
On va faire des prélèvements dans Notre-Dame. Tout le travail, il se fait ailleurs, il se fait en laboratoire. Le modèle acoustique, il est en laboratoire. Nous, en tant que, puisque moi, je suis pas toute seule, j’ai quelqu’un qui, qui m’épaule maintenant pour faire les captations. C’est pareil, on va faire des captations, on va les faire in situ. Mais après, on les retravaille en studio. On va pas les modifier, on va les nettoyer. Notre spécificité, c’est que, par rapport à des vrais archéologues on va dire, qui sont sur le terrain, qui vont faire des carottages, qui vont nettoyer, qui, comme actuellement ils sont sur le chantier, nous, sur le chantier, on fait juste des prélèvements. Après, notre matière, elle est, elle se fait à l’extérieur avec les moyens informatiques. La spécificité, c’est donc, on peut aller dans le passé et on peut regarder le passé, mais on est obligé d’avoir un pied dans le présent, voir dans le futur.
Alors, on a un premier mandat de cinq ans qui nous est donné par le CNRS, qui a déjà, nous a fait comprendre que ça durerait plus longtemps que les cinq ans. Cinq ans, c’est pas forcément tenable. Le chantier, là, on va pouvoir hypothétiquement rentrer en 2020. Donc 2020, ça sera l’année du diagnostic. C’est pas l’année de restauration. Donc, ça veut dire que la restauration ne débutera qu’en 2021. Alors, on n’est pas sur les mêmes, on est bien d’accord, on n’est pas sur les mêmes temps entre ce qui se passe, le temps politique, de la décision politique et le temps de la recherche. Mais, je fais juste un petit focus : l’incendie, il a eu lieu le 15 avril, à peu près une semaine après, les archéologues étaient sur place pour travailler. Le temps politique, et je pointe bien ça, le temps politique, je dis pas l’annonce, l’annonce, le soir même, ça y est, c’était bon, dans cinq ans, c’était refait, le temps politique, c’est au mois d’août, on a commencé à avoir les premiers textes à l’étude pour l’établissement public d’administration. Et on voit aujourd’hui, nous sommes en décembre, l’établissement, il commence seulement à émerger. Il y a vraiment des temps qui sont différents, qui vont se confronter, qui vont se télescoper. Nous, dans la recherche, on a l’habitude de dire qu’on est dans le temps long, pas forcément. Ce qui est long, c’est pas la prise, la captation, c’est l’analyse des résultats. Donc voilà, on est sur des confrontations de temporalité et des discours qui sont complètement différents.
[Générique de fin]
Fanny Cohen Moreau : Effectivement, nous sommes sur des temps longs avec Notre-Dame de Paris. Depuis cet entretien, Mylène Pardoen a pu entrer de nouveau dans la cathédrale, elle y travaille même assez fréquemment. Je vous mettrai dans la description de cet épisode et sur le site passionmédiévistes.fr des vidéos et des liens pour en savoir plus sur l’avancée de son travail.
Et, en effet, les travaux de restauration ont déjà bien avancé à l’heure où sort ce podcast en janvier 2021. Et d’ailleurs, ce sera le sujet du prochain épisode de cette série spéciale où nous retrouverons le doctorant Olivier de Châlus.
Merci beaucoup à Clément Nouguier qui a réalisé le générique de cette série, à Din pour la magnifique illustration, à Jonathan, le mec d’Ozef, pour le montage, et encore merci aux personnes qui soutiennent Passion Médiévistes sur Tipeee et qui ont permis le financement de cette série spéciale.
Oliver de Châlus : Il faut d’abord se dire que la charpente est un objet patrimonial, était un objet patrimonial et qu’il faut en refaire un objet patrimonial.
Merci à Luc pour la transcription et à Maud pour la relecture !
.
Épisode 6 : Les enjeux de la restauration de la cathédrale

Dans cet épisode, je vous propose de retrouver Olivier de Châlus, le doctorant qui travaille sur la construction de la cathédrale, et que vous avez pu entendre dans les épisodes précédents. Je vous propose de l’écouter vous donner son point de vue sur les enjeux de la future restauration de l’édifice. Cette interview ayant été enregistrée fin 2019, certaines réflexions et hypothèses auront déjà trouvé des réponses, mais je pense que ses réflexions sont toujours toujours très intéressantes à écouter.
Tout d’abord, Olivier de Châlus évoque les problématiques autour de la restauration de la charpente de la cathédrale, puis il parle de ce qui pourrait être possible pour la restauration de la flèche.
Pour en savoir plus sur les travaux de restauration de la cathédrale voici quelques liens :
Olivier de Châlus : Derrière cette charpente, il y a une forêt.
[Générique de début]
Au cœur de Notre-Dame. Une série de podcasts par Passion Médiévistes.
Fanny Cohen Moreau : Bonjour à toutes et à tous ! Bienvenue dans ce sixième épisode de la série spéciale sur la cathédrale Notre-Dame de Paris du podcast Passion Médiévistes. Je m’appelle Fanny Cohen Moreau et dans cet épisode, je vous propose de retrouver Olivier de Châlus, le doctorant qui travaille sur la construction de la cathédrale et que vous avez pu entendre dans les épisodes précédents. Je vous propose de l’écouter vous donner son point de vue sur les enjeux de la future restauration. Juste une chose, cette interview ayant été enregistrée fin 2019, certaines réflexions et hypothèses auront déjà trouvé des réponses, mais je pense que ses réflexions sont toujours intéressantes à écouter.
Tout d’abord, Olivier de Châlus évoque les problématiques autour de la restauration de la charpente de la cathédrale.
Olivier de Châlus : Alors, déjà, il faut reconstruire une charpente parce que la charpente a une fonction que seule une charpente peut garantir, qui est de porter une couverture qui permet à l’édifice de ne pas être trempé à chaque fois qu’il y a une averse. Donc, il faut construire une charpente. Ensuite, est-ce que la charpente doit être en bois ? Est-ce qu’elle doit être dans un autre matériau ? Il y a des arguments pour, il y a des arguments contre. Je pense que, il faut d’abord se dire que la charpente est un objet patrimonial, était un objet patrimonial et qu’il faut en refaire un objet patrimonial. Et là, je pense qu’il faut se poser la question de pourquoi est-ce que cette charpente, elle était si précieuse ? Elle était pas si précieuse parce qu’elle était cachée et que personne ne la voyait et que, du coup, elle générait dans l’imaginaire des gens quelque chose d’un petit peu féerique. Enfin, ça peut contribuer ou apporter des éléments de réponse, mais pour les gens qui s’intéressent au patrimoine et qui la connaissaient, elle avait une valeur en tant que telle.
Alors, la valeur d’une charpente comme celle qu’avait Notre-Dame, je pense qu’elle réside d’abord dans le fait qu’elle est assez unique. On n’a pas beaucoup de grandes charpentes médiévales qu’on ait conservées en France. En Île-de-France, il en reste deux, celle de la cathédrale de Meaux et celle de la collégiale de Mantes. Maintenant, même si les époques de construction de ces deux édifices sont à peu près les mêmes que celle de Notre-Dame de Paris, c’est pas pour autant que les charpentes sont mises en œuvre en même temps. Et en fait, bah forcément, les évolutions des techniques de charpenterie font que, entre une charpente qu’on va construire une année donnée et une charpente qu’on va construire 20 ans après, ben, il va y avoir des écarts.
Et, en fait, il faut, à chaque fois qu’on réfléchit à ces questions ou à ces édifices, les considérer pour eux-mêmes, mais aussi voir comment est-ce que ce qu’ils nous racontent résonne dans un ensemble d’objets qui nous parlent de la civilisation médiévale. Du Moyen Âge finalement, des éléments bâtis qu’on ait conservés en quantité, bah, il y a que les églises. On a quelques forteresses, mais enfin, c’est un petit peu disséminé, on a quelques ponts, on a quelques demeures seigneuriales, mais ce qu’on a vraiment conservé, je dirais, en série, et qu’on peut analyser en série pour comprendre, rentrer dans l’histoire des techniques, ce sont les églises, et les charpentes faisant partie de cet ensemble nous donnent un éclairage. Donc la charpente de Notre-Dame, elle était intéressante parce qu’elle faisait partie d’une série et que cette série de charpentes nous permet de comprendre l’évolution de la pensée humaine.
Quand j’ai commencé ma thèse, mon directeur de thèse m’a dit : « Vous pouvez bien étudier ce que vous voulez, mais si vous oubliez l’homme, vous n’avez rien compris. », et je pense que la question, elle est là. C’est qui l’homme qui construit cette charpente ? C’est quoi ses problèmes ? Le but du jeu c’est, pour moi, de m’asseoir à côté de lui dans son chantier et de le regarder faire et, entre guillemets, d’être un petit peu compatissant, [sourire] de souffrir avec lui dans les démarches intellectuelles qu’il doit faire et d’essayer de l’accompagner dans, dans ses pensées, et d’essayer de me nourrir de ce que mon imaginaire me reflète de ce qu’il est en train de faire.
[Intermède musical]
Ensuite, ce que cette charpente avait de particulier pour elle-même, c’était évidemment toutes ces marques de charpenterie qui numérotaient les pièces qui nous permettaient de comprendre concrètement comment est-ce qu’elle a été assemblée. Parce qu’une charpente, c’est un objet qui est préfabriqué, qui est fait de panneaux successifs qu’on appelle des fermes, qui ont des formes de triangles globalement, pour simplifier les choses. Et ces triangles donc, qui, à Notre-Dame de Paris, faisaient quinze mètres de côté, grosso modo imaginons un triangle équilatéral de quinze mètres de côté ou quatorze mètres de côté, c’est à peu près ça. Donc quinze mètres, c’est un immeuble de quatre, cinq étages, hein. C’est conséquent en termes de taille. Et bien, ces grands triangles-là, il y en avait un tous les 80 centimètres, à peu près, alors il y en avait qui étaient un petit peu plus denses que d’autres, je passe un peu le détail. Et donc évidemment, derrière cette charpente, il y a une forêt. Il y a le terme de forêt qui était communément utilisé pour la désigner. Et en fait, ce terme de forêt vient du fait qu’il a fallu une forêt pour bâtir cette charpente, pour récupérer les pièces de bois dont on avait besoin.
Alors, on sait pas quelle est cette forêt, s’il s’agissait véritablement d’une forêt unique, c’est un surnom qu’elle a pris je ne sais pas à quelle époque. Mais toujours est-il que, derrière ça, il y a un enjeu de production de bois. Et, en fait, quand on a des données dendrochronologiques, c’est à dire une datation qu’on peut faire d’une pièce de bois par l’analyse des fibres du bois, en fait, les cernes du bois sont plus ou moins espacées selon que les années sont plus ou moins bonnes pour que l’arbre pousse. Et donc en fait, on a des années avec des cernes plus resserrées, d’autres avec des cernes plus espacées et, en fait, ça nous donne des séries un peu comme un code-barres, et après on récupère la pièce de bois, on regarde ses cernes et on peut dire, bah, tiens, cet arbre-là a été abattu au printemps 1252, il avait 54 ans. Et on peut faire ce genre d’étude à l’échelle de la charpente dans son ensemble.
Donc c’est vraiment intéressant. Ça nous permet de voir un petit peu qu’est-ce qu’on a derrière comme tissu forestier. Et puis les grands spécialistes de la question savent, en regardant ces éléments, comment est-ce que la forêt était exploitée et peut-être dans quelles conditions, et voir que, bah, on a plus ou moins un plan forestier qui est adapté pour faire pousser les arbres qu’on va récupérer pour construire la charpente de Notre-Dame de Paris.
Et, en fait, plus l’église est large, plus les poutres horizontales qui traversent l’église sont longues et donc plus ce sont des arbres qui sont grands, et donc plus il faut de temps pour les faire pousser, et donc plus la charpente a une importance de premier ordre dans la chronologie générale de l’édifice.
On se rend compte quand on analyse le sujet que, à partir d’une certaine hauteur, les voûtes sont construites non pas par des coffrages qu’on va mettre dessous et puis on va poser la voûte par-dessus et ensuite on enlève le coffrage, mais plutôt des coffrages qui sont suspendus. Et pour que le coffrage puisse être suspendu, [il] faut qu’il y ait au-dessus des éléments où on peut suspendre le coffrage. Et donc, il nous faut une charpente.
Donc, voilà, le sujet boucle ! En fait, la charpente, elle est tout à fait déterminante dans la façon dont le chantier va se dérouler. Et ça veut dire aussi que, si l’église est petite, les voûtes sont basses, donc la question s’aborde différemment. Et dans les régions où on n’a pas de bois par exemple, comme en Espagne par exemple, la cathédrale de Barcelone n’a pas de charpente, donc les techniques constructives vont être différentes.
Donc, il y a quelque chose de la, de la charpente qui nous parle un petit peu des spécificités régionales et des contraintes derrière qu’il y a et nous font comprendre que, finalement, un chantier de cathédrale, c’est pas 25 bonhommes qui sont sur un chantier avec un architecte de génie qui leur donne des ordres que les types ne peuvent pas comprendre, non. Un chantier de cathédrale, c’est évidemment un site de travaux, c’est des carrières [dont] on sort les pierres, c’est des forêt où on exploite des arbres, où on fait pousser des arbres, c’est des ateliers de maîtres verriers où on va produire des pièces de verre, on pourrait évoquer la même question dans tout un tas de domaines, de la tuile jusqu’aux pièces de métal, en passant par tout ce qu’on veut.
[Intermède musical]
Voilà un petit peu ce que c’est qu’une charpente médiévale. Maintenant, la question de refaire une charpente, bah évidemment, c’était un objet patrimonial, [il] faut en refaire un objet patrimonial. On peut pas se permettre de mettre sur le toit de Notre-Dame de Paris une vulgaire charpente en, en métal, comme on trouverait dans un hangar. Maintenant, on peut aussi supposer qu’on arrive à faire de très, très belles charpentes en métal. On peut dire aussi que, finalement, le bois est le seul matériau dont on ait un retour d’expérience, de comportement sur tant d’années. Les charpentes métalliques les plus anciennes qu’on ait, elles datent du tout début du XIXe siècle et, dans les conditions qui sont les conditions de Notre-Dame de Paris en fait, on peut citer la charpente de la cathédrale de Chartres qui, je crois, date des années 1850 ou 1860. Voilà, là, on va avoir le plus ancien cas connu. Alors, elle va bien, mais bon, comment elle ira dans cent ans, dans cent, dans deux cents ans, dans trois cents ans, les questions peuvent être ouvertes et les mêmes questions se posent sur le béton en fait, où là on a un retour d’expérience qui est encore plus court. Et puis des belles charpentes en béton, on a un bel exemple : la cathédrale de Reims a sa charpente qui est en béton, il faut absolument que les auditeurs qui ne l’ont pas vue, il faut absolument y aller. Pas se dire il faut y aller avant qu’elle brûle parce qu’elle brûlera pas, [rire] mais, mais il faut aller la voir. Et, donc ça, c’est un autre aspect, c’est est-ce que le matériau peut brûler ou pas brûler ? Et est-ce qu’on est exposé aux mêmes risques ? Donc, la question s’entend aussi sur le matériau.
Il y a aussi l’occasion de se dire, ben, pour la première fois, on peut peut-être essayer de faire de l’archéologie expérimentale à large échelle, se dire on prend cette charpente de Notre-Dame de Paris et on en fait un projet pour essayer de la refaire de la même manière. Et on va se rendre compte évidemment, bah, qu’on n’y arrive pas. Et donc, il va falloir qu’on cherche des solutions et le fait de se mettre les pieds dans la boue à côté des bâtisseurs médiévaux, à côté des charpentiers du XIIIe siècle, bah, c’est l’occasion de, de se poser des questions qu’on se posait pas avant et de mieux comprendre quelque chose sur leur travail.
Donc, en fait, finalement, cette question de remplacement de charpente est une question qui est extrêmement complexe et il faut que, bah, on arrive à avoir vraiment une dynamique de discussion avec tous les spécialistes, toutes les personnes qui ont un éclairage à donner et, aussi bien des spécialistes de la charpente médiévale, ce que je ne suis pas, que des spécialistes de charpentes plus récentes du XIXe siècle, du XXe siècle. Quels sont les exemples qui ont été mis en œuvre à droite ou à gauche ? Et puis une fois qu’on a tous les éléments, on pourra décider. Je pense que la première étape, la chose la plus importante, c’est vraiment d’avoir tous les éléments posés sur la table à fond, en fait.
[Intermède musical]
Faut-il reconstruire la flèche ? Je pense qu’on peut poser la question à l’envers : faut-il ne pas reconstruire la flèche ? Bah, pourquoi est-ce qu’on la reconstruirait pas en fait, il y en a toujours eu une. Il y en a toujours eu l’idée d’une, je pense, dès les tout premiers temps du chantier, donc je vois pas pourquoi est-ce qu’on en reconstruirait pas une. Ou alors pour redonner à la cathédrale un état qui se trouve entre la Révolution française et le chantier de restauration, c’est-à-dire les 40 premières années, grosso modo, du XIXe siècle où la cathédrale était dans un état déplorable. On va pas restaurer un état déplorable à Notre-Dame de Paris, je trouve que ça n’a pas beaucoup de sens.
Ensuite, les documents qui ont pu être rédigés, comme la Charte de Venise, qui sont issus de l’expérience humaine relative à la restauration des Monuments historiques, di[sen]t qu’il faut restituer l’édifice dans son dernier état connu. Son dernier état connu, c’est une cathédrale avec une flèche. Au moins ça, là-dessus… Après, on peut débattre de plein de choses, de savoir ce qu’est cette flèche, est-ce qu’elle est pseudo-médiévale, est-ce que c’est une création tout à fait pleine et entière du XIXe siècle, etc., etc. Ca, c’est pas, c’est pas la question que, que je pose aujourd’hui. C’est-à-dire que, elle en avait une, il faut en refaire une. C’est un élément central de, du paysage urbain parisien. Donc ça, évidemment, ça compte. C’est un repère. Ce repère-là, il a du, il a du sens parce que ça marque la présence de Notre-Dame de Paris dans la ville. Si on prend un exemple beaucoup plus contemporain, qui est celui de la dernière cathédrale qui ait été consacrée en France, c’est la cathédrale de Créteil. On est en septembre 2015. Il y a un clocher à Créteil qu’on voit depuis extrêmement loin, qui est un clocher qui fait peut-être 70 mètres de haut, qui est en bois, qui ressemble en fait exactement à une flèche, sauf que c’est un clocher qui est à côté de la cathédrale. Mais voilà, ce, ce marqueur urbain, il a du sens, il a du sens, bien évidemment, pour le lieu, en tant que lieu spirituel et lieu de, lieu de foi et lieu liturgique. Mais il a du sens d’un point de vue urbain, de la présence d’une communauté parmi d’autres, et ça évoque la diversité de la population parisienne qui est une beauté avec laquelle il faut pas combiner, mais dont il faut réussir à sortir du fruit.
[Intermède musical]
Fanny Cohen Moreau : Est-ce qu’avec l’évolution des techniques et malgré tout ce que vous venez de dire, est-ce qu’on peut quand même imaginer, en fonction des choix qui seront faits, peut-être des choix politiques, plus politiques qu’architecturaux, est-ce qu’on peut imaginer peut-être une cathédrale qui a vraiment un aspect totalement différent de ce qu’on a pu voir avant l’incendie ? Comme, en fait, le fait que Paris aujourd’hui ne ressemble à rien au Paris du XIXe siècle ou au Paris du Moyen Âge. On peut penser à des monuments comme, par exemple, Pompidou, qui ont vraiment changé l’aspect de Paris, qui n’ont pas été appréciés au début, mais qui finalement font partie du paysage aujourd’hui.
Olivier de Châlus : Oui, on peut faire beaucoup de choses d’un point de vue technique, je pense que les limites sont pas forcément là, limites, elles sont peut-être ailleurs ou… Je crois que, évidemment, si l’homme se pose la question de savoir s’il peut tout faire, il va se mettre en tête de tout faire. C’est humain. La question, elle est peut-être de se dire quel était cet objet, s’il avait une valeur particulière, pourquoi en faire un autre. On peut dire que l’architecture contemporaine est une manière de créer du patrimoine, c’est sûr. On peut dire aussi que, finalement, l’architecture contemporaine, on peut l’appliquer partout, aussi. Finalement, je pense qu’on manque d’éclairage. Il faut laisser la parole aux spécialistes de ces questions, aux spécialistes du XIXe siècle, ce qui est pas du tout mon cas, évidemment. Moi, je suis médiéviste, j’aurais tendance à dire qu’un objet XIXe dans une église médiévale n’a pas forcément lieu d’être. Mais, est-ce qu’un autre a plus lieu d’être dans une cathédrale ? Et puis est-ce que cet objet, il est médiéval ou pas, dans le sens où, bah, aujourd’hui, on a notre vision du début du XXIe siècle sur le Moyen Âge, mais c’est qu’un modèle. On se fait une idée du Moyen Âge et après on réfléchit sur ce qu’était le Moyen Âge en fonction des repères qu’on s’est construit, qui sont des repères parfaitement artificiels et absolument pas conscients. C’était la même chose au XIXe siècle, ce sera la même chose au siècle suivant. Donc toutes ces questions sont des questions, je pense, qu’il faut surtout aborder de façon non passionnelle. Je crois que c’est vraiment le sujet, prendre le temps de réfléchir, poser les éléments, discuter, choisir peut-être quelque chose ensemble. Je ne sais pas si c’est faisable ou pas, ça risque d’être compliqué, mais voilà.
[Générique de fin]
Fanny Cohen Moreau : Dans le prochain épisode de cette série spéciale consacrée à Notre-Dame de Paris, nous parlerons d’un élément très important de la cathédrale que nous avons déjà commencé à aborder dans l’épisode que vous venez d’écouter, la flèche du XIXᵉ siècle, avec une personne qui l’a étudiée en détail.
Merci à Clément Nouguier pour le générique de cette série. Merci à Din pour la magnifique illustration. Merci à Jonathan, le mec d’Ozef pour le montage et merci aux personnes qui soutiennent Passion Médiévistes sur Tipeee et qui ont permis le financement de cette série spéciale.
Nina Derain : La flèche de Notre-Dame, pendant très longtemps, elle a été probablement le plus haut point en fait de Paris.
Merci à Luc pour la transcription et à Maud pour la relecture !
Épisode 7 : Les flèches de la cathédrale

Dans cet épisode nous allons parler d’un élément important de la cathédrale, la fameuse flèche. Nous en avons déjà parlé dans les précédents épisodes, mais nous nous intéressons plus particulièrement aux deux flèches, celle du Moyen Âge et celle construite au XIXème siècle, qui a été détruite lors de l’incendie d’avril 2019.
Nina Derain, étudiante en Histoire de l’Art à la Sorbonne, vous raconte l’histoire de ces flèches, sur lesquelles elle a réalisé un mémoire lors d’un master Patrimoine et Musée. Les flèches de Notre-Dame (médiévale comme XIXe) font parties d’une catégorie un peu particulière, car elles ne sont pas situées sur la façade mais sur le transept et surtout elles ne sont pas en pierre.
Nina Derain : Elle est peuplée de gargouilles, de chimères.
[Générique de début]
Au cœur de Notre-Dame. Une série de podcasts par Passion Médiévistes.
Fanny Cohen Moreau : Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce septième épisode de la série spéciale sur la cathédrale Notre-Dame de Paris du podcast Passion Médiévistes. Je m’appelle Fanny Cohen Moreau et, dans cet épisode, nous allons parler d’un élément important de la cathédrale : la fameuse flèche. Nous en avons déjà parlé dans les épisodes précédents, mais je vous propose aujourd’hui un épisode sur les deux flèches, celle du Moyen Âge et celle du XIXe siècle qui a été détruite lors de l’incendie en avril 2019. Et pour parler de tout ça, j’ai le plaisir de vous faire rencontrer quelqu’un qui connaît bien toutes ces histoires.
Nina Derain : Je m’appelle Nina Derain, je suis étudiante en master Histoire de l’art, Patrimoine et musées à la Sorbonne. J’ai réalisé un mémoire sur les flèches de Notre-Dame de Paris et j’étais également guide pour l’association CASA, donc guide à la cathédrale Notre-Dame.
Fanny Cohen Moreau : Pour commencer, comment définir une flèche ? Quel est son rôle dans l’architecture d’un édifice religieux ?
Nina Derain : Une flèche, c’est la partie pointue, en forme d’aiguille, de pyramide, comme vous voulez, qui couronne parfois les, les hauteurs des édifices. Donc, on les trouve parfois sur les tours, parfois directement sur le toit. En général, elles sont en pierre, mais la flèche de Notre-Dame faisait partie d’une catégorie un peu particulière puisqu’elle n’était pas en pierre, elle était en charpente de bois recouverte d’une couverture de plomb. Ces flèches n’ont pas de, d’utilité structurelle, les édifices s’en passent très bien, d’ailleurs, il y en a énormément qui ont disparu depuis, depuis le Moyen Âge. Mais, bah déjà, elles servent de clochers, la plupart d’entre elles comportent des cloches à l’intérieur. C’était le cas de celle de Notre-Dame. Et surtout, elles ont une fonction symbolique en fait, d’abord religieuse, puisqu’elles représentent un peu un, un doigt tendu vers le ciel en fait, comme un piédestal qui, qui brandit haut dans le ciel la croix, puisque sur la plupart de ces flèches, même toutes en fait, il y a le fameux coq, mais il y a aussi une croix bien sûr. C’est aussi une façon pour l’homme de se rapprocher en quelque sorte des cieux, donc de, de Dieu.
Elles ont aussi un rôle symbolique d’un point de vue plus civil on va dire, puisque la flèche, c’est vraiment un marqueur visuel dans, dans l’espace urbain, dans la ville. Un voyageur, la première chose qu’il voit en arrivant aux abords d’une ville, ce sont ces, ces flèches qui dominent en fait tous les toits de la ville. C’est comme ça qu’on identifie une ville. D’ailleurs, dans les enluminures, dans les vieilles gravures, on représente une ville en représentant ses clochers, en représentant ses flèches. Et également, plus votre ville possèdera de flèches et plus elles seront hautes, plus ce sera synonyme de bonne santé économique, de puissance. Donc, il y avait une vraie concurrence à l’époque entre les villes à qui aura la plus haute flèche en fait. C’est un peu la même chose aujourd’hui avec les gratte-ciel. La flèche de Notre-Dame, pendant très longtemps, elle a été probablement le, le plus haut point en fait de Paris.
[Intermède musical]
Notre-Dame, depuis le début en fait, possédait une flèche, alors cette flèche était située sur la croisée du transept, c’est-à-dire sur l’intersection entre la nef et le transept, donc vraiment au milieu de l’édifice. Et cette flèche, en fait, elle était contemporaine de la charpente, donc la charpente du XIIIe siècle qui a brûlé là au, au, au mois, au mois d’avril 2019. Donc elle était en bois également, en fait, elle faisait partie intégrante de cette charpente. Alors, on sait pas exactement avec précision quand elle a été construite à la décennie près, parce que de toute façon, c’est toujours un peu compliqué de savoir ces choses-là. Donc, elle s’est dressée en fait sur le, le transept de la cathédrale pendant plusieurs siècles, jusqu’à la Révolution française. En fait, à la Révolution française, on considère que c’était la plus ancienne flèche de ce type qui était encore debout. C’est des, des ouvrages très fragiles et donc, très souvent, ça disparaissait à cause des intempéries, à cause du feu. Et celle de Notre-Dame avait survécu jusqu’à la Révolution française.
Alors cette flèche, on sait qu’elle existait parce que, tout simplement, on en a des représentations dans des enluminures, par exemple les, les Très Riches Heures du duc de Berry, dans des gravures. Mais, ces représentations sont pas assez précises en fait, pour qu’on sache dans le détail à quoi elle ressemblait. On sait qu’elle était très élancée, qu’elle était pointue, mais on connaît pas le détail de son ornementation. Ça explique en partie pourquoi la, la flèche de Viollet-le-Duc possédait une grande part de création. Mais, ces, en tout cas, ces, ces représentations suffisent à prouver qu’il existait bien une flèche. Ca, parfois, on a encore du mal à l’admettre.
L’histoire de, de son démontage ou de sa destruction est assez obscure. En fait, elle a été démontée pendant la Révolution française, donc dans les années 1790. La date précise reste à, à établir. Évidemment, c’est, c’est très symbolique de priver un édifice religieux de sa flèche, surtout à une époque qui était très hostile au clergé. Mais, si elle a été démontée, c’est surtout parce qu’on voulait en récupérer le plomb qui la recouvrait, donc sa couverture en plomb, qui servit à fabriquer de l’armement en fait, dont on avait beaucoup besoin à l’époque. La flèche de la Sainte-Chapelle, qui est juste en face, a, a subi le même sort en fait. On démontait ces flèches pour récupérer le plomb. En plus, il se trouve que, à cette époque, la flèche de Notre-Dame était de toute façon en très mauvais état. Elle avait plus de, plus de 500 ans, elle penchait, le bois était pourri, il manquait des pièces… Donc, ça a été beaucoup plus simple de toute façon de, de la démonter que de la, que de la réparer, il n’en était pas question.
Donc, on a amputé la cathédrale de sa flèche. Mais, de la même façon, quand vous coupez un arbre, il reste les racines sous terre. Et ben là, c’est pareil en fait. On a coupé le corps de la flèche, mais les racines étaient encore en place sous la toiture de la cathédrale et ces racines sont restées en place jusqu’à la campagne de restauration de Lassus et Viollet-le-Duc. Et donc ces racines sont aussi une preuve que cette flèche a bien existé. [Rires]
Un arbre, donc vous avez bien sûr le tronc qu’on voit, qui sort de terre, mais il est fixé dans le sol par un, un réseau de racines qui est invisible. Et une flèche, c’est la même chose. Ce qu’on voit nous, c’est, c’est le corps de la flèche, donc qui est décoré, etc. Mais pour que cette flèche tienne, il faut qu’elle soit enracinée solidement, directement dans les combles de la cathédrale. Ces racines, on appelle ça une souche. Donc là encore, on retrouve un peu le vocabulaire de l’arbre, ça s’appelle une souche, ça permet en fait à la flèche de rester stable, de ne pas plier face au vent, de ne pas se tordre. Alors, à Notre-Dame, vu que cette souche se trouvait sur la croisée du transept, donc au croisement entre la nef et le, le transept, et bien, elle adoptait la forme de quatre pieds, un petit peu comme la tour Eiffel en fait, comme le, le bas de la tour Eiffel, vous aviez quatre pieds qui allaient se poser sur les piliers de la croisée du transept et qui ensuite se rejoignaient au centre et, et de là montait la flèche.
Après la Révolution française, dans les années 1830 en fait, on commence à, à se ré-intéresser au, au Moyen Âge et donc aux monuments qui y sont associés, notamment les cathédrales, les édifices gothiques. Et on commence à, à se rendre compte que, bah vraiment, ils sont en très mauvais état, parce que, ça, ça a souffert pendant la Révolution, puis même, c’était, c’était très ancien, c’était abîmé, etc. Donc on décide de lancer un concours pour choisir quel architecte va restaurer la cathédrale de Paris. Donc, c’était quand même un, une grosse affaire parce que c’est, c’est un édifice évidemment monumental et il fallait pas faire n’importe quoi. Les deux architectes qui vont remporter ce concours, donc en 1844, c’est Eugène Viollet-le-Duc et son associé Jean-Baptiste Lassus. Eugène Viollet-le-Duc, il est encore assez jeune à l’époque, il a une trentaine d’années, il est en train de restaurer la, la basilique de Vézelay en Bourgogne, et Jean-Baptiste Lassus, lui, il est connu pour avoir restauré plusieurs édifices parisiens et notamment la Sainte-Chapelle, à laquelle il a également redonné une flèche. Donc, il s’y connaissait déjà un peu en flèche.
Ils ont remporté ce concours parce que c’est leur projet qui a été jugé le plus fidèle à ce à quoi la cathédrale ressemblait autrefois, et ce grâce à une très importante recherche documentaire. En fait, ils ont basé leur projet sur la recherche de, de sources graphiques, de sources descriptives pour avoir une vision la plus précise possible de ce à quoi ressemblait la cathédrale autrefois. Et c’est notamment grâce à cette documentation qu’ils savaient qu’il y avait une flèche sur le, la croisée du transept de, de Notre-Dame.
Le projet qu’ils présentent en 1844 a beaucoup évolué après, avec le temps, en fonction des, des circonstances, etc. Mais, dès 1844, ils avaient pour projet de reconstruire une flèche, ça faisait vraiment partie du projet d’origine. Alors pourquoi reconstruire une flèche ? Surtout parce que cette flèche, elle faisait vraiment partie de la silhouette de la cathédrale, en fait. Cette forme très fine, très élancée, ça, d’une part, ça contrebalançait un peu la, la lourdeur des, des deux tours de façade qui sont quand même très massives, très carrées, et ça permettait aussi d’animer l’horizontalité de cette longue nef. Ça permettait un peu de conduire, on va dire, l’œil de, vers, vers le ciel, ça affinait les formes de la cathédrale. D’ailleurs, on s’en rend compte aujourd’hui, maintenant qu’il y en a plus, que ça, ça change quand même un peu les formes générales.
Reconstruire une flèche, c’est également l’occasion de mettre en pratique des, des techniques de construction très élaborées qui sont maîtrisées par des artisans d’excellence. Par exemple, pour construire une charpente de flèche, c’est beaucoup plus complexe que construire la charpente d’une maison. Évidemment, c’est un ouvrage qui est très haut, qui est très pointu, la base est complètement différente. Donc ça, c’est, c’est une prouesse technique en soi. Également, le, la couverture en plomb a nécessité de redécouvrir des, des techniques de façonnage du plomb qu’on n’avait pas pratiquées depuis, depuis des siècles. Et donc, le fait de reconstruire une flèche, ça permet de mettre en pratique ces, ces techniques détenues par des ouvriers de, d’excellence en fait.
[Intermède musical]
Alors, restaurer une cathédrale, bien sûr, c’est une entreprise colossale. Alors, ça consiste déjà, bien sûr, à réparer toutes les parties, toute la structure qui commence un peu à s’affaisser, à s’effondrer. Donc, c’est vraiment là purement utilitaire, on va dire. Et ça consiste aussi à lui redonner toute son ornementation, ses décorations, les sculptures qui ont disparu, etc. Donc, bah, ça, tout ça, c’est prévu dans le projet de restauration de Lassus et Viollet-le-Duc.
Le chantier s’étale sur une vingtaine d’années. On va faire plusieurs choses en même temps. On va pas d’abord s’occuper des sculptures, puis après s’occuper des vitraux, on va faire un peu tout ça en même temps. La restauration en elle-même commence en 1844, 1845 et on va vraiment s’attaquer à la flèche à partir de 1848, donc pas tout de suite. En fait, on profite que le chœur de la cathédrale soit en travaux, donc avec des échafaudages partout, pour commencer à s’y atteler. Alors la première étape, c’est de dégager la souche de l’ancienne flèche médiévale, donc les, les racines en fait de cette flèche qui étaient toujours en place dans les combles. Et pour ça, le plus simple en fait, c’est de démonter la voûte de la croisée du transept. Alors, cette voûte datait du XVIIIe siècle, donc de toute façon, elle avait pas, enfin, elle était pas très ancienne. La voûte qui s’est effondrée là pendant l’incendie en avril 2019, sous le poids en fait de la flèche, bah c’est une voûte qui date du XIXe siècle, qui a été reconstruite donc quand on a eu tout terminé, il fallait tout reboucher. Donc cette voûte, voyez qu’elle a été reconstruite quand même plusieurs fois.
Donc une fois que la voûte est démontée, donc on a un trou en fait dans le toit, il faut commencer à démonter l’ancienne souche qui laissera place à la nouvelle. Alors cette ancienne souche, on la démonte parce qu’elle était plus, elle était plus en mesure en fait de soutenir une nouvelle flèche. Elle était également très abîmée. Elle avait quelques malfaçons, il manquait des pièces, enfin bon, de toute façon, elle était plus utilisable donc c’était plus simple de la démonter pour en remettre une toute neuve.
Et ensuite, on commence à monter un échafaudage. Alors l’échafaudage, il est très intéressant parce qu’il va s’élever au-dessus de la cathédrale, à plus de 100 mètres de haut. Donc, pour l’époque, c’est un ouvrage colossal qui est en bois bien sûr. En fait, il a la particularité de ne s’appuyer que sur les maçonneries de la cathédrale. C’est-à-dire qu’en aucun cas, il ne s’appuie sur la charpente ou sur la toiture, qui sont pas du tout faites pour supporter un tel poids. Il va vraiment reposer à l’aplomb des murs, donc en équilibre en fait, sur les quatre, sur quatre points, c’est-à-dire sur les quatre piliers de la croisée du transept. Une fois que cet échafaudage est monté, avec différentes plateformes bien sûr, pour que ce soit accessible aux ouvriers évidemment, et ben on va pouvoir commencer à monter la flèche.
Alors cet échafaudage, on en a des photographies, il a été beaucoup photographié, ce qui montre, je pense, que bah, il attirait l’attention justement, on se disait que c’était un bel ouvrage à photographier. Et, ce qui est intéressant à observer sur les photographies, c’est qu’il y a très peu de dispositifs de sécurité en fait, on va dire, pour les ouvriers, non pas qu’ils étaient maltraités, c’était comme ça qu’on travaillait à l’époque. Mais il y a pas de, il y a pas de rambarde, il y a pas, alors, bien sûr, il y a pas de, il y a pas d’ascenseur ni de, de monte-charge mécanique, ça, ça existait pas à l’époque. Et on distingue des, des petites échelles toutes fines qui montent à plus de 100 mètres de haut, là pour les ouvriers. Donc bon, ils étaient, ils avaient, il fallait avoir le cœur bien accroché. Ça donne quelques informations sur la, sur les conditions de travail des ouvriers à l’époque.
Donc, une fois que cet échafaudage est monté, on peut commencer à installer les nouvelles pièces de la charpente de la flèche. Alors ces pièces en fait, on va les faire monter par le trou qu’on a préalablement pratiqué dans la croisée du transept. En fait, on passe pas par l’extérieur, parce que c’est plus simple en fait de passer par l’intérieur, voilà. Donc, on installe ces pièces les unes après les autres, et, en tout, le montage de la charpente prend trois mois. Donc, c’est assez rapide. Donc ça, entre le début de l’année 1859 et le printemps on va dire. Et ensuite, une fois que l’on a terminé la charpente, bah, bon, il faut marquer le coup quand même, donc on fait une petite cérémonie avec les acteurs du chantier, avec le clergé, voilà. En fait, d’abord, on installe un, provisoirement, un drapeau tricolore au sommet de la flèche, donc c’est un beau symbole, ça montre que, bah, une espèce de concorde, on va dire, entre le, l’Église, bien sûr, et l’État qui gère un peu ces chantiers. Ensuite, on va installer la croix en fer forgé, donc, qui fait huit mètres de, de haut. On s’en rend pas compte quand on est en bas, bien sûr, mais elle est, elle est très grande avec au-dessus le coq, coq en cuivre qui contient des reliques, donc le coq qu’on a retrouvé dans les, dans les débris de l’incendie. Alors ça, c’est une opération très spectaculaire, on le sait grâce aux, aux journaux de l’époque en fait. Dans les journaux, on nous explique que le montage de, de cette, de cette croix va attirer les curieux qui vont se masser sur les quais de Seine pour voir ces ouvriers à près de 100 mètres de haut monter cette croix qui est très, très lourde. C’est un peu un spectacle aussi quand même pour la ville autour.
Une fois que cette croix est montée, bah là, on va pouvoir commencer à recouvrir la charpente de plomb. Donc, il faut faire assez vite quand même, parce que, bah, le bois, bien sûr, ça pourrit. Donc, si la flèche est pourrie alors qu’elle est pas terminée, c’est un peu embêtant. Donc là, viennent les, les plombiers, les ouvriers plombiers, les couvreurs aussi qui vont envelopper toutes les pièces de bois de cette charpente dans des feuilles de plomb de quelques millimètres d’épaisseur. Alors le plomb, c’est très souple, donc on peut le, le manipuler avec des maillets, froid, donc ça, c’est très pratique. Cette opération de couvrement va durer, elle, dix-huit mois. Donc, c’est beaucoup plus long, justement parce qu’il faut être très minutieux, il faut vraiment recouvrir tous les recoins, toutes les petites moulures, les petites décorations, voilà, donc c’est, ça prend du temps. Viollet-le-Duc, il appelle ça de l’orfèvrerie monumentale. C’est exactement pareil que quand vous recouvrez une petite sculpture avec des feuilles d’or. Bah là, voilà, c’est pareil, sauf que c’est du plomb et c’est beaucoup plus grand. On commence la, la couverture en plomb par le haut, tout simplement parce que, bah après, on va, on va descendre et en descendant, on démonte l’échafaudage au fur et à mesure, jusqu’à arriver au niveau, au niveau du toit.
Ensuite, et bah la dernière étape, c’est d’installer les statues en cuivre des apôtres. Donc les statues en cuivre qui sont à la base de cette flèche, qui ont été démontées quelques jours avant l’incendie. Ces statues d’apôtres, elles sont préalablement fabriquées bien sûr en atelier, avec du cuivre, à partir des matrices du sculpteur, et elles sont livrées au fur et à mesure sur le chantier et montées une à une. Alors cette opération, bon, ça a pris son temps aussi, et les derniers apôtres sont installés en 1861.
[Intermède musical]
Une fois que les derniers apôtres sont montés, on est en 1861, la restauration de la cathédrale est pas encore terminée, elle se termine officiellement en 1864. Mais, ça marque quand même symboliquement un, un point d’orgue, on va dire à ce chantier.
Cette flèche, elle est très représentative de ce qu’on appelle le style néogothique. En fait, au XIXe siècle, vu qu’on se ré-intéresse beaucoup au Moyen Âge et donc au style gothique, on s’imprègne en fait du style gothique pour essayer de, de faire renaître, de faire revivre ses formes. Donc c’est un peu réducteur de parler de pastiche ou de copie, parce qu’on fait pas que copier bêtement ce qu’on a sous les yeux, on essaye de le réinterpréter, de l’embellir aussi un peu parfois. Et cette flèche le montre bien, parce qu’elle présente vraiment des formes qui sont typiques du style gothique, mais toutes ces formes vont être assemblées entre elles.
Et puis, vu qu’on savait pas précisément à quoi ressemblait la flèche médiévale, de toute façon, les décorations de la nouvelle flèche, il a bien fallu les créer, donc on va les créer à partir du, du répertoire des formes gothiques qu’on connaît, qui sont emblématiques en fait. Les deux étages de cette flèche, qui sont ajourés par des, des espèces de, de grandes baies, et bah, ces baies en fait, elles adoptent les formes qu’on va trouver dans les, les baies des fenêtres de la cathédrale par exemple. Sauf que là, en fait, toutes ces formes vont être transposées de la pierre au plomb. On avait par exemple ce qu’on appelle des lancettes, donc c’est ces espèces de, de grandes fenêtres, très étroites et très hautes, qui se terminaient par des, des petits arcs brisés, par des, des trèfles, des, des polylobes. On trouve également quelque chose, alors ça, ça, au XIXe siècle, ils adoraient ça, c’étaient les crochets, c’est-à-dire les petites tiges en fait qui décoraient les parties élancées des édifices. Il y en a beaucoup à, à Notre-Dame, il y en a par exemple sur les arêtes des tours. Ça anime en fait, on va dire, les formes qui sont soit très verticales, soit très horizontales. Ça crée des, des jeux d’ombre et de lumière et il y en avait sur l’aiguille de, de la flèche. Tout ça, ça montre vraiment comment on va assimiler le vocabulaire ornemental gothique pour en faire quelque chose de neuf, mais en même temps qui s’inspire, qui s’inspire de l’ancien.
Alors cette flèche, elle est aussi néogothique du point de vue des techniques en fait. Parce que l’architecture gothique, c’est pas qu’un style en fait, c’est aussi tout un principe technique. Et bah, cela tout simplement parce qu’en fait, il a été décidé de la reconstruire dans les matériaux traditionnels du Moyen Âge. On aurait pu refaire une flèche dans un matériau complètement différent, par exemple, à Rouen, à la même époque, on est en train de construire une flèche en fonte. Bon, la fonte, c’est pas du tout un, un matériau du Moyen Âge. Et donc là, le fait de faire l’effort de retrouver, d’acquérir la, la maîtrise des techniques anciennes, donc c’est-à-dire la charpenterie, la plomberie d’art, ça montre vraiment cette volonté de s’inscrire aussi dans les, dans les techniques médiévales. Ce sont aussi ces matériaux-là qui permettent de créer toutes ces ornementations, parce que, bon, le bois, ça se sculpte très finement, le plomb, ça se modèle très finement, donc ça permet justement de, bah, de reproduire toutes ces petites fioritures qui sont typiques du gothique.
Cette flèche, elle est vraiment représentative du style néogothique parce qu’elle est peuplée de, de gargouilles, de chimères, donc tous ces monstres grimaçants, qu’on voyait pas forcément quand on observait la flèche d’en bas, mais en fait, il y en avait vraiment beaucoup. Il y avait des, des espèces de dragons, d’éléphants… Bon, c’est, on sait jamais trop quel animal ça représente. Et, ça, c’est vraiment devenu dans l’imaginaire collectif l’archétype du, du style gothique. On voit une gargouille, on se dit « ah bah ça, c’est gothique », alors qu’en fait, c’est vraiment au XIXe siècle, on adorait ces monstres en fait, donc là, on en a mis partout, on a vraiment, on les a recréés complètement. Donc ça, ça, c’est vraiment assimilé au style néogothique. Et sur la flèche, c’est vrai qu’il y en avait beaucoup, qui étaient en plomb également. D’ailleurs le sculpteur qui les a réalisés, on pense que c’est le même que celui qui a sculpté les monstres de la galerie des chimères. Donc ces monstres très connus qui sont en fait à la base des tours, par exemple la, la stryge, donc, c’est cette, cette chimère très connue qui se penche au-dessus de Paris, qui observe en fait la ville, qui est devenue un peu aussi le symbole de Notre-Dame. Bon, il y a qu’à voir dans, dans Le Bossu de Notre-Dame, ces chimères, on leur a carrément donné vie. Donc ça, ça sortait en fait de l’imagination des artistes du XIXe siècle, mais qui s’inspiraient en fait, qui étaient inspirés par, par le Moyen Âge.
[Intermède musical]
L’incendie, au moment où il s’est déclaré, au moment où la nouvelle a commencé à se répandre, donc, j’étais en train de rédiger mon mémoire. Là, c’était vraiment, le mois d’avril, c’est vraiment un temps très fort dans la rédaction des mémoires, donc, donc, j’étais en plein dedans. J’étais en train de traiter de la partie d’ailleurs qui parlait de la destruction de la flèche, de la flèche médiévale. [Rires] C’est assez ironique. Alors bon, bah, j’ai tout suivi à la télé, comme beaucoup de monde bien sûr. Donc, évidemment, beaucoup d’émotions. On a souvent comparé ça à la mort d’une personne en fait, c’est vrai que la cathédrale, pour beaucoup, c’était devenue une, une amie comme dit Olivier par exemple, donc ça fait quelque chose. Puis, bah, dans les jours suivants aussi, bien sûr, on s’adresse à vous comme si vous aviez perdu un proche, voilà, donc, ça en dit long je trouve sur, sur l’émotion et l’attachement qu’on pouvait y avoir. Alors, en plus, bon, moi, je, je côtoyais cette flèche depuis, depuis plusieurs mois, je la connaissais par cœur. C’est vrai que, elle est, du jour au lendemain, elle est plus là, donc ça fait, ça fait aussi quelque chose.
Alors, ensuite, d’un point de vue de la recherche, ça a pas tellement perturbé mon, mon programme, parce que, après, je travaillais essentiellement sur des documents écrits, etc. Ça a peut-être donné par contre une dimension un peu différente quand même à ce que j’écrivais, parce que, bah là, on parlait d’un objet qui existait plus. Après, bon, même si, bien sûr, on se serait très aisément passé de ce drame, il faut aussi voir toutes les leçons, tout ce qu’on va pouvoir en tirer. C’est-à-dire que depuis le, l’incendie, il y a des, il y a des personnes formidables qui travaillent sur la cathédrale, qui en profitent aussi pour l’étudier. Je pense par exemple à tout ce qui va être dendrochronologie, à tout ce qui va être analyse du bois, tout ce qui va être analyse des pierres, etc.
La disparition de cette flèche aussi, je pense que c’est l’occasion de remettre en valeur aussi le, le patrimoine néogothique en France qui est très présent en fait. Parce que, bah en fait, il est partout, enfin, toutes les églises ont été restaurées au XIXe siècle, il y a beaucoup de choses qui ont été construites au XIXe siècle dans le style néogothique. Et pourtant, c’est encore assez mal connu, voire mal compris du grand public. Parfois, on fait pas la différence entre les deux, ou parfois on se dit « oh bah ça, ça date du XIXe siècle, donc c’est pas très, c’est pas très intéressant » ou « ça a pas beaucoup de valeur parce que c’est plus récent ». Alors qu’en fait pas du tout, c’est un courant artistique qui est extrêmement important. Et donc le fait que cette flèche ait disparu, le fait qu’elle soit plus là, ça permet de, bah, d’attirer l’attention sur ce patrimoine néogothique. Parce que vu que les gens s’y intéressent pas vraiment, bah forcément, il va être peut-être moins bien entretenu, on va dire. Et il y a beaucoup d’églises, par exemple dans, dans les villages, en France, qui datent du XIXe siècle et qui sont pas vraiment entretenues. Bah déjà, parce qu’évidemment, il y a toujours une question, une question de moyens et qui disparaissent en fait un peu dans l’indifférence. Et c’est vraiment dommage.
Cette flèche, c’est un peu le, le, le symbole de ce patrimoine on va dire. Notamment des flèches comme celle de Notre-Dame, donc qui sont en, en charpente et en plomb, qui datent du XIXe siècle. Il y en a d’autres en France, déjà, il y a celle de la Sainte-Chapelle qui est juste en face, elle est à quelques mètres en fait de Notre-Dame quoi. Donc, certes, il faut pleurer la disparition de la flèche de Notre-Dame, mais il y en a une autre juste en face qui est également magnifique, qui a été construite par Jean-Baptiste Lassus, donc, donc vraiment elles sont très proches. Il y a aussi par exemple la, la cathédrale d’Orléans, il y a une flèche qui ressemble beaucoup à celle de Notre-Dame, qui date également du XIXe siècle. Il y a celle de, du Mont Saint-Michel, la flèche qui, qui vraiment domine toute la baie, elle date également du XIXe siècle. Et donc ça, ce sont des ouvrages qu’il faut pas hésiter à admirer, parce que ça, c’est vraiment le, représentatif de tout ce qu’on sait faire, tout ce qu’on a su faire au XIXe siècle.
Alors, j’ai, j’ai été guide à Notre-Dame de Paris pendant un mois, au mois d’août 2018. Ce que j’aimais beaucoup montrer pendant mes visites, aussi bien à l’extérieur, donc sur le, le, la façade, qu’à l’intérieur, c’était le dialogue entre toutes les époques en fait. Parce que, bon, évidemment, la cathédrale, c’est un édifice médiéval, en grande majorité, du XIIIe siècle, mais il y a énormément de choses qui ont été ajoutées, modifiées au fil des siècles. Et ça, ça montre que c’est un édifice qu’a jamais cessé de vivre en fait. C’est pas un musée, c’est pas figé dans le temps. Déjà, il y a tout, tout ce qui est XIXe siècle évidemment, mais, mais entre le Moyen Âge et le XIXe siècle, il s’est passé beaucoup de choses, par exemple l’aménagement du chœur avec le vœu de Louis XIII. En fait, dans le chœur de la cathédrale, vous avez une statue de la Vierge qui tient le, le Christ mort dans, dans ses bras, donc une pietà en fait, et de part et d’autre de cette Vierge, il y a une statue de Louis XIV et de Louis XIII en train de prier et c’est Louis XIV qui a fait aménager ce chœur.
Il y a également des choses qui sont très récentes. Par exemple, l’autel, qui a disparu dans l’incendie, il datait des années 70, alors bon, il y en a beaucoup qui le trouvait laid, mais, mais bon, c’est, c’est parfaitement subjectif. Moi, je trouvais qu’il avait parfaitement sa place là où il était. Il y a des vitraux également, les vitraux, il y a toutes les époques. Bon alors, les vitraux médiévaux, il y a les roses, bien sûr, qui ont été également très remaniées au cours du temps, il y a des vitraux du XIXe siècle, il y a des vitraux du, du XXe siècle.
Tout ça, ça montre vraiment que les, les hommes ont jamais cessé de prendre soin de cette cathédrale, d’y, d’y laisser leurs traces et la trace de leur époque en fait. Et donc ça, je trouvais ça très intéressant. Et puis bien sûr, bah, la flèche montrait ça aussi complètement, que, elle vient prendre la place d’une, au XIXe siècle, d’une flèche qui, elle, date du XIIIe siècle, voilà.
[Générique de fin]
Fanny Cohen Moreau : Dans le prochain épisode de cette série spéciale, l’avant-dernier épisode déjà, nous ferons un léger pas de côté. Vous entendrez une nouvelle personne dont vous avez déjà entendu le nom dans l’un des premiers épisodes.
Merci à Clément Nouguier pour le générique de cette série, merci à Din pour la magnifique illustration, merci à Jonathan, le Mec d’Ozef pour le montage et merci aux personnes qui soutiennent Passion Médiévistes sur Tipeee et qui ont permis le financement de cette série spéciale.
Philippe Bernardi : Pour moi, la construction, c’est un tout. C’est-à-dire qu’il y a pas, il y a pas une grande construction et une petite construction.
Merci à Luc pour la transcription et à Maud pour la relecture !
Épisode 8 : Diriger une thèse

Et si nous faisions un pas de côté ? Juste avant de finir cette série, je vous propose un épisode un peu différent des précédents. Vous n’allez pas forcément y apprendre des nouvelles choses sur la cathédrale Notre-Dame de Paris (vous en avez déjà beaucoup appris dans cette série) mais vous allez avoir un nouveau point de vue à écouter.
Philippe Bernardi est directeur de recherche au CNRS, archéologue et historien, spécialiste de la construction au Moyen Âge. Il est le directeur de thèse de Olivier de Châlus que vous avez pu entendre dans les précédents épisodes, et je suis allée l’interroger pour avoir le regard de quelqu’un qui encadre doctorant qui réalise un travail important sur Notre-Dame.
Il raconte comme Olivier de Châlus est venu le rencontrer avec une envie de recherches, comment le projet de thèse s’est mis au point, et comment il l’a accompagné au cours de ces dernières années. Au moment de l’enregistrement, la thèse était presque terminée, et Philippe Bernardi parle de ce que l’incendie a pu changer, ou non, dans les recherches de Oliver de Châlus sur la construction de Notre-Dame de Paris.
[Extrait épisode – Philippe Bernardi : ] Dans une thèse, comme dans tout travail historique… il y a une part d’incertitude.
[Début Générique : ] Au cœur de Notre-Dame, une série de podcasts par Passion Médiévistes.
Fanny Cohen Moreau : Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce huitième épisode de la série spéciale sur la cathédrale Notre-Dame de Paris du podcast Passion Médiévistes. Je m’appelle Fanny Cohen Moreau et pour l’avant-dernier épisode de cette série, nous n’allons pas forcément parler de Notre-Dame. C’est un peu l’autre face du premier épisode où Olivier de Châlus parlait de sa thèse et de son angle d’approche.
En effet, je vous propose dans cet épisode d’écouter Philippe Bernardi, le directeur de thèse d’Olivier de Châlus et chercheur au CNRS. Je suis allé l’interviewer chez lui dans le sud de la France, pour qu’il me parle de son expérience et de son rôle en tant que directeur d’une thèse sur la cathédrale Notre-Dame de Paris.
[Fin générique]
Philippe Bernardi : Je suis directeur de recherche au CNRS. Je suis médiéviste, spécialiste de l’histoire des techniques. Je travaille sur la fin du Moyen Âge, euh… dans le sud de la France, sur la Provence essentiellement.
Fanny Cohen Moreau : Vos recherches, en fait, ont concerné la construction et le domaine du bâtiment à la fin du Moyen Âge. Qu’est-ce qui vous a donné envie de travailler sur ce sujet ?
Philippe Bernardi : Écoutez, ça, c’est une question que je me suis jamais vraiment posée. Ça m’a paru être, je dirais, de fil en aiguille, j’sais pas… [rires] Ça ne fait pas très très sérieux. Mais c’est, c’est ça, j’sais pas de la découverte d’un sujet parce que surtout d’une source en fait. J’ai fait des études d’histoire de l’art et d’archéologie. Et puis je voulais pas travailler sur… sur les formes, ça m’intéressait pas, sur le style, sur les typologies, les choses comme ça qui sont quand même une des grandes activités de ce milieu. Et j’avais envie de travailler d’abord sur les hommes et puis sur les techniques, sur la manière. ‘Fin vraiment rentrer dans la mécanique des choses. En faisant ça, je me suis intéressé, enfin, j’ai découvert les sources écrites, les sources notariales et voilà.
Fanny Cohen Moreau : Vous avez parlé d’une source en particulier qui vous a attiré.
Philippe Bernardi : Pas une source en particulier, un ensemble de sources, un ensemble de sources, un ensemble de contrats qui vous permettent d’aborder des tas d’aspects et de manière très proche me semblait-il – j’en suis un petit peu revenu – très proche de la vie des gens et des gens eux-mêmes, c’est-à-dire le contrat par lequel une personne va demander à ce qu’on lui construise telle grange, telle maison, etc. Le contrat par lequel on va embaucher un apprenti, c’est tous ces aspects-là…
Fanny Cohen Moreau : …Des écritures ordinaires, en quelque sorte.
Philippe Bernardi : Tout à fait, tout à fait, ce sont des écritures ordinaires, la culture de la pratique aussi, puisque les comptabilités en font partie, enfin sont proches de ça. Et moi, j’ai adoré ça. J’ai adoré ça parce que c’était… voilà, j’avais l’impression d’être vraiment dans le sujet. J’ai commencé à travailler sur la construction et donc j’ai commencé à travailler sur les métiers de la construction et puis voilà, j’ai pas arrêté là-dessus, ce qui était l’aspect social et économique qui m’intéressait beaucoup lié aux techniques, pas dissocier ces aspects-là.
Fanny Cohen Moreau : Et la construction de quel type de bâtiments ?
Philippe Bernardi : Toutes les constructions. Pour moi, la construction c’est un tout. C’est-à-dire qu’il n’y a pas, il n’y a pas une grande construction et une petite construction. Il y a les constructeurs. Alors il y a des gens qui sont plus ou moins qualifiés, qui ont des spécialités plus ou moins, mais, mais sur les chantiers cathédraux on voit passer des, on voit passer des gens qu’on retrouve à construire une maison, les petites choses comme ça.
J’avoue que j’ai… progressivement, je me suis beaucoup intéressé à la construction ordinaire on va dire. Mais bon, j’ai beaucoup écrit sur la construction du Palais des Papes, qui est pas vraiment une construction ordinaire…
Fanny Cohen Moreau : Oui c’est le moins qu’on puisse dire…
Philippe Bernardi : … mais qui vient, qui fait et qui fait intervenir beaucoup de gens ordinaires.
[intermède sonore]
Fanny Cohen Moreau : Il se trouve que, donc, pour les auditeurs j’explique un petit peu : vous êtes le directeur de thèse de Olivier de Châlus qui, dans ce podcast, en fait, nous l’avons beaucoup entendu. C’est notre invité fil rouge. Je voulais que vous nous racontiez comment s’est passé la rencontre avec Olivier de Châlus, qui donc… a un parcours un petit peu différent des personnes qu’on voit habituellement en thèse.
Philippe Bernardi : Que vous voyez en thèse [rires] Peut-être parce que… Non, c’est vrai que c’est pas, c’est pas courant, mais je veux dire que Olivier a un parcours très particulier effectivement, mais la plupart de mes étudiants en thèse ont des parcours particuliers parce que c’est un peu le lot des directeurs de thèse CNRS, c’est que dans la mesure où on n’est pas forcément dans les canaux de l’université où on enseigne pas dans les premiers cycles, ben ils nous arrivent des étudiants qui viennent par des voies détournées. Ils sont tous singuliers, même, même… même dans d’autres cas, même pour les étudiants qui ont suivi un parcours classique. Mais je suis plus habitué, disons, à voir des étudiants qui n’ont pas de parcours de…
Fanny Cohen Moreau : Classique de licence, master…
Philippe Bernardi : Tout à fait. Ah, ils ont pour certains DEUG, licence, master. Mais, par exemple, je réfléchissais que… aucun de mes étudiants n’a fait son cursus dans l’université dans laquelle je suis, à laquelle je suis relié euh rattaché pardon.
Fanny Cohen Moreau : Parce que là vous êtes relié à l’Université Paris I Panthéon-Sorbonne.
Philippe Bernardi : Voilà… Quant à la rencontre avec Olivier de Châlus. En fait, c’est lui qui est venu me voir. Bien évidemment, je v… cours pas les rues pour chercher les étudiants. [rires] C’était à la suite de la publication d’un livre que j’avais écrit et euh… il était venu discuter parce que, suite à la publication de ce livre, donc, il voulait parler des techniques de construction médiévales. Et puis il m’a commencé à me parler de sa… Je serais tenté de dire sa passion [rires] pour le chantier Notre-Dame, pour le gothique, de toute façon, c’est quelqu’un qui s’avère très bien connaître au-delà de Notre Dame.
Voilà, au début, c’était vraiment une discussion comme ça, comme on peut en avoir avec des personnes qui sont intéressées par ce type de travaux. Et moi j’aime bien, j’aime bien discuter de temps en temps. Je pense que ça fait partie de notre métier que de partager avec un public large et pas uniquement à travers nos écrits.
Donc on a discuté, puis la discussion, bah… s’est poursuivie. Je sais qu’on était. Je me souviens quand on est allé discuter au Jardin du Luxembourg, Olivier était assez enflammé puis posait des questions. Il était un peu, comment dire, euh il voulait savoir, [rires de Fanny] il voulait comprendre. Il y a été un peu rentre-dedans. Bon enfin… J’aimais bien ça, je trouvais que c’était sympathique. Et puis il n’était pas question vraiment d’une thèse. Au départ, c’était… c’était plus, voilà il avait un peu envie qu’on lui… d’être encadré, je sais pas.
Et puis on discutait de ça et je trouvais où je trouvais que je trouvais que c’était un parcours intéressant, un profil intéressant parce que quelqu’un de curieux, quelqu’un qui, oui, puis, puis sympathique. Je crois qu’il ne faut pas nier le…
Fanny Cohen Moreau : Ah oui, je confirme, [rires]
Philippe Bernardi : Non, non puis c’est… il y a… comment dire, un facteur personnel dans les choses. C’est pas, c’est pas que du choix scientifique. Moi j’aime bien penser à ça. Penser au fait que ça a son importance.
Et donc voilà, on a discuté. Au fond, il cherchait sans chercher, il était pas pour. ‘Fin, j’sais pas ce qu’il en dira lui, mais moi je pense qu’il était un peu… Il tâtait le terrain de savoir ce qu’il pouvait faire. Moi au début c’était un peu éloigné de mes terres de prédilection on va dire. Même de l’époque un peu. Ce n’était pas ma spécialité, etc. J’étais… bon, mais je trouvais…
Fanny Cohen Moreau : Vous c’est plus le sud de la France…
Philippe Bernardi : Voilà, moi c’est plus le sud de la France, c’est plus la fin du Moyen Âge,
Fanny Cohen Moreau : Oui là…
Philippe Bernardi : là c’était Paris et… et le xiiᵉ xiiiᵉ, je me sentais pas bon euh… Je me sens d’ailleurs toujours pas complètement légitime sur ces sujets-là parce que voilà, parce que c’est pas c’est pas ce que je manie le mieux, mais en même temps, je me disais bon, je sais qu’on s’était séparés sur une, sur quelque chose de très ouvert, c’est à dire que moi je disais tout à fait prêt à lui avoir un peu lui proposer des personnes, etc. Et. Et puis quelques temps après, je sais plus, s’il m’avait appelé s’il m’avait écrit en me demandant si je serais d’accord pour diriger son travail. Bah voilà, c’est parti, c’est parti de ça. Je me suis dit pourquoi pas ?
[intermède sonore]
Fanny Cohen Moreau : Du coup, vous n’avez pas dirigé de thèse sur Notre-Dame avant Olivier ?
Philippe Bernardi : Non, non, non.
Fanny Cohen Moreau : C’est vraiment la première fois.
Philippe Bernardi : Oui, oui, c’est la première fois. C’est probablement, ‘fin non c’est même sûrement la dernière… [rires de Fanny] fois.
Fanny Cohen Moreau : Pourquoi la dernière ?
Philippe Bernardi : Parce que je, je veux plus prendre de thèse. Donc voilà. Non, non mais pas. [rire]
Fanny Cohen Moreau : D’accord mais…
Fanny Cohen Moreau : Alors je vois les yeux que vous me faites. C’est pas lui qui m’a dégoûté de la chose. Non, non, maintenant c’est que je pense que à l’âge que j’ai, je me sens pas de m’engager sur un travail avec quelqu’un pendant cinq, six ans, parce que souvent ça déborde et que je sais pas, je ne sais pas si je serais pas à la retraite dans, dans cinq/six ans, on verra ce que les gouvernements décident.
Non mais je ne sais pas du tout et je n’ai pas envie. Je trouve que ce n’est pas une bonne chose. Enfin moi les collègues font ce qu’ils veulent, mais je trouve que c’est important de pouvoir encore être dans le métier, vraiment dans le milieu, vraiment. Quand la personne soutient sa thèse, je trouve que voilà ça fait partie, puis. Et puis il y a, au-delà de l’aspect qui peut devenir assez ‘fin de la relation humaine qu’il peut y avoir. Moi j’estime que c’est, c’est un travail, on fait notre travail, etc. et très bien, mais je n’ai pas l’intention de le faire ad vitam aeternam, quoi. Donc voilà. Donc j’ai refusé toutes les dernières thèses qui m’ont été, qui m’ont été proposées parce que je trouve que… Voilà, et puis moi je trouve que c’est bien aussi que ce soit aux jeunes collègues de prendre le relais de ce genre de choses.
C’est important parce que c’est très formateur. C’est très enrichissant de suivre une thèse.
Fanny Cohen Moreau : Justement là, à l’heure où on enregistre cet épisode avec vous, Olivier va bientôt finir sa thèse. Est-ce que vous pourriez un peu nous parler de comment s’est déroulée la collaboration entre vous deux au cours de ces dernières années ?
Philippe Bernardi : De différentes manières en fait. Parce que là, vous nous prenez au moment de la… des premiers rendus de rédaction. J’ai déjà relu plusieurs chapitres et là c’est une phase particulière parce que les choses prennent forme, que les idées prennent place, s’organisent. Et là donc, bon… cette partie-là, c’est très, très, très, très particulier, parce que là on est vraiment dans le cœur des choses, mais dans le. Je dirais aussi dans l’importance de la manière de les présenter. Jusque-là, on est dans la… dans le développement de la pensée, dans le développement du sujet. Là, on est dans le rendu des choses et c’est, c’est très différent parce que… Ces mises en forme, qui n’est pas forcément à plat, [rires] ça peut être assez… comment dire…
Fanny Cohen Moreau : géométrique ?
Philippe Bernardi : chaotique, voilà, parfois non, mais c’est oui, c’est pas plat du tout. Je trouve que, au contraire, il faut qu’il y ait du relief, il faut qu’il y ait des choses fortes, des choses plus faibles. Et là en l’occurrence, mon rôle, c’est de voir à ce qu’il ne se laisse pas aller trop à des penchants, à des tics qui peut avoir de, je dis pas lui précisément, mais bon, ça a ce qui reste concentré sur son objet, à ce qu’il écrive bien ce qui m’a dit, c’est à dire que je l’ai vu justement pendant des années, j’ai vu sa pensée évoluer, son approche mûrir. On discute beaucoup de son travail et je veux, [rires] je peux le dire comme ça. Ce qui m’importe, c’est de retrouver dans son écrit la même vivacité que dans sa dans sa démarche à l’oral, dans sa démarche intellectuelle depuis le début, c’est-à-dire qu’il ne se plie pas à… Comment à ce qu’il peut penser être des passages obligés ou des facilités de langage ou des choses qui sont faites juste pour montrer qu’on fait partie de cette grande famille des historiens…
Donc ça c’est une phase très particulière où je découvre des choses. La pensée prend vraiment forme, je découvre des choses qui sont déroutantes mais dans le bon sens du terme. Et puis il y a des choses qui me conviennent moins… et donc on en rediscute ou je veux voir si… s’ il les défend ou s’il les défend pas, si c’est des choses qu’il a écrites comme ça par voilà, peut-être parfois on baisse un peu la garde en fait. Et là j’essaye de le pousser. Moi je trouve que mon rôle c’est de le pousser dans ses retranchements. C’est-à-dire que s’il a écrit quelque chose, il faut qu’il puisse le défendre.
Sinon bah c’est parti… d’abord dans la définition du sujet. Alors avec Olivier, c’était un peu particulier parce que, au départ, on avait pensé à un sujet beaucoup plus large. C’était… moi je pense que c’était pas inintéressant. Puis avec le temps, avec… avec son évolution professionnelle aussi, aussi ce qui s’est passé à Notre-Dame, ça a changé pas mal de choses. Et du coup ça s’est pas mal recentré sur Notre-Dame qui devait être, à la base, qu’un des aspects de son travail qui est déjà un gros aspect en l’occurrence.
Après ça a été, toutes ces années, ça a été de discuter. Je trouve que c’est important de discuter, d’être disponible autant que possible, malgré la distance parfois. Mais oui.
Fanny Cohen Moreau : Parce que lui est à Paris et aujourd’hui nous sommes pas très loin d’Avignon. Donc oui, c’est effectivement une grande distance.
Philippe Bernardi : Ouais enfin j’étais toutes les semaines, plusieurs jours sur Paris quand même. Oui mais bon, lui avait son emploi du temps, moi le mien, c’était pas toujours évident et ça c’était. C’est important de pouvoir, pouvoir discuter, voir les moments de doute, les moments utiles, les moments où on se fourvoie parce que… et ça, ça arrive à tout le monde. Au fond, on tire un fil et puis on se rend pas compte que ce fil, en le suivant, il nous éloigne du centre de notre, de notre intérêt premier. Après, je pense qu’une des choses importantes c’est de faire en sorte que les gens pour un pour un directeur, mais bon, ou d’autres peuvent trouver autrement, je sais pas… penser autrement, c’est d’arriver à… à voir ce que les gens ont à faire en sorte ou à aider les gens à sortir ce qu’ils ont, ce qu’ils ont à dire.
Fanny Cohen Moreau : Une forme de maïeutique un petit peu.
Philippe Bernardi : Peut-être oui, je sais pas, je le ressens comme ça… C’est, je trouve intéressant, quand on dirige une thèse, de voir les gens arriver avec un sujet qui est souvent ficelé d’une certaine manière, même quand il est bien ficelé, même s’il y a déjà des beaux mots et tout ça, là c’est tout. Et au fond, c’est une projection. Et ce qui est intéressant, c’est de voir après, avec la confrontation des sources, avec la confrontation de la bibliographie, des choses comme ça, de voir comment tout ça se délite à un moment donné.
Et là, après il faut reconstruire et c’est ce moment-là qui est le plus intéressant je trouve, parce que le délitement est intéressant, mais c’est là qu’il faut qu’il faut suivre. Mais il y a dans tout ça quelque chose d’une… Oui, pour moi, je trouve de l’ordre de la relation personnelle qui fait que parfois ça marche pas, ce sont des déceptions. Et puis parfois il me semble que qu’il y a des choses, quoi qu’on apporte peut être des choses aux gens en les encadrant comme ça, mais c’est pas toujours très, très, très évident non…
[intermède sonore]
Fanny Cohen Moreau : Et vous l’avez mentionné, effectivement, nous avons déjà parlé un petit peu dans ce podcast. Vous avez en plus, donc, dirigé une thèse sur Notre-Dame au moment de l’incendie. Qu’est-ce que ça a changé ? Qu’est-ce qui a eu comme effets, même pour vous en fait ? Est-ce qu’il y a eu quelque chose de particulier?
Philippe Bernardi : J’ai eu une crainte d’abord, je ne parle pas de mon sentiment par rapport à la chose, mais par rapport à Olivier. Une crainte. Crainte parce qu’il y avait beaucoup d’affect dans… dans cette chose et que dans, dans sa relation à la cathédrale. Donc une crainte que ça, ça le trouble fortement.
Ensuite, je n’étais pas sûr qu’il ait emmagasiné assez d’éléments à l’époque pour pouvoir finir son travail. Donc ça, c’était c’est terrible, C’est terrible pour quelqu’un qui y travaille pendant des années sur un sujet de, de perdre ses sources tout d’un coup. Bon mais ça m’a vite rassuré là-dessus.
Après, il y avait effectivement tous ces… cette attention portée sur Notre-Dame et ce travail qu’il avait fait, qui justement n’était pas à la base n’était pas forcément que sur Notre-Dame.
Là, il a exprimé la volonté de vraiment de recentrer là-dessus et ça prenait un sens différent, ça prenait un sens différent parce qu’au fond, oui, peut-être qu’il euh… c’était le bon moment pour recentrer, pour produire quelque chose sur et spécifiquement là-dessus. Peut-être que ça, ça valait le coup.
Fanny Cohen Moreau : Ce qu’il dit aussi, qui est, je trouve et émouvant dans un sens, c’est que pour lui, dans sa thèse, il a décidé de ne pas prendre en compte les découvertes qui ont été faites après l’incendie, dans sa thèse. Donc ça fait une thèse un petit peu complexe par rapport à ça aussi.
Philippe Bernardi : Mais disons que il y avait un problème, je dirais presque morale et éthique dans la chose. C’est-à-dire qu’avec l’incendie, avec toute l’effervescence scientifique autour de Notre-Dame et sa position, lui en tant que personne qui s’est retrouvée pas mal au centre de ces questions-là. La question se posait effectivement, c’est que d’une part, dans la mesure où beaucoup de travaux se lançaient, est-ce qu’il fallait attendre que tous ces travaux soient finis pour qu’il finisse sa thèse ? Auquel cas je ne sais pas dans combien de décennies il aurait fini. Ça, c’était c’est un point.
Ensuite, du point de vue éthique, l’utilisation des travaux des autres est quand même quelque chose d’un peu gênant, on va dire. Puis ça ne m’a pas paru poser un problème majeur dans la mesure où à un moment donné, il faut arrêter le travail, à un moment donné, il faut arrêter d’amasser des sources, de faire des relevés, etc etc. Parce que, ça c’est le lot de tout doctorant. Il faut à un moment donné se mettre à rédiger. Les sources, on peut les retourner dans tous les sens et on peut toujours en trouver. C’est pas la question. Si on pense qu’on a atteint ce seuil critique, qu’on a assez d’éléments pour émettre des hypothèses, pour proposer des solutions sans qu’elles soient… ‘fin de manière assez solide et sans les prétendre, sans prétendre qu’elles soient les nouvelles vérités sur telle ou telle chose, mais des possibilités, des pistes, etc, etc. Pourquoi ? Pourquoi ? Pourquoi aurait-il dû attendre ? C’était vraiment un problème, un problème crucial pour lui. Parce que soit il remettait sa thèse à dans dix ans, soit il faisait avec ce qu’il avait et il faisait en fonction de ce qu’il avait.
Ce n’est pas viser plus bas, c’est simplement essayer de faire quelque chose qui soit. Parce qu’il avait déjà pas mal de travail. C’était quand même pas loin de commencer à rédiger et voir ce. Je pense qu’il avait déjà commencé à lancer des premières… premières idées, ça changeait pas complètement la perception qu’il pouvait avoir de de la construction de Notre-Dame. Après, cela l’empêche de vérifier d’une certaine manière certaines choses, d’aller sur place, etc. Mais bon comme, comme beaucoup de monde donc bon. Oui effectivement, mais dans une thèse comme dans tout travail historique, il y a une part d’incertitude. On ne sait pas, il faut, faut juste qu’ils le mettent en évidence, juste dire bon voilà là, ça je ne sais pas, ça il faudra voir, etc. Je pense que ce n’est pas quelque chose de fini, un travail, un travail de recherche, jamais. Donc c’est ça qui est intéressant aussi parce que sinon, sinon, bah voilà, on ferme la porte.
[générique de fin]
Fanny Cohen Moreau : Merci beaucoup à Philippe Bernardi. Et on ne ferme pas tout à fait la porte. Il vous reste encore un épisode à écouter de cette série spéciale consacrée à Notre-Dame de Paris, et on parlera d’un lieu qui se trouve tout près de la cathédrale. Peut-être même que vous ne l’avez jamais vu, mais c’est un lieu qui vous permettra de voir la cathédrale autrement.
Merci beaucoup à Clément Nouguier pour le générique de cet épisode. Merci à Din pour la magnifique illustration et merci aux personnes qui soutiennent Passion Médiévistes sur Tipeee et qui ont permis le financement de cette série spéciale.
[extrait épisode 9 – Charles Villeneuve de Janti] : On est dans une sorte de fouille sous un couvercle.
Merci à Luc pour la transcription et à Tifenn pour la relecture !
Épisode 9 : La crypte du parvis de Notre-Dame de Paris
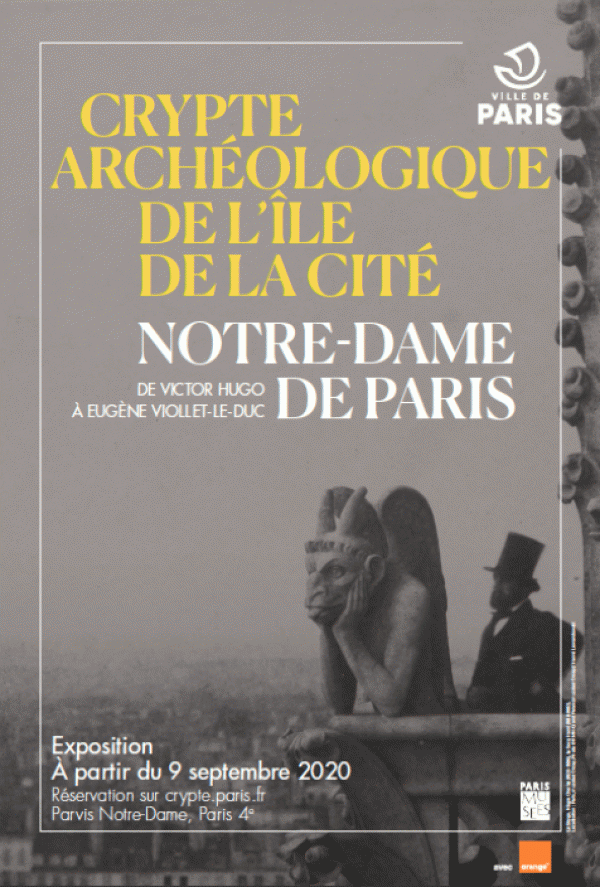
Au cours des épisodes précédents nous avons parlé du passé de la cathédrale, médiéval ou plus récent, de son ou de ses possibles futurs. Vous avez pu vous glisser par l’imagination entre ses murs, avec de formidables invités comme guides. Pour finir cette série je vous propose qu’on reste dans le présent et qu’on aille visiter un lieu juste à côté de Notre-Dame de Paris, pour explorer ce qui est visitable, enfin selon les conditions sanitaires…
Dans cet épisode Charles Villeneuve de Janti, conservateur du patrimoine et directeur des collections des musées de la ville de Paris, vous guide dans la crypte archéologique de l’île de la Cité, située au parvis de la cathédrale. Suite à un projet de parking à la fin des années 50, des fouilles ont été menées à partir des années 60 et ont permis la découverte des vestiges antiques. Un aménagement du site archéologique a ensuite été décidé, avec une première ouverture au public en 1980. Néanmoins il reste très peu d’éléments médiévaux dans cette crypte.
En septembre 2020 une exposition a été présenté pour raconter l’histoire de la cathédrale au XIXème siècle, de Victor Hugo à Viollet-le-Duc. Charles Villeneuve de Janti raconte cette exposition exceptionnelle, comment s’est déroulé à cette époque une réhabilitation du Moyen Âge, avec notamment beaucoup de photos du chantier montrant la vie quotidienne de l’époque mais avec les contraintes techniques de l’époque.
[Extrait épisode – Charles Villeneuve de Janti : ] Parce que c’est assez rare finalement, de conserver comme ça une fouille dans son état.
[Début Générique : ] Au cœur de Notre-Dame. Une série de podcasts par Passion Médiévistes.
Fanny Cohen Moreau : Bonjour à toutes et à tous ! Bienvenue dans ce neuvième épisode de la série spéciale sur la cathédrale Notre-Dame de Paris du podcast Passion Médiévistes, le dernier épisode de cette série.
Au cours des précédents épisodes, nous avons parlé du passé de la cathédrale médiévale ou plus récent, de son ou de ses possibles futurs. Vous avez pu vous glisser par l’imagination entre ses murs, avec de formidables invités comme guides. Pour finir cette série, je vous propose qu’on reste dans le présent et qu’on aille juste à côté de Notre-Dame de Paris pour explorer ce qui est visitable, enfin, selon les conditions sanitaires. Et pour ça, il faut aller sous terre…
[Fin générique]
[Bruit de pas]
Charles Villeneuve de Janti : Je suis Charles Villeneuve de Janti. Je suis conservateur en chef du patrimoine et directeur des collections des musées de la Ville de Paris. Alors, nous nous trouvons actuellement dans la crypte archéologique du parvis de Notre-Dame. C’est un espace qui se situe sous le parvis, donc en face de la cathédrale et qui est en fait une fouille qui a eu lieu dans les années 1960, qu’on a recouvert d’un… d’une sorte de sarcophage en béton pour la préserver dans son état et que les vestiges ne soient pas recouverts mais au contraire visitables. Donc on est dans une sorte de fouille sous un couvercle.
Alors dans cette crypte, on a découvert dans les années 1960, à la faveur de la construction d’un parking souterrain, des vestiges de différentes époques, mais dont la plupart en fait, datent de l’époque gallo-romaine, avec des vestiges du port primitif de Lutèce. On trouve aussi des vestiges de thermes romains. Et donc on a décidé de conserver tout… tout cela. S’y ajoute un enchevêtrement de différents murs. Alors on a des murs de fortifications de Paris de… du Bas-Empire, donc c’est des choses très précieuses. Et puis on a aussi quelques vestiges du xviiiᵉ siècle, comme l’Hôpital des Enfants-Trouvés. On a quelques fondations de ce bâtiment qui se trouvait devant Notre-Dame.
Et tous ces vestiges donc, sont imbriqués les uns dans les autres. C’est assez difficile à lire, mais en même temps c’est passionnant. Donc c’est pour ça qu’à l’époque, dans les années 1960, on avait eu cette idée de se dire, bah cette fouille plutôt que de la recouvrir ou d’en faire un parking, on va la mettre sous cloche et puis essayer de la scénographier pour que les visiteurs puissent lire cette histoire de Paris à travers ces vestiges.
Donc en fait, ça se présente comme un espace de fouilles avec tous ces murs au centre. Et sur les côtés, il y a des sortes de plateformes sur lesquelles les visiteurs peuvent circuler et faire le tour des vestiges. On peut aussi parler de ce qu’on ne voit pas autour de nous. Donc il y a un parking. Il y a aussi deux réserves archéologiques qui sont des zones qui n’ont pas été fouillées dans les années 1960, qu’on a aussi protégées parce qu’on sait qu’elles renferment des vestiges importants mais qui restent à fouiller pour le futur. Donc ça aussi, c’est assez passionnant de savoir que finalement, on est encore dans une fouille qui n’est pas complètement morte mais qui pourrait accueillir des archéologues dans le futur.
On a essentiellement des vestiges liés au port, donc c’est des… des quais et des sortes d’entrepôts pour stocker des marchandises. On a donc ces remparts qui sont plutôt à vocation défensive. Et puis un petit peu d’architecture religieuse.
Ce qui est intéressant dans cette histoire, c’est que comme dans beaucoup de cas en fait, les constructions se sont superposées les unes aux autres et pour pas repartir de zéro, on utilisait les fondations qui étaient déjà existantes sur place. Donc en fait, la plupart de ces… de ces vestiges notamment de l’époque romaine étaient au Moyen Âge des caves, des maisons qui se trouvaient sur le parvis Notre-Dame ; et puis ensuite ça a été comblé, notamment pendant l’époque haussmannienne.
On a aussi des traces du premier réseau d’égouts de Paris qui datent du xixᵉ siècle. Voilà, tout ceci est mélangé et c’est ça qui est peut-être un peu compliqué pour le… primo-visiteur, c’est d’arriver à lire ces strates. C’est pour ça que tout autour, il y a tout un tas de dispositifs, notamment multimédias, qui permettent de montrer des reconstitutions pour essayer de mieux visualiser ces vestiges. Parce que c’est assez rare finalement de conserver comme ça une fouille dans son état.
Alors dans les espaces dans lesquels on se trouve, ceux qui sont ouverts à la visite… tout a été fouillé. Alors on présente dans des vitrines, à la fin du parcours justement, des objets qui ont été trouvés ici ou dans des fouilles similaires à proximité. Et puis on a aussi euh… ces deux réserves archéologiques où là, pour le coup, il reste des choses à analyser, à fouiller.
Alors le paradoxe, c’est qu’on a beau être sous le parvis de Notre-Dame, la plupart des vestiges de la crypte n’ont pas de lien direct avec la cathédrale. Il y a beaucoup de visiteurs qui pensent que c’est la crypte de la cathédrale. En fait, la crypte de la cathédrale, conçue par Soufflot, elle est sous la cathédrale, mais là on est bien devant la cathédrale et donc c’est plus des vestiges du premier Paris… de Lutèce sur l’Île de la Cité qu’on trouve ici. Mais c’est pas forcément des vestiges connectés à la cathédrale.
[Intermède sonore : ambiance de la crypte ]
Charles Villeneuve de Janti : Suite à l’incendie de Notre-Dame, le 15 avril 2019, il y a eu un projet au sein de Paris Musées de créer une exposition dans la crypte archéologique pour parler de Notre-Dame de Paris. Et c’est là qu’on a eu cette idée de raconter l’histoire de Notre-Dame au xixᵉ siècle, de Victor Hugo jusqu’à Viollet-le-Duc.
Pourquoi cette période du xixᵉ siècle ? Et bien c’est parce que justement, on était face à cette destruction de la charpente de la cathédrale, cette perte aussi de la flèche. Et il y a eu tout un tas de débats qui sont… qui se sont fait jour sur la reconstruction de Notre-Dame. Et en fait, ça nous a rappelé les débats qu’on avait eu un siècle plus tôt, du temps de Viollet-le-Duc, avec ces fameuses théories dont on parlera peut-être sur la restauration. Qu’est-ce que c’est restaurer un monument au xixᵉ siècle ? C’est pas tout à fait la même notion que… qu’actuellement au xxiᵉ siècle. Et donc tous ces débats, finalement ils sont… ils sont un peu intemporels. On se les est toujours posés. Donc on voulait raconter cette histoire. Et puis dans les musées de la ville de Paris, on a la maison de Victor Hugo qui conserve toutes les archives de ce grand écrivain.
Et puis on a aussi le musée Carnavalet, dont dépend d’ailleurs la crypte archéologique où on se trouve qui est le Musée d’Histoire de Paris et qui conserve lui aussi un fonds intéressant, et notamment des photographies parmi les premières de l’Histoire, puisque c’est des daguerréotypes ou ces procédés comme ça de la première photographie qui raconte aussi le chantier de restauration de Viollet-le-Duc et qui sont aussi des témoignages assez originaux.
Donc on avait envie de montrer tout ça et de raconter cette histoire ici, même si, comme on le disait en préambule, bah les vestiges archéologiques ne sont pas ceux de Notre-Dame, mais il se trouve qu’on est tout près, donc ça avait du sens aussi de présenter cette exposition dédiée à Notre-Dame au pied des tours de la cathédrale.
[Intermède musical ]
Charles Villeneuve de Janti : Au xixᵉ siècle, Eugène Emmanuel Viollet-le-Duc, qui est un architecte, va élaborer sa théorie personnelle de la restauration. Et pour lui, restaurer un édifice, c’est le remettre dans un état idéal qui n’a peut-être jamais existé. Donc on est très, très loin de nos théories modernes de restauration puisqu’actuellement on… c’est guidé par ce qu’on appelle la Charte de Venise qui définit qu’en fait, on doit laisser la trace du temps en fait, de laisser la trace de chaque époque. Et donc on ne va pas aller inventer quelque chose qui n’a jamais existé.
Par contre Viollet-le-Duc, il n’est pas du tout là-dedans. En fait, lui, quand il prend le chantier de Notre-Dame en main, son projet c’est d’en faire une sorte de cathédrale idéale aussi, donc il va pas hésiter à recréer des choses qui ont disparu. Alors ce qui était le cas des destructions révolutionnaires qui ont pas mal affecté la statuaire de la cathédrale. Mais il va même aller beaucoup plus loin en concevant des choses qui n’ont jamais existé.
L’exemple des gargouilles est assez parlant puisque… on sait qu’il y avait des gargouilles parce qu’elles sont connues par des gravures, par différents documents anciens, mais on n’avait pas de relevé photographique ou de choses très très précises. Donc Viollet-le-Duc a dû les réinventer, les redessiner et là on est vraiment pour lui dans de la restauration. Et nous on serait plutôt on qualifierait ça à notre époque de création contemporaine. Alors il va faire… c’… c’est intéressant comme mode de travail parce qu’il va s’entourer de… de grands sculpteurs. Le plus important, c’est Geoffroy-Dechaume qui dirige vraiment l’atelier de sculpture du chantier de restauration au xixᵉ siècle. Et Viollet-le-Duc va faire des dessins extrêmement précis. Donc en fait, la liberté d’invention des sculpteurs est quand même très contenue par l’architecte et c’est vraiment l’architecte qui guide la main, le ciseau du sculpteur dans ce chantier. Donc c’est assez… assez original comme mode de fonctionnement.
Dans l’exposition, on parle surtout d’architecture, mais il faut savoir qu’il conçoit aussi à l’intérieur le mobilier liturgique, les vêtements liturgiques. Il va extrêmement loin dans le détail parce que pour lui, la cathédrale est un tout.
Il y a par exemple, on parlait tout à l’heure de Geoffroy-Dechaume. Il se fait… enfin, il va choisir des sculptures qui sont en cours de réalisation pour demander à des photographes de les prendre en photo. Mais on a la vie du chantier au quotidien, on a une bâche derrière, on a des… des pots avec des outils. C’est assez amusant parce qu’il y a un côté instantané.
En même temps, il faut avoir un certain recul sur ces images. Elles sont très contraintes par les procédés photographiques de l’époque qui imposent des temps de pose très longs. Donc c’est pour ça qu’on voit personne sur ce chantier alors qu’il y avait plein de monde. Mais c’est juste parce que s’il y avait des ouvriers sur le… qui étaient sur le chantier, ben ils ont pas été pris en photo parce que leur image ne s’est pas imprimée du fait des temps de pose. Et puis souvent, les photographes à l’époque préfèrent des sujets qui sont immobiles, donc de l’architecture, c’est très bien. La sculpture aussi. Euh… on ne peut pas photographier le mouvement.
Et il y a quelques photos, on voit des foules, notamment une photo du baptême du prince impérial, mais en fait la foule est floue. Ce qu’on voit bien, c’est l’architecture. C’est ce qui est statique.
Elles sont très précieuses aussi parce que de la même manière que ça se pratique aujourd’hui sur le chantier de Notre-Dame, actuellement pour la restauration, on a des campagnes photographiques. Alors c’est pas tout à fait des campagnes comme maintenant où on passe une commande à un photographe, mais disons que… on constate que le chantier est ouvert aux photographes. Viollet-le-Duc, d’ailleurs, les fait venir pour faire aussi sa propre promotion. Ils vont comme ça figer des instants du chantier sur le papier photographique et on a comme ça des traces très intéressantes de l’état de la cathédrale avant l’intervention de Viollet-le-Duc, en cours de travaux. On voit vraiment la progression de ce chantier et on voit des choses qu’on avait un petit peu oubliées. Par exemple, le fait que Viollet-le-Duc utilisait beaucoup de… de sortes de fantômes, de sculptures. On faisait des, des panneaux découpés en bois qu’on peignait en trompe-l’œil et qu’on plaçait comme ça sur l’architecture pour se rendre compte de l’effet de telle ou telle sculpture.
C’était le cas, par exemple, des sculptures de la Galerie des Rois qui sont au-dessus des portails de Notre-Dame. Si on regarde attentivement les photographies, on se rend compte qu’elles sont en deux dimensions ces sculptures. En fait, c’est pas des sculptures, c’est des sortes de fantômes en bois qui permettent à l’architecte de se rendre compte de l’effet d’une sculpture avant qu’elle soit taillée. Ça permet, je pense, aussi de faire comprendre aux autorités l’intérêt parce que… Viollet-le-Duc passe son temps à demander de l’argent, de voir l’intérêt de reconstituer telle ou telle sculpture ou donc euh… ça, c’est quelque chose d’assez intéressant qui existait déjà autrefois. Parce qu’au xviiiᵉ, par exemple, pour le chantier de Sainte-Geneviève, l’actuel Panthéon, on avait déroulé une toile pour que Louis XV puisse se rendre compte de la façade qu’on allait construire, une toile à grandeur. Donc en fait, ça s’est toujours pratiqué. Ça permet aussi d’attendre que les… – puisque c’est des chantiers qui sont très longs – d’attendre que les travaux se fassent et d’avoir quand même déjà une idée du résultat.
Alors aujourd’hui, on a la 3D. Mais c’est vrai que ces photographies rappellent ces procédés qu’on a un peu oubliés parce que c’est des procédés éphémères, on en a rien gardé. On a même des photographies très intéressantes pour l’histoire de l’architecture, qui nous montre donc l’état de la cathédrale avant Viollet-le-Duc et surtout après le xviiiᵉ siècle. Parce que le xviiiᵉ siècle a beaucoup modifié cette architecture médiévale, notamment sur la façade de la cathédrale. Soufflot va par exemple détruire un tympan du portail central pour pouvoir faire passer des dais de processions plus facilement. Et puis c’est le goût néo-classique, donc on simplifie aussi cette architecture qui semble trop chargée. Et ça on en a traces sur les photographies, justement, de… on a cet état xviiiᵉ qui est intéressant et qu’on voit sur les photographies. Et Viollet-le-Duc, finalement… a remis toutes ces modifications du xviiiᵉ siècle, les a remis dans un état médiéval ou en tout cas tel qu’il le pensait médiéval. Mais ces photographies nous permettent aussi de lire ça.
[Intermède sonore : ambiance de la crypte ]
Charles Villeneuve de Janti : Euh… Une des choses qu’on découvre en visitant cette exposition aussi, c’est que Notre-Dame était pas très aimée au début du xixᵉ siècle. Ça vient d’avant, c’est dès le xviiiᵉ siècle, avec le goût du néo-classicisme. Cette architecture médiévale, on va la qualifier de gothique, mais il faut bien avoir en tête que ce qualificatif de gothique, c’est péjoratif. L’architecture médiévale n’est pas forcément bien vue.
Et d’ailleurs, quand Victor Hugo va écrire son roman Notre-Dame de Paris, il trouve très peu de sources historiques sur Notre-Dame. C’est bien dire qu’on n’a même pas fait de recherche sur ce monument. Alors ensuite, il y a eu la Révolution française. Déjà avant la Révolution, on avait abattu la flèche pour des histoires de structure : en fait elle n’était pas entretenue et donc elle menaçait la charpente. Et puis à la Révolution, là il y a un véritable vandalisme qui se met en place où on va volontairement basculer toutes les sculptures de la Galerie des Rois dans le vide, parce qu’on les assimile aux rois de France, alors qu’en fait c’est les rois de l’Ancien Testament. Et puis on va dégrader la statuaire au niveau des portails, essentiellement, ce qui est accessible à la main. Ensuite, on va retirer le plomb de la charpente… de la toiture pour en faire des balles. Donc la charpente va rester à nu pendant assez longtemps. Ça va être rapidement un temple de la Raison. Et puis très vite, on va avoir l’idée d’en faire un entrepôt et avec toutes ces péripéties. Bah finalement le monument n’est pas entretenu et se retrouve de plus en plus dégradé.
Pour avoir une idée du désamour qu’on a pour l’architecture médiévale, quand Napoléon se fait sacrer empereur à Notre-Dame de Paris en 1802, il va demander à Percier et Fontaine de faire un habillage en trompe-l’œil de la façade. Façade néo-classique dans le goût, dans le style qui domine à l’époque. On est au tout début de l’Empire et donc on va cacher cette façade pour bien montrer qu’on l’aime pas. Et pareil dans le chœur. Quand vous regardez le tableau du sacre de Napoléon par David, si vous regardez, on reconnaît pas le chœur de Notre-Dame parce qu’en fait tout est plaqué d’un décor éphémère qui est plutôt néo-classique et qui cache une architecture médiévale en dessous.
Donc, quand Victor Hugo prend la plume pour écrire Notre-Dame de Paris, ce monument n’est pas du tout aimé et on pense même à le démolir parce que c’est l’époque où on va commencer à démolir des églises dans Paris pour aérer la capitale. Donc juste à côté d’ici, on a par exemple l’église Saint-Jacques qui va disparaître pour laisser place à un square. On garde juste la tour du clocher et pour Notre-Dame de Paris, on a la même idée parce qu’on est en plein réaménagement en plus du… de l’Île de la Cité. Donc on pense démolir Notre-Dame de Paris. D’abord, ça apporte des pierres et puis ça libère de la surface en plein cœur de Paris. Donc il y a une vraie menace sur ce monument, au-delà du simple fait qu’il ne soit pas entretenu.
Donc Victor Hugo va vraiment réussir une adhésion populaire autour de ce monument parce qu’il en fait un personnage. En fait, il y a tous… il y a Quasimodo, Esmeralda, Frollo dans son roman mais la cathédrale elle-même est un monument, qui a un rôle de personnage dans ce roman, et cette adhésion populaire va finalement pousser l’opinion publique à demander la sauvegarde de Notre-Dame. On va faire un concours d’architecture qui va être gagné par Lassus et Viollet-le-Duc. Et Viollet-le-Duc va en faire le grand chantier finalement du Second Empire, puisque les travaux vont durer quasiment 50 ans. Et c’est un chantier fondamental parce qu’on va démonter par exemple les deux roses Nord et Sud pour les remonter intégralement. C’est vraiment une restauration qui va très, très, très loin, avec beaucoup de créations, comme on le disait tout à l’heure.
Mais on raconte tout ça et comment en fait, voilà, Notre-Dame aurait pu disparaître, d’abord par désamour, ensuite par manque d’entretien, mais d’abord par désamour. Et ça, c’est quelque chose qu’on n’a pas du tout en tête maintenant. Quand on parle d’architecture gothique, on perçoit plus ce côté… Même le mot Moyen Âge c’est… il y a un côté sombre, un peu péjoratif voilà à l’époque, qui est un vrai problème pour la sauvegarde de ces monuments.
Alors ce qu’on peut souhaiter pour le parvis de… ‘fin pour le… pour Notre-Dame et son parvis dans les années à venir… Déjà qu’elle puisse ré-ouvrir aux publics parce que c’est quand je dis aux publics c’est vraiment public au pluriel, à la fois les touristes mais aussi les pèlerins qui continuent parce que ça continue aussi d’être un lieu de culte et je trouve que c’est très intéressant que ce monument garde sa dimension religieuse et ne l’ait jamais perdu finalement, depuis sa consécration au Moyen Âge. Et puis soit devenu aussi ça, c’est le fait du temps, le lieu touristique le plus fréquenté de Paris avec 12 millions de visiteurs. Donc Notre-Dame, c’est tout ça. Ça reste un lieu de pèlerinage, un lieu de culte, un lieu touristique et ce serait bien que… elle puisse retrouver cette triple fonction à sa réouverture.
Fanny Cohen Moreau : Car oui, à l’heure où sort cet épisode, il n’est bien sûr pas encore possible de visiter Notre-Dame, mais j’espère que cet épisode vous aura donné envie d’aller visiter la crypte du parvis de la cathédrale. Enfin, dès que ce sera possible de la visiter, le plus vite possible, on l’espère !
[Début générique de fin]
C’est la fin de ce format spécial de Passion Médiévistes, de cette série spéciale d’épisodes sur la cathédrale Notre-Dame de Paris. J’espère que ça vous a plu, que vous avez aimé découvrir ce monument par plusieurs aspects, que vous avez apprécié, écouter, les différentes personnes qui sont liées de près ou de loin à ce monument et qui vous ont raconté leur expérience et partager leurs connaissances.
J’aurais pu vous faire encore plein d’autres épisodes. J’aurais pu explorer plein d’autres thématiques comme les vitraux, les roses, les fenêtres, les statues, la toiture, l’étude du bois. Mais bon… il fallait bien trouver une fin… Si vous voulez en savoir plus sur les sujets que nous avons abordé, vous pouvez retrouver tous les épisodes de cette série spéciale et des informations complémentaires sur le site passionmedievistes.fr. Il y a une page spécialement consacrée à la série.
À l’heure où sort cet épisode, Olivier de Châlus, que vous avez entendu plusieurs fois, va bientôt soutenir sa thèse et je le remercie particulièrement pour son aide et sa collaboration, pour la réalisation de cette série. Je remercie encore les personnes qui m’ont aidé à préparer les épisodes. Donc le fabuleux Clément Nouguier pour l’habillage musical, la magique Din pour le visuel, le pétillant podcasteur, Jonathan pour les montages. Et enfin merci aux personnes qui soutiennent Passion Médiévistes sur Tipeee qui ont permis de financer cette série. Si vous aussi vous voulez soutenir les prochains projets de ce podcast, il vous suffit de vous rendre sur le site Tipeee avec trois « e » point com slash Passion Médiévistes. Le lien sera dans la description de cet épisode.
[Intermède musical]
Et j’ai un conseil pour finir. Pour observer la cathédrale Notre-Dame de Paris, je vous confie mon endroit préféré : allez sur les quais de Seine, au sud de la cathédrale, sur la rive gauche, trouvez un passage entre le pont au Double et le pont de l’Archevêché pour descendre jusqu’au bord du fleuve. Trouvez ensuite un banc en pierre pour vous asseoir ou si vous avez le goût de l’aventure, vous pouvez vous asseoir directement au bord du quai. Et juste là, que ce soit de jour ou de nuit, vous aurez une très belle vue sur Notre-Dame. Vous pourrez repenser à comment des personnes ont construit cette cathédrale il y a plus de 850 ans, aux bateaux qui ont apporté les blocs de pierre jusque devant vous, à ce voleur anglais de 1218 qui provoqua le premier incendie, à la flèche du Moyen Âge et la flèche de Viollet-le-Duc, fantômes pointant vers le ciel, qui ne disparaîtront jamais totalement. Et vous pourrez vous demander à quoi ressemblera la cathédrale dans 850 ans, quand une personne se tiendra là où vous êtes, avec le même vertige qui emplit l’âme et vous ravit le cœur.
[Fin de générique : musique au piano avec voix]
Merci à Luc pour la transcription et à Tifenn pour la relecture !
Épilogue

J’espère que cette série spéciale vous a plu, que vous avez aimé découvrir ce monument par plusieurs aspects, que vous avez apprécié écouter les différentes personnes qui y sont liées de près ou de loin à ce monument et qui vous ont raconté leur expérience et partagé leurs connaissances. J’aurais pu vous faire encore d’autres épisodes, j’aurais pu explorer plein d’autres thématiques comme les vitraux, les roses, les fenêtres, les statues, la toiture, l’étude du bois… Mais il fallait bien trouver une fin.
A l’heure où sort cet épisode, Olivier de Châlus, que vous avez entendu plusieurs fois, va bientôt soutenir sa thèse, et je le remercie particulièrement pour son aide et sa collaboration pour la réalisation de cette série.
Merci aux personnes qui soutiennent Passion Médiévistes sur Tipeee qui ont permis de financer cette série. Si vous voulez soutenir vous aussi les prochains projets de ce podcast, il vous suffit de vous rendre sur cette page.
Crédits :
- Générique réalisé par Clément Nouguier
- Montages par Jonathan (Le Mec d’Ozef)
- Visuel réalisé par Din