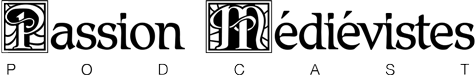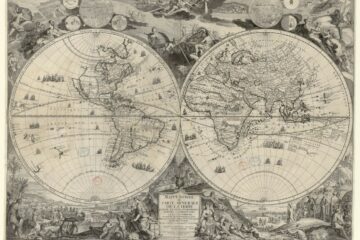Épisode 112 – Aude et l’encens au Moyen Âge (au Château de Vincennes)
À quoi servait l’encens et comment utilisait-on les encensoirs au Moyen Âge ?

L’invitée de l’épisode 112 de Passion Médiévistes est Aude Chevalier Barbier. En 2023, sous la direction de Brigitte Boissavit-Camus à l’Université Paris-Nanterre, elle soutenait une thèse intitulée « Dans les fumées sacrées : productions, usages et représentations des encensoirs en France (XIIème-XVIIème siècles) ». Dans cet épisode elle vous raconte les usages et les symboliques de l’encens au Moyen Âge et son travail sur les encensoirs.
À noter que cet épisode a été enregistré en public dans le donjon du château de Vincennes qui a eu la gentillesse d’accueillir et de financer cet enregistrement. Je vous conseille fortement d’aller le visiter !
L’encens au Moyen Âge
“Ce qui est sûr c’est qu’il y avait de la gomme arabique, des huiles et des épices [dans l’encens].” — Aude Chevalier.
Aude Chevalier définit l’encens comme, d’une part, la résine d’oliban, soit la sève odorante de l’arbre du même nom. Il s’agit d’une substance rare, récoltée pour ses propriétés odoriférantes et destinée à être brûlée. D’autre part, elle précise que l’encens désigne communément tout ce qui sent bon une fois brûlé, ainsi que l’odeur, elle-même, des matières odoriférantes brûlées. Depuis l’Égypte ancienne, elle vous parle des plus anciennes traces d’encens connues à ce jour. En effet, dans l’Antiquité, l’encens était utilisé comme offrande aux dieux — nous vous en parlions avec Euan Wall dans l’épisode 20 de Passion Antiquités.
“L’encens est utilisé quasi exclusivement par des religieux […], parce que ça sent bon et que ça cache les odeurs lors des funérailles.” — Aude Chevalier.

Au Moyen Âge, l’encens est plutôt utilisé dans le cadre liturgique, c’est-à-dire pendant les cérémonies religieuses, notamment au cours des messes ou des grandes célébrations ou des funérailles, par exemple. Sur ce dernier point, Aude Chevalier insiste sur les propriétés odoriférantes de l’encens, efficace pour masquer l’odeur propre à ce contexte (et non pas à cause de la saleté au Moyen Âge, cliché que nous démontons dans l’épisode 6 de notre format du même nom), mais aussi parce que l’encens aurait des vertus antiseptiques.
Si l’encens est présent partout dans les livres de comptes étudiés par Aude Chevalier, elle avoue cependant ne pas avoir trouvé de traces systématiques d’encensoir dans toutes les paroisses.
Les encensoirs
“L’encensoir est un objet d’une vingtaine de centimètres de haut, composé d’un pied, d’une coupelle, d’un couvercle percé et de chaînes.” — Aude Chevalier.
Aude Chevalier vous décrit les encensoirs avec précision et commence par différencier les encensoirs liturgiques des brûle-parfums, objets de la vie laïque dans lesquels on brûlait des huiles parfumées — Élodie Pierrard vous en parlait dans notre épisode 82, consacré aux parfums. Les encensoirs étaient couramment fabriqués en alliage cuivreux, soit en bronze ou en laiton, mais il en existait aussi en métaux précieux : or ou argent. Beaucoup étaient ornés et les motifs les plus récurrents sont des représentations de la femme de l’Apocalypse ou de la Jérusalem céleste.
“ L’encens et l’encensoir ensemble ont une vertu d’intermédiaires. [Ils évoquent] la prière qui monte vers le ciel et la Jérusalem céleste.” — Aude Chevalier.

Outre les matériaux employés dans la fabrication des encensoirs, Aude Chevalier s’attarde sur les méthodes de fabrications de ces objets liturgiques et différencie ainsi les encensoirs de la période médiévale de ceux fabriqués et utilisés à partir du XVIème siècle.
“[Acheter un encensoir] représente quand même un investissement, par exemple pour les paroisses rurales. Mais ce n’est pas un objet excessivement cher […] : c’est un bon investissement.” — Aude Chevalier.
Après vous avoir énuméré différents types d’encensoirs et brossé leurs particularités esthétiques, Aude Chevalier a estimé les coûts de production d’un tel objet et établi un rapport qualité-prix. Pour vous, elle revient sur les corporations (détaillées dans l’épisode 32 de Passion Modernistes avec Gillian Tilly). De fait, au Moyen Âge, seuls les orfèvres sont autorisés à fabriquer des encensoirs ; tandis qu’à partir de l’époque moderne, cela devient le travail des fondeurs.
Outre son apparence, Aude Chevalier vous explique les divers moments auxquels l’encensoir est utilisé pendant la messe et s’attarde sur leurs significations. Par exemple, selon les circonstances, l’encensoir symbolise tantôt le sacrifice du Christ, tantôt le corps de Jésus (au même titre que l’escargot — souvenez-vous, c’était dans l’épisode 74 avec Julia Pineau). L’encensoir peut aussi faire référence aux saints, puisqu’il agit comme un intermédiaire entre Dieu et les humains.
Les recherches de l’invitée
“J’aime bien les objets moches, je crois.” — Aude Chevalier.

Aude Chevalier travaille sur une vaste période de cinq siècles entre le XIIème sièlce (avec les premiers encensoirs datés) et le XVIIème siècle (à partir duquel la méthode de fabrication change). Elle se concentre sur les encensoirs conservés en France, plus spécifiquement, en Auvergne.
Au cours de ses recherches, Aude Chevalier a pu constater des évolutions formelles entre les encensoirs médiévaux et les encensoirs fabriqués à partir du XVIème sièlce. Ainsi, si l’encens et ses emplois restent les mêmes, il existe différentes formes d’encensoirs, sur lesquels on représente également divers motifs.
“Les encensoirs sont des objets d’un certain âge, qui sont encore utilisés aujourd’hui.” — Aude Chevalier.
En sa qualité d’historienne de l’art, Aude Chevalier a beaucoup travaillé sur les encensoirs en eux-mêmes, notamment à partir des 44 encensoirs auvergnats de son corpus, qui en compte quelques 200. En plus de ses recherches sur les objets, elle a épluché de nombreux livres de comptes disséminés dans les différentes paroisses d’Auvergne.
Aude Chevalier s’attarde sur son parcours, confesse ses difficultés pour accéder aux objets — classés monuments historiques — et explique comment ses recherches ont aussi permis à des institutions de retrouver des encensoirs, jusqu’alors oubliés dans les fonds d’archives.
Pour en savoir plus sur le sujet de l’épisode, on vous conseille de lire :
-

Illustration de l’épisode 112 sur l’encens par din Atchley 1909 : Atchley Edward Godfrey Cuthbert Frederic, A history of the use of incense in divine worship, Londres, Longmans Green, 1909.
- Barraud 1860 : Barraud Pierre-Constant, « Notice archéologique et liturgique : sur l’encens et les encensoirs », Bulletin Monumental, 26, 1860, p. 621-668. En ligne : https://gallica.bnf.fr/ark:/
12148/bpt6k31104g/f637.item, consulté le 10/08/2023. - Gauthier 2008 : Gauthier Catherine, L’encens et le luminaire dans le haut Moyen Âge occidental. Liturgie et pratiques dévotionnelles, Bruxelles, Université libre de Bruxelles, 2008 (Thèse de doctorat en histoire, arts et archéologie).
- Pottier 1866 : Pottier Fernand, « Étude sur les encensoirs », Le Moniteur de l’archéologue et du collectionneur, sér.2-1, Toulouse, Imprimerie Caillol et Baylac, 1866, p.65-77 et 97-110.
- Rohault de Fleury 1887. Rohault de Fleury Charles, Rohault de Fleury Georges, « Encens », in La Messe. Études archéologiques sur ses monuments, vol. 5, Paris, Librairie des imprimeries réunies, 1887, p. 150-169.
- Viollet-le-Duc 1858 : Viollet-le-Duc, Eugène-Emmanuel. « Encensoir » in Dictionnaire raisonné du mobilier français de l’époque carlovingienne à la renaissance, tome deuxième, Paris, Bance Vve Morel, 1858-1875, p. 97-101.
Si cet épisode vous a intéressé vous pouvez aussi écouter :
- Épisode 9 — Thomas et les luttes de pouvoir en Auvergne
- Épisode 74 — Julia et l’escargot au Moyen Âge
- Épisode 82 — Élodie et les parfums au Moyen Âge
- Épisode 88 — Pauline et les hôpitaux
- Épisode 20 — Euan et les offrandes dans l’Italie préromaine (Passion Antiquités)
- Épisode 41 – Bérengère et les apothicaires au XVIIIème siècle (Passion Modernistes)
Merci à Alizée Rodriguez pour la rédaction de l’article qui accompagne cet épisode !