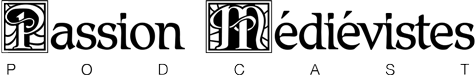Épisode 111 – Charles et les vêtements civils au Moyen Âge central
Comment s’habillait-on au Moyen Âge central, avec quels vêtements ?

Pour ce 111ème épisode de Passion Médiévistes, Charles Bricout vous parle de ses recherches dans le cadre de sa thèse de doctorat intitulée « Histoire du vêtement et ses accessoires dans le royaume de France (fin du XIIe siècle – début du XIVe siècle) ». Il est sous la direction de Valérie Toureille, à l’université Cergy Paris Université. Suivez le fil de ce nouvel épisode passionnant, qui vient étoffer un peu plus les connaissances sur la mode et le vêtement médiéval.
Retrouvez le travail de Charles Bricout aussi sur son compte Instagram !
Les recherches de l’invité
“[Le but de mes recherches] peut se résumer en une phrase : mieux connaître le vêtement, si ce n’est connaître le vêtement. […] Oui : c’est gros, c’est fourni, c’est feuillu.” — Charles Bricout.
Charles Bricout concentre ses recherches sur le Moyen Âge central, avec un intérêt tout particulier pour le XIIIème siècle. Appelé en France “le beau Moyen Âge”, c’est le temps des tournois de chevalerie et de la révolution de l’écrit, juste avant la guerre de Cent Ans et la peste. Charles Bricout souligne d’ailleurs à quel point il s’agit d’une période charnière.
“[Le Moyen Âge central] m’a toujours plu : c’est la période de l’imaginaire médiéval, des premiers châteaux en pierre, des chevaliers, et […] la période la plus belle du Moyen Âge ! ”— Charles Bricout.
Sur le plan géographique, Charles Bricout se focalise principalement sur le royaume de France, mais il s’intéresse aussi aux territoires voisins, notamment le Saint-Empire romain germanique et l’Angleterre. Selon lui, il y a une véritable “mode occidentale”, régie par des codes communs. Vous entendez toutefois que l’Espagne et de l’Italie font figure d’exception, malgré leur proximité géographique.

Dans sa thèse, Charles Bricout étudie à la fois le vêtement masculin et le vêtement féminin, dans toutes les couches de la société. Il s’attarde néanmoins plus particulièrement sur le vêtement civil, qu’il différencie ainsi des deux autres grands types de vêtements médiévaux, à savoir le vêtement religieux et le vêtement militaire.
La mode à la fin du Moyen Âge
Entre l’habit carolingien étudié par Léa Flohic – que nous recevions à ce sujet dans l’épisode 98 – et le vêtement du XIIIème siècle dans la thèse de Charles Bricout, il y a des changements majeurs. Plus ample, plus long, la tenue et ses ornements font même l’objet d’une loi, sur laquelle Charles Bricout revient en milieu d’épisode.
Faisant écho à l’épisode 27 de Passion Antiquités dans lequel nous voyagions dans l’Égypte pharaonique pour parler de la pilosité – Charles Bricout s’attarde également sur la barbe des hommes à l’époque médiévale. Il la définit comme faisant partie intégrante du “costume”, dont il définit les nuances avec précision, à notre micro.
“[Pour le vêtement de base,] on pourrait dire qu’on est sur une mode plutôt unisexe, avec des différences dans la longueur, dans l’ampleur, dans les usages…” — Charles Bricout.

Et les détails ne s’arrêtent pas là. Charles Bricout décrit pour vous et par le menu, une grande partie des différents vêtements qu’il étudie dans sa thèse, couche après couche. De fait, des sous-vêtements – dont il dévoile un détail singulier – à la côte, les vêtements médiévaux n’auront plus de secrets pour vous. Si la panoplie de base est globalement la même pour les femmes et les hommes, Charles Bricout vous apprend aussi quelles pièces différencient les vêtements féminins et masculins. Vous saurez même comment habiller les enfants et quoi porter au Moyen Âge selon les saisons !
La confection des vêtements et des accessoires au Moyen Âge
“On est dans une société où, clairement, l’habit fait le moine.” — Charles Bricout
Les accessoires, tout comme les matières premières employées, jouent ainsi un rôle essentiel dans le costume médiéval. Dans sa thèse, Charles Bricout s’attarde ainsi sur la dimension sociétale du vêtement. Le statut social d’une personne se lit donc dans son apparence : chaussures, chapeaux, moufles, gants, mais aussi bijoux et autres parures traduisent le rang et la richesse.
“L’accessoire principal de la tenue, c’est la ceinture. […] En cuir, ornée…, on peut aller très très loin dans le luxe de la ceinture : c’est vraiment un bijou.” — Charles Bricout.

De fil en aiguille, Charles Bricout aborde la confection proprement dite des vêtements et les matériaux utilisées. Du drap d’ortie au coton, en passant par la laine et la fourrure — dont le commerce est florissant jusqu’à la fin du XIIIème siècle, comme vous l’entendiez dans l’épisode 106 avec Claire Dessus-Gilbert —, de nombreuses matières premières servent à fabriquer les vêtements, selon leur fonction, leurs propriétés ou l’esthétique recherché. Les bijoux, en or, en argent, s’ajoutent, eux aussi, à la parure médiévale — du moins, quand on en a les moyens.
Concernant les tissus, Charles Bricout s’intéresse aussi aux pigments et à leur prix souvent exorbitant, qui varie selon la couleur et, encore une fois, la matière première employée. Souvenez-vous d’ailleurs, dans l’épisode 74, Julia Pineau vous expliquait que des escargots entraient dans la composition du pourpre de Tyr. Enfin, Charles Bricout vous livre quelques anecdotes et s’amuse à détricoter les idées reçues sur les vêtements. Vous saurez enfin, et de source sûre, si la laine grattait ou non au Moyen Âge.
Pour en savoir plus sur le sujet de l’épisode, on vous conseille de lire :
- BARTHOLEYNS Gil, « Gouverner par le vêtement : naissance d’une obsession politique », dans Marquer la prééminence sociale, Paris-Rome, Editions de la Sorbonne, 2014, [en ligne] : http://books.openedition.org/psorbonne/3346 .
- BRICOUT Charles, « Le port de la ceinture sur le surcot masculin entre usage et mode au XIIIe siècle », Moyen Âge, no. 130, p.56-66.
- CARDON Dominique, La draperie au Moyen Âge, essor d’une grande industrie européenne, Paris, CNRS Edition, 1999, 661 p.
- CARDON Dominique, Le monde des teintures naturelles, Paris, Belin, 2014, 783 p.
- CHORLEY Patrick, « The Cloth Exports of Flanders and Northern France during the Thirteenth Century: A Luxury Trade? », dans The Economic History Review, 40-3, Londres, Economic History Society, 1987, p. 349-379.
- COATSWORTH Elizabeth et OWEN-CROCKER Gale, Clothing the Past : Surviving Garments from Early Medieval to Early Modern Western Europe, Brill, 2018, p. 175–178.
- CROWFOOT Elisabeth, PRITCHARD Frances et STAINLAND Kay, Textiles and clothing 1150-1450, Woodbridge, Boydell Press, 1992, réédité en 2006, 223 p.
- ENLART Camille, Manuel d’archéologie française depuis les temps mérovingiens jusqu’à la Renaissance, Mâcon, Protat frères, 1916, 615 p.
- HELLER Sarah-Grace, Fashion in Medieval France, Woodbridge, Boydell Press, 2007, 206 p.
-

Illustration de l’épisode 111 sur les vêtements civils par Juliette Brocal @cy_lindric ØSTERGARD Else, Woven into the earth: textiles from Norse Greenland, Oxbow, Aarhus University Press, 2004, 296 p.
- PIPONNIER Françoise et MANE Perrine, Se vêtir au Moyen Âge. Paris, Édition Adam Biro, 1995, 206 p.
- SYLVESTER Louise, CHAMBERS Mark C. et OWEN-CROCKER Gale R. (dir.), Medieval dress and textiles in Britain: a multilingual sourcebook, Woodbridge, The Boydell Press, 2014, 412 p.
Dans cet épisode vous avez pu entendre les extraits des œuvres suivantes :
- Kaamelott, Livre VI épisode 5, Dux Bellorum
- Cendrillon (1950)
Si cet épisode vous a intéressé vous pouvez aussi écouter :
- Hors les murs #8 — 24h avec une troupe de reconstitution à Provin
- Épisode 74 – Julia et l’escargot au Moyen Âge
- Épisode 98 – Léa et l’habit masculin carolingien
- Épisode 106 – Claire et le commerce des fourrures au Moyen Âge
- Épisode 16 – Benjamin et mme Eloffe, marchande de mode (Passion Modernistes)
- Super Joute Ducale – Les ducs de Savoie au XVème siècle
Merci à Clément Nouguier pour le générique du podcast, à Baptiste Mossiere pour le montage de l’épisode, à Alizée Rodriguez pour l’article qui accompagne cet épisode et à Juliette Brocal pour la magnifique illustration.