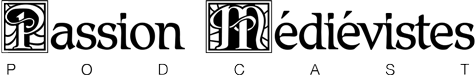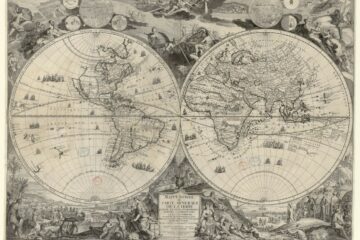Épisode 3 – Paul et Le Roman de Renart
Dans ce troisième épisode, Paul Le Gouez vous parle du Roman de Renart, une œuvre médiévale parfois mal connue.

A partir de son mémoire de première année de master, présenté en juin 2016 et intitulé “Circulation des biens dans le Roman de Renart”, Paul nous présente les réalités de cette œuvre de fiction du Moyen Âge. On est loin de l’image d’un conte pour enfants étudié par certains d’entre nous au collège.
Il nous montre que selon les différentes branches de l’œuvre, rédigée à différents moments par plusieurs auteurs, le personnage de Renart peut se révéler cruel ou sadique. Et il nous parle de son travail de recherche et de ses méthodes pour étudier la circulation des biens et les analyser.
Le Roman de Renart
Le Roman de Renart raconte l’histoire de Renart et des animaux de la forêt et de la basse-cour dans une sorte de société qui parodie la société humaine médiévale. Ce n’est pas un roman au sens moderne du temps, c’est-à-dire qu’il n’y a pas une histoire avec un début, un milieu, et une fin. Il s’agit d’un recueil de plusieurs épisodes, de plusieurs récits qu’on appelle « branches ». Nous nous retrouvons ainsi dans plusieurs univers : celui de la cour du Roi (le Lion), ou dans celui de la campagne dans laquelle Renart et ses ennemis cherchent à se nourrir.
Le Roman de Renart se rapproche un peu plus d’un fabliau dans le ton utilisé : très satirique, assez grivois, l’histoire est une véritable parodie des romans courtois et des chansons de geste. Dans une chanson de geste va encenser les exploits de héros épique, de chevalier. Alors que dans le Roman de Renart, le côté épique et les valeurs chevaleresques vont être parodiées pour être évidemment moquées.
Toutefois, l’histoire de Renart ne partage pas la longueur des fabliaux : ces derniers sont des petits textes de 200 à 500 vers. Alors que les branches du Roman de Renart font en moyenne, 1000-1200 vers. Il y en a des très courtes de 90 vers et des très longues de 3400 vers.
Une identité opposé au souvenir
Contrairement au souvenir de 5e notre invité, Renart n’est pas un personnage “bon enfant”. Renart vole, Renart tue, Renart viole et Renart est un sadique. Cela dépend des branches, car dans certaines, il joue des tours juste pour s’amuser, et dans d’autres, il fait du mal pour vraiment faire du mal. Dans d’autres branches encore, il fait écorcher ses ennemis, et dans d’autres récits il est mention de faits scabreux, scatologiques. Nous avons aussi des branches de récits qui parlent de guerre entre l’armée des païens qui est dirigée par le chameau, Musard, et l’armée chrétienne qui est dirigée par le Roi noble.
Pourquoi des animaux ?
Paul nous explique, que de son point de vue, ce qui est intéressant dans l’animalité des personnages, c’est qu’ils peuvent reprendre les codes des bestiaires médiévaux pour accentuer les caractéristiques des personnages. Par exemple, Renard est rusé, sournois, fourbe parce que ce sont ses caractéristiques dans les bestiaires. Le renard est censé être l’incarnation de Satan. Son pelage roux le rapproche de Judas, puisque le roux est la couleur des cheveux de Judas, le traître par excellence. Plusieurs animaux partagent des caractéristiques avec leur représentation dans les bestiaires médiévaux.
Dans l’animalisation de la cour, il y a aussi l’idée de pouvoir critiquer la société médiévale évidemment. C’est un procédé bien connu comme dans les Fables de La Fontaine. Cependant, le Roman de Renart n’a pas de portée moralisatrice : il ne s’agit pas d’une critique de la cour, par exemple, de Philippe Auguste ou des rois qui lui ont succédé. C’est plutôt une critique de la société en général, et surtout pour parodier les romans courtois et les chansons de geste.
Si le sujet vous intéresse voici quelques ouvrages pour en savoir plus :
- Devard Jérôme, Le roman de Renart: le reflet critique de la société féodale, Paris, 2010 (Historiques. Série Travaux)
- Zink Michel, Littérature française du Moyen Âge, 2e édition revue et mise à jour, Paris, Presses universitaires de France, 2001 (Collection Premier Cycle)
- Toureille Valérie, Vol et brigandage au Moyen Âge, Paris, 2006 (Le noeud gordien)
Ainsi que quelques liens :
- Un manuscrit du Roman de Renart du XIVème siècle illustré
- L’édition du Roman de Renart par E. Martin (utilisée par Paul Le Gouez dans ses recherches)
- Un très court article sur les problèmes d’édition du RdR Bellon Roger, « Éditer le Roman de Renart : bilan, problèmes et perspectives », 2001 1 (14), 2001.
Les extraits sonores diffusés pendant l’émission :
- Le Roman de Renart raconté aux enfants par Philippe Noiret
- Le dessin d’animation “Le Roman de Renart” (par Almersoft) :
- Le générique du dessin animé “Moi Renart”
- Kaamelott, saison 2 épisode 88
Fanny : Est-ce que l’on sait tout du Moyen Âge ? Et d’abord, qu’est-ce que le Moyen Âge ? En fait il y a autant de réponses que de médiévistes. Dans cette émission nous mettons de côté les châteaux forts et les chevaliers pour nous intéresser à comment l’histoire médiévale est étudiée aujourd’hui par de jeunes chercheurs, quels sont les sujets qui les intéressent, pour vous donner envie d’en savoir plus et, pourquoi pas, donner de l’inspiration à de futurs médiéviste.
Épisode 3 : Paul et le Roman de Renart, c’est parti !
Aujourd’hui pour ce troisième épisode, j’accueille Paul Le Gouez.
Bonjour Paul, tu es étudiant à l’université Paris 1 Panthéon Sorbonne en histoire médiévale, et en juin 2016 tu as présenté un mémoire sous la direction de Laurent Feller intitulé « La Circulation des biens dans le Roman de Renart ».
Alors pour commencer, est ce que tu pourrais nous résumer le Roman de Renart et nous présenter cette œuvre littéraire du moyen-âge.
Paul : C’est assez difficile de résumer le Roman de Renart en quelques mots. Mais globalement ce qu’il faut savoir c’est que, déjà, ce n’est pas un roman. Ce n’est pas une histoire qui a un début, un milieu, et une fin. C’est un recueil de plusieurs épisodes, de plusieurs récits qu’on appelle « branche », et qui raconte l’histoire de Renart et des animaux de la forêt et de la basse-cour dans une sorte de société qui parodie la société humaine médiévale. Donc on se retrouve dans plusieurs univers, l’univers de la cour du Roi (le Lion), ou dans l’univers de la campagne dans laquelle Renart et ses ennemis cherchent à se nourrir.
Fanny : Et qu’est ce cette œuvre a de si particulier pour qu’elle soit si connue ?
Paul : Alors, déjà, elle est connue puisque le mot français « renard » vient de là. C’est à dire que c’est l’œuvre qui a populariser le nom propre « Renart » en nom commun pour désigner l’animal. À la base, et dans le roman, l’animal est désigné par « goupil ». Et en plus, on sait qu’elle est populaire, enfin qu’elle a été populaire, puisqu’il nous reste à l’heure actuelle 14 manuscrits complets et 16 manuscrits fragmentaires. Elle a été traduite en néerlandais, en anglais, en allemand à peu près à la même période : milieu/fin du XIIIe siècle.
Fanny : Alors justement, est-ce qu’on sait qui a écrit le Roman de Renart, et à quel moment ? J’ai l’impression d’après ce que tu m’as dit qu’il y a plusieurs auteurs, et quel a été son processus de créations ?
Paul : Alors là, on rentre vraiment dans un problème épineux, parce que la datation qui est retenue c’est de 1175 à 1250, pour les différentes branches. Parce que, et c’est ça qui est un peu compliqué, c’est que les différentes branches n’ont pas été écrites par les mêmes auteurs. C’est à dire qu’il y a 25 ou 26 branches. Et elles ont toutes été écrites par un auteur différent, anonyme évidemment, sinon ce ne serait pas drôle. Pour ce qui est de la chronologie, elle est établie à partir d’indice qui sont soit dans le texte, soit hors texte. C’est à dire dans le texte on a peut être des mentions d’événements qui se sont passés, de personnalité de l’époque. Et des événements hors texte c’est juste tout simplement le vocabulaire utilisé, je sais pas moi, est ce que c’est écrit en picard ? est ce que c’est écrit en ancien français ? Voila il y a des indices comme ça qui permettent de dater, mais la datation est relative ; c’est censé être de 1175 a 1250 mais on ne peut pas non plus donner de datation plus précise.
Fanny : Comment peut-on qualifier cette œuvre, et quelle est sa place dans la littérature médiévale ?
Paul : Le Roman de Renart, n’est pas classable dans la littérature médiévale. C’est une œuvre à part, dans le sens où on ne peut pas la classer dans les genre pré-établis donc le roman courtois, les chansons de gestes, les fabliaux. Mais si on devait la définir, je dirais que ça se rapproche un peu plus d’un fabliaux dans le ton utilisé. C’est à dire que c’est très satyrique, c’est assez grivois. Mais en même temps ça ne partage pas la longueur des fabliaux : les fabliaux sont des petits textes qui font environ de 200 à 500 vers. Alors que les branches du Roman de Renart font plus, en moyenne, 1000-1200 vers quelque chose comme ça. Il y en a des très très courtes de 90 vers et des très longue de 3400 vers. Mais globalement ça a des traits des fabliaux et c’est un texte qui parodie les romans courtois et les chansons de geste. Du coup ça emprunte des codes de ces genres. Par exemple la chanson de geste normalement va encenser les exploits de héros épique, de chevalier. Alors que dans le Roman de Renart le coté épique et les valeurs chevaleresques vont être parodiées pour être évidemment moqué.
Extrait « Le Roman de Renart raconté aux enfants par Philippe Noiret ». Source
« C’était le temps de l’automne. Les feuilles des arbres devenaient rousses. Renart était dans son terrier en compagnie de son épouse Hermeline, et de ses deux fils Percehaie et Malebranche. Tout le monde avait faim. Renart décida alors d’aller voler quelque nourriture. »
Fanny : Tu as donc choisi d’étudier la circulation des biens dans le Roman de Renart, pourquoi ce choix ? Et pourquoi étudier une œuvre dans le cadre d’un master d’histoire médiévale ?
Paul : À la base, ça m’a surpris moi aussi parce que ce n’est pas moi — alors ce n’est pas que je n’ai pas choisi mon sujet, mais ce n’est pas moi qui l’ai trouvé. Quand je me suis inscrit en master d’histoire médiévale, je n’avais aucune idée de ce que je voulais étudier. Du coup quand je suis arrivé devant Laurent Feller, il m’a dit « bah y a un sujet que je voulais donner depuis longtemps » et c’était le mien. J’ai trouvé le titre plutôt accrocheur. Et pour ce qui est de la 2e partie de la question, donc pourquoi utiliser une œuvre littéraire en l’histoire médiévale, je dirais que le fait de changer de perspective et de ne pas prendre que des documents de la pratique, c’est-à-dire des documents, des chartes, des recueils de justice… Le fait de prendre une œuvre littéraire change le point de vue qu’on peut avoir sur la société, et permet aussi d’étudier une histoire des représentations. Puisqu’au final on ne va pas étudier la société médiévale telle quelle puisqu’il y a une sorte de miroir déformant qui est la satire, la parodie. Il faut se rappeler que même si la société renardienne singe la société médiévale, ça reste une société où les barons de la cour peuvent à tout moment uriner sur un arbre, se faire pourchasser par des chiens et par des paysans armés de bâton. Il faut vraiment voir cet univers comme un univers particulier qui ne permet pas non plus de rentrer dans l’étude de la société médiévale tel quel.
Fanny : Et donc pendant ton mémoire, comment tu as travaillé ? Quelles ont été tes sources, et tes méthodes de travail ?
Paul : Globalement, ce qui est assez compliqué, c’est qu’il existe plusieurs manuscrits qui ne donnent pas à voir le même Roman de Renart. C’est-à-dire que selon la famille de manuscrit, je ne vais pas rentrer dans le détail mais il y a 3 familles, on a une disposition différente des branches, c’est-à-dire une histoire qui change en fait, l’ordre de l’histoire qui change en tout cas. On a des branches qui peuvent différer dans leur contenu, dans leur taille. Et on a surtout du vocabulaire différent, une mise en scène différente. Et donc déjà le premier travail c’était de savoir quelle édition je voulais utiliser. Il y a plusieurs éditions scientifiques : j’ai choisi celle qui était peut-être pas la moins bonne mais en tout cas la plus accessible pour quelqu’un qui ne connaissait pas du tout le Roman de Renart, puisque c’est celle qui a été effectuée à la fin du XIXe siècle et qui était traduite en français moderne. Et ça c’était très important pour moi, parce que je ne suis pas assez spécialiste du français médiéval pour pouvoir déceler les nuances. Et donc du coup j’ai lu le Roman de Renart en français moderne, évidemment j’avais le vis-à-vis en français médiéval à côté pour pouvoir regarder le texte en français médiéval. Mais pour moi c’était important d’avoir à ma disposition le texte en français moderne. Ce que j’ai fait donc, c’est tout simplement : j’ai lu le Roman de Renart et j’ai essayé de relever petit à petit dans ma lecture toutes les instances de circulation de bien qui se présentaient à moi et de les noter. D’abord à l’aide d’un système de post-it, et après via informatique sur un tableur Excel d’abord, puis sur une base de données.
Extrait « Le dessin d’animation “Le Roman de Renart” (par Almersoft) ». Source.
« Votre royale magnificence, j’ai convoqué cette audience pour vous tenir informé des actes scandaleux commis par l’infâme Renart. Renart a volé des piquants et de la laine, ce qui fait de lui un voleur ! Il se moque des lois conçues par notre grand chancelier. »
Fanny : Et quelle conclusion tu as tirée de ton travail sur le Roman de Renart ?
Paul : Moi je travaille donc sur la circulation des biens, c’est-à-dire la manière dont les personnages du Roman de Renart vont s’approprier des biens. Je ne parle pas de la circulation des biens d’un point A à un point B mais de la circulation de propriété en fait, d’un transfert de propriété d’un objet ou d’un bien quelconque. Et à partir de là, j’ai conclu plusieurs choses. Donc déjà que le vol, toutes les formes de vol, étaient les formes de circulation de bien les plus importantes dans le Roman de Renart. J’ai aussi pu conclure que les objets étaient importants dans la circulation. La nature des objets notamment, et j’ai trouvé que le vol était essentiellement sur de la nourriture ou sur la peau des animaux. Alors la nourriture, pourquoi ? Parce que le Roman de Renart est, d’après Jacques le Goff, une épopée de la faim, et c’est vrai c’est-à-dire que les animaux sont sans cesse en quête de nourriture, sont sans cesse attirés vers le monde humain parce qu’ils ont faim et que c’est dans le monde humain qu’ils vont trouver leur subsistance. Et pour la peau, là pour le coup, c’est un autre moteur du récit, mais cette fois-ci c’est ce qui attire les humains vers les animaux. Ça a plusieurs significations, mais la première c’est juste prendre leur peau comme objet de désir, l’objet d’un désir cupide puisque la peau animale peut être utilisée pour fourrer les vêtements, ou pour la revendre après l’avoir traité et la peau d’un renard, d’un chat sauvage ou d’un loup vaut son pesant d’or.
Fanny : Pendant tes recherches, qu’est-ce qui t’a le plus étonné ?
Paul : Ce qui m’a le plus étonné, c’est quand j’ai lu le Roman de Renart, que j’avais des souvenirs comme beaucoup d’entre nous du Roman de Renart de 5e en fait. Je m’en souvenais comme d’un texte bon enfant, Renart était un personnage malicieux mais sans plus. Il aimait bien jouer des tours assez mignons somme toute. Et en lisant le Roman de Renart, bah je me suis rendu compte que c’était pas du tout ça. C’est-à-dire que Renart vole, Renart tue, Renart viole et Renart est un sadique en fait. Et ça, ça m’a beaucoup surpris. Alors ça dépend des branches, parce qu’il y a des branches où il joue des tours juste pour s’amuser, et il y a des branches où il souhaite vraiment le mal, il souhaite vraiment faire le mal. Dans certaines branches par exemple, il fait écorcher ses ennemis, et il y a plein de récits qui sont scabreux, scatologiques. Il y a un récit très drôle sur la création du sexe féminin, voilà, je ne m’attendais pas à trouver ça dans le Roman de Renart. Et à côté on a des récits, enfin des branches, qui parlent de guerre entre l’armée des païens qui est dirigée par le chameau, Musard, et l’armée chrétienne qui est dirigée par le Roi noble. Je pense que ce qui m’a le plus étonné dans mon étude, c’est la diversité à l’intérieur même du Roman de Renart. Et le fait que ce n’est pas une histoire qui se suit. C’est-à-dire, si jamais vous avez l’occasion de le lire, la première branche, donc la première histoire, rentre directement dans le vif du sujet. C’est-à-dire que le loup arrive à la cour du Roi noble et va se plaindre du viol subi par sa femme. Sauf que ce viol ne nous est raconté que dans la branche 2.
Extrait : Kaamelott, saison 2 épisode 88.
— Bohort : Vous ne regretterez pas cet achat.
— Grüdü : On aurait quand même pu prendre 2-3 gars pour mes renforts, parce qu’en cas de coup dur je suis tout seul à la sécu.
— Arthur : Bon on peut se barrer maintenant, j’en ai ma claque !
— Bohort : Mon dieu sir ! Un vol à l’arraché ! Oh non… un esclave tout neuf.
Fanny : On pourrait se demander, mais pourquoi les personnages sont des animaux ? Qu’est-ce que ça apporte le fait qu’ils soient des animaux dans l’œuvre ?
Paul : Dans l’épisode précédent, vous avez parlé avec Ombeline des bestiaires médiévaux, et je pense que ce qui est intéressant dans l’animalité des personnages, c’est qu’ils peuvent reprendre les codes des bestiaires médiévaux pour accentuer les caractéristiques des personnages. Par exemple, Renart est rusé, sournois, fourbe. Mais il l’est parce que dans les bestiaires le renard est censé être l’incarnation de Satan. Son pelage roux le rapproche de Judas, puisque le roux est la couleur des cheveux de Judas, le traitre par excellence. Et il y a plein d’animaux comme ça qui partagent des caractéristiques avec leur représentation dans les bestiaires médiévaux. Il y a une idée aussi, je pense, dans l’animalisation de la cour, de pouvoir critiquer la société médiévale évidemment. C’est un procédé bien connu comme dans les Fables de La Fontaine, sauf que le Roman de Renart n’a pas de portée moralisatrice : c’est-à-dire qu’on ne va pas critiquer la cour d’untel. Ce n’est pas une critique de la cour, par exemple, de Philippe Auguste ou des rois qui lui ont succédé. C’est plutôt une critique de la société en générale, et aussi c’est pour parodier les romans courtois et les chansons de geste.
Fanny : Et pour finir, quel conseil tu donnerais à quelqu’un qui veut étudier l’histoire médiévale ?
Paul : Déjà, de le faire par passion. Votre sujet de recherche va vous suivre pendant deux ans et si vous n’avez pas envie de vous plonger dedans, arrêtez tout de suite ça ne sert à rien. Il faut aussi je pense avoir une rigueur personnelle, mais ça, ça va pour tous les masters de recherche, ce n’est pas qu’en histoire médiévale. Et globalement il faut voir la société médiévale comme une société complètement différente de la nôtre, c’est-à-dire que ce n’est pas parce que c’est des gens qui habitaient aux mêmes endroits que nous à l’heure actuelle qu’ils nous ressemblent. Leur perception de la vie, leur perception de l’égalité, leur perception du travail, leur perception entière en fait de la société change par rapport à la nôtre. Et donc du coup il faut voir un peu comme une étude anthropologique. C’est comme si vous alliez voir une tribu en Amérique du Sud, ou en Afrique comme les anthropologues ont pu le faire. Il faut vraiment se sortir de cette idée qu’on va étudier nos racines, nos ancêtres. Ils le sont peut-être par le sang, mais en tout cas pas par la pensée.
Extrait : Générique du dessin animé Renard.
« Renard, sacripant, sacripouille, coquet coquin. Renard chenapan, chacripouille, sacré vaurien ».
Fanny : Merci beaucoup Paul pour tes éclairages sur le Roman de Renart. Toute cette discussion m’a donné très envie de le relire. Si le sujet vous a intéressé vous pouvez retrouver plus d’information dans la description de l’épisode sur Soundcloud. N’hésitez pas à vous abonner à la page Facebook de Passion Médiévistes et au compte Twitter pour suivre l’actualité du podcast.
Le prochain épisode, justement, nous voyagerons dans les Flandres, le Hainaut et la Bourgogne à la recherche des sceaux de comtesse. Salut !
Merci beaucoup à Bobu et So pour la retranscription !
Si cet épisode vous a intéressé vous pouvez aussi écouter :